L’analyse comparative des arabismes révèle que ces emprunts arabes, loin d’être marginaux, façonnent le discours médiatique contemporain. En explorant leur impact socioculturel, cette étude offre des perspectives inédites sur la perception de l’information en France, essentielle pour comprendre les dynamiques linguistiques actuelles.
Les principaux domaines des arabismes dans la langue française et leur place dans le discours médiatique
Si on considère les éléments lexicaux utilisés dans les textes médiatiques, on peut clairement souligner le fait que dans la presse, on trouve tous les styles de discours et des lexèmes de n’importe quelle sphère de la vie. C’est pourquoi nous vous suggérons de regarder en détail les domaines les plus populaires où nous rencontrons des emprunts arabes.
2 . 4 . 1 L e s p r o d u i t s a l i me n t a i r e s . Au Moyen Âge, nombre d’emprunts à l’arabe pénètrent dans le français, bien que certains linguistes les considèrent comme rares et uniques, rarissimes en français avant le XIVe siècle. Le premier groupe sémantique qu’on distingue c’est «aliments, légumes et fruits, boissons», par exemple:
- abricot – corresp. rom. : ital. albicócco; prov. aubricot, ambricot, albricot; cat. albercoc; esp. albaricoque; port albricoque, abricote (< fr.). L’esp. albaricoque, le port. albricoque et le cat. albercoc sont tous trois empr. à l’ar. al barkuk < bas gr. praikokkion < lat. praecoquum « fruit précoce » [4];
- aubergine – empr. au cat. alberginía subst. « id. », attesté dep. le xiiies. 1), empr. à l’ar. al bādinǧān « id. » [4];
- orange – de l’italien arancia apparenté à l’espagnol naranja, de l’arabe, naranj (« bigarade, orange amère ») [24];
- sucre – empr. à l’ital.zucchero « sucre », att. dep. le xiiies. (dér. zuccherato « sucré », Iacopone da Todi; zucchero au xives., Crescenzi ds Tomm.-Bell.), lui-même empr. à l’ar. sukkar ]; [4] On sait que ce sont les Arabes qui ont amené la culture de la canne à sucre en Sicile.
- estragon – les Empr., par l’intermédiaire du lat. médiév.tarcon, altarcon (fin du xiies., Gérard de Crémone ds Roll. Flore t. 7, p. 71), lat. bot. tarchon (1538, trad. lat. de Siméon Seth De Cibariis ds NED s.v. tarragon), gr. médiév. τ α ρ χ ο ν (xies., Siméon Seth ds Roll., loc. cit.), à l’ar.tarh̬ūn [4];
- merguez – de l’arabe, mirqāz (« saucisse ») [24];
- café – empr. à l’ar. qahwa, v. caoua) soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ital. [à partir de la région de Venise, DEI] (Brunot t. 3, p. 221; Prati; EWFS2; DG; Dauzat 1973) attesté d’abord sous les formes caveé [4];
- sirop – empr. au lat. médiév.siroppus, siruppus, syrup(p)us et celui-ci à l’ar. šarāb « boisson; sirop » [4].
Puisque le sujet de la nourriture appartient au vocabulaire courant, les mots ci-dessus peuvent être facilement trouvés dans les médias. Par exemple, quelque titres d’articles du Figaro: « Est-il bon de mettre du lait dans son café », « L’UE interdit des sirops pour la toux potentiellement dangereux », « Niveau record pour le prix du jus d’orange » [13].
2 . 4 . 2 D o ma i n e mi l i t a i r e . Les contacts des Français avec la population maghrébine lors des batailles militaires en Algérie, en Tunisie et au Maroc ont contribué à reconstituer le vocabulaire militaire français avec les lexèmes arabes, qui a alors commencé à être utilisé dans la langue vernaculaire française.
On peut citer les exemples suivantes:
- algarade – empr. à l’esp. algarada « incursion brusque en territoire ennemi », attesté dep. env. 1300 (Gran Conquista de Ultramar, d’apr. Cor. t. 1 1954, s.v. algara; attesté également au sens « tumulte, cris », ca 1270, Primera Cronica General de Alfonso X el Sabio), dér. de algara « id. », de l’ar. al gāra « id. » [4];
- arsenal – 1 a, prob. empr. directement à l’ar. étant donné sa date; Vidos loc. cit. propose pour les formes en -rs- l’ar. dâr-sinâ’; FEW t. 19, p. 39 a, pour ces mêmes formes, l’ar. dār as-inā’; 1 b, empr. de même à l’ar., mais par l’intermédiaire des dial. ital. où sont relevées des formes en t- initial [4];
- boutre – empr. à l’ar. būt « sorte de bateau à voile » [4];
- clebs – Empr. à l’ar. d’Algérie kelb (ar. class. kalb) « chien ». Le mot, introduit par les soldats africains et répandu dans l’usage familier, désigne un chien [4];
- baroud – 1924 baroud « combat » (d’apr. Esn.); 1936 baroud d’honneur, supra ex. 4. Mot chleuh (dial. berbère du sud du Maroc) [4];
- casbah – empr. à l’ar. qaṣaba « forteresse », du verbe qaṣaba « couper, retrancher» [4];
- goum – empr. à l’ar. maghrébingūm « tribu, peuple, gens; contingent de cavaliers armés que certaines tribus fournissent au chef du pays lorsqu’il fait une expédition » [4];
Ces mots sont tellement ancrés dans la langue française qu’on les retrouve souvent dans des articles à caractère militaire. Nous proposons les extraits suivants à titre d’exemple: « Pour le dernier baroud des syndicats avant le vote de la réforme jeudi à l’assemblée, plus d’un millier de casseurs pourraient être une fois encore au rendez-vous dans la capitale », « L’algarade d’une dizaine de minutes a eu lieu lors d’une séquence consacrée au bateau de migrants Ocean Viking » [13].
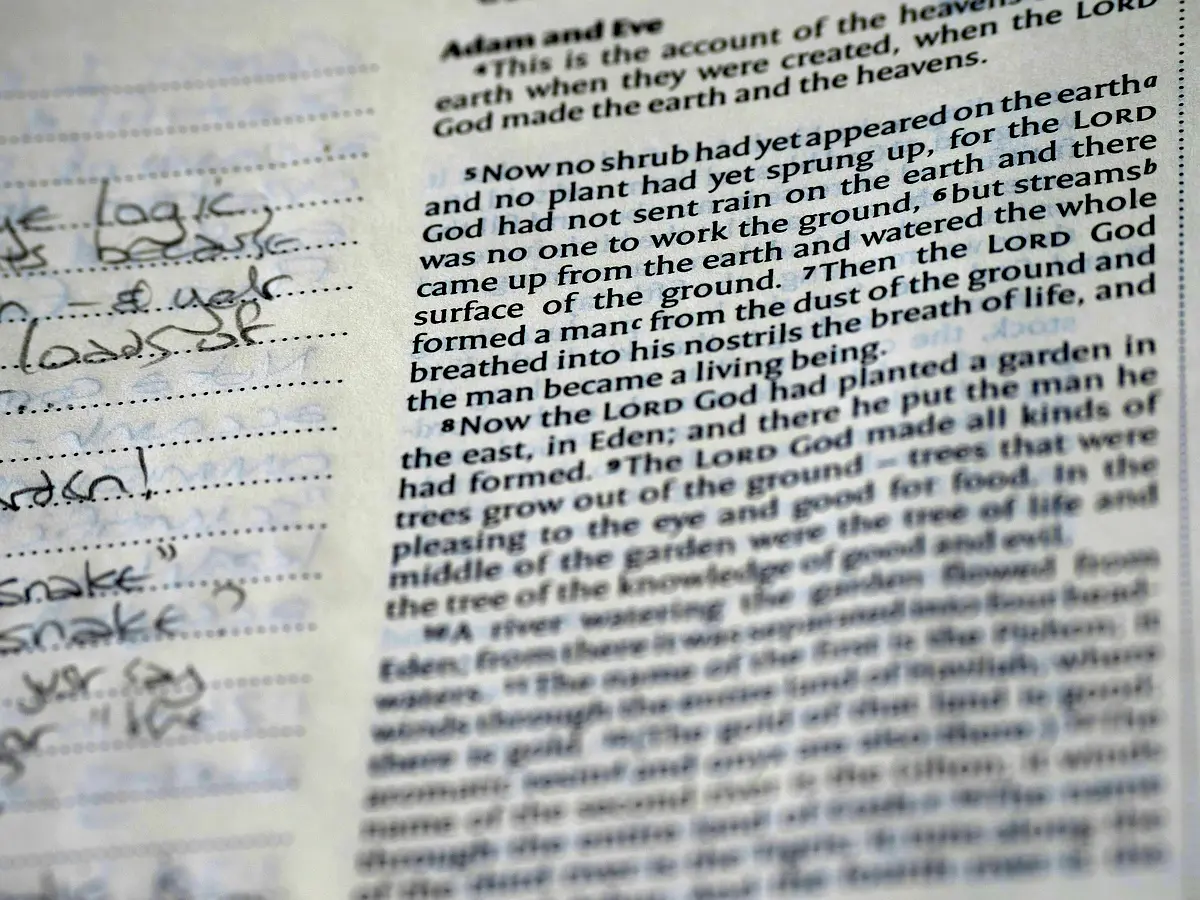
2 . 4 . 3 S c i e n c e e t t e c h n o l o g i e . La science arabe médiévale a eu une influence notable sur les pays occidentaux, et l’une des manifestations de cette influence est l’utilisation de termes scientifiques arabes dans les langues européennes. Pour illustrer ce point, nous allons mettre en évidence l’origine arabe de certains termes présents dans certaines langues
européennes qui se rapportent aux domaines suivants : mathématiques, chimie, médecine et pharmacie. Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive:
- termes mathématiques :
- algèbre – de l’ar. al-ǧabr « réduction » (le nom ar. complet était ilm al-ǧabr wa l- muqâbala « science des restitutions et des comparaisons » [4];
- algorithme – de l’arabe al-Ḵuwārizmiyy, nom du mathématicien perse Al-Khwarizmi déformé d’après le grec ancien arithmós [24];
- chiffre – de l’arabe, ṣifr, par l’intermédiaire du latin médiéval cifra [24];
- termes de chimie :
- alchimie – de l’arabe al-kīmiyā (« (la) chimie, art de faire de l’or, art de purifier son coeur ») [24];
- alcool – de l’arabe kohl (« très fine poudre [d’antimoine] ») [24];
- azur – issue de l’ar. lāzaward « lapis lazuli » [4];
- elixir – du latin elixir emprunté à l’arabe ibérique médiéval āl-ʾiksyr (« pierre philosophale ») [24];
- termes de médecine et de pharmacie :
- soude – de l’ar. suwwād [4];
- laque – empr. à l’ar.lakk « laque » [4];
- looch – empr. à l’ar.la’ūq « électuaire » (proprement : « potion qu’on lèche, qu’on prend à petites gorgées ») [4];
- tamarin – du latin médiéval tamarindus lui-même de l’arabe támra (« datte ») [24];
- termes d’astronomie :
- alidade – de l’ar. al idāda « id. » (« règle, instrument de traçage et de mesure ») [24];
- azimut – de azimuth (1544, « cercle vertical mené par un point qu’on considère »), de l’espagnol acimut (fin XIIIe siècle), venant de l’arabe (as-)simt (« le chemin ») [24];
Il est à noter que les mots techniques et scientifiques commencent souvent par les combinaisons de lettres « al », qui est un article défini en arabe.
Analysant donc tous ces mots mentionnés ci-dessus, nous pouvons affirmer que la plupart d’entre eux sont devenus couramment utilisés dans la langue française, car ce sont des concepts uniques qui n’ont pas d’équivalent français. Ainsi, dans le discours médiatique, ils apparaissent sur un pied d’égalité avec les mots d’origine française. Alors, nous donnons des exemples de titres dans lesquels des arabismes issus du champ scientifique sont présents :
« Article réservé à nos abonnés Influenceurs et alcool : les zones grises de la loi Evin », « Le sac de compost, une alchimie domestique », « Article réservé à nos abonnés Pause séries
: le Mehdi de « Braqueurs » que l’algorithme de Netflix a rendu immortel » [14].
2 . 2 . 4 V ê t e me n t s . Le monde arabe est à l’origine de plusieurs textiles et habillement. Donc en ce qui concerne les termes dans ce domaine, on peut noter que cela inclut des mots qui signifient des matériaux et des vêtements qui ont été importés des pays arabes vers les pays européens, respectivement, ils ont été importés avec leurs noms, ou on peut distinguer également les vêtements uniques des Arabes, dont les noms n’ont pas d’équivalents dans d’autres langues. Par exemple :
- coton – empr. à l’ar. quṭun, « coton » par l’intermédiaire de l’ital. Cotone [4];
- jupe – de l’italien giubba ou jupa, issu de l’arabe, jobba (« pelisse courte ») [24];
- satin – de l’arabe zaytwn qui est la transcription arabe du nom de la ville chinoise de Citong aujourd’hui appelé Quanzhou [23];
- basane – de l’occitan besana, banana lui-même de l’espagnol badana, emprunté à l’arabe baṭāna, biṭāna (« doublure ») [24];
- camelot – de l’arabe ḫmlāt (« peluches de laine »), attesté en 1168 sous la forme camelos puis, parfois, sous la forme chamelot par rapprochement avec chameau et le latin camelus (« chameau ») [24];
- caban – de l’arabe qaba’ (« capote, vêtement de dessus ») [24];
- mousseline – de l’ar. mausilī « originaire de Mossoul », dér. de mausil nom ar. de la ville de Mossoul, sur le Tigre, célèbre pour la toile fine qui y était fabriquée [4]. Ce qui est intéressant, c’est qu’au fil du temps ce mot a acquis d’autres sens, plutôt métaphoriques, et
par exemple, on peut remarquer son utilisation dans le domaine culinaire quand il signifie la purée des légumes.
« Lunettes noires et ensemble en satin : l’apparition futuriste de Juliette Binoche à la Fashion Week ». « Dans la pénombre du jour finissant, Léonard Madjaetou termine l’inspection de son champ de coton » . Voilà nous proposons le contexte d’utilisation des mots ci-dessus tirés du Figaro [13].
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux domaines des emprunts arabes dans la langue française?
Les principaux domaines des emprunts arabes dans la langue française incluent les produits alimentaires, le vocabulaire militaire, et d’autres sphères de la vie.
Comment les emprunts arabes influencent-ils le vocabulaire médiatique français?
Les emprunts arabes influencent le vocabulaire médiatique français en intégrant des lexèmes spécifiques qui enrichissent le discours, comme des termes liés à la nourriture et au domaine militaire.
Quels exemples d’emprunts arabes liés à la nourriture sont mentionnés dans l’article?
Des exemples d’emprunts arabes liés à la nourriture incluent abricot, aubergine, orange, sucre, estragon, merguez, café et sirop.