L’influence des arabismes dans les médias révèle des dynamiques linguistiques surprenantes qui transforment notre compréhension du français moderne. Cette recherche met en lumière l’impact socioculturel de ces emprunts, redéfinissant ainsi le vocabulaire médiatique et son rôle dans la perception de l’information en France.
Le concept d’emprunt et les raisons de leur apparition
Claude Duneton, écrivant et chroniqueur au Figaro Littéraire, a bien affirmé: « Une langue doit évoluer pour être vivante » 13. Cette citation implique l’idée qui est au centre des études de la linguistique moderne. Le monde dans lequel nous vivons change chaque jour. Par conséquent, la langue ne peut pas non plus stagner.
Elle se développe avec la société, c’est-à-dire elle est toujours dynamique. Les changements peuvent affecter tous les domaines du langage. Les changements phonologiques affectent le système phonologique de la langue. Avec les changements sémantiques, le sens des mots change. Les changements lexicaux couvrent la composition lexicale de la langue. Les changements grammaticaux modifient les structures grammaticales.
Les raisons du développement du langage sont diverses. Ce sont souvent des raisons économiques. Par exemple, l’innovation contribue bien au développement du langage. Cela est vrai, lorsque de nouvelles choses sont créées. Ces choses ont besoin d’un nom et ainsi de nouveaux mots surgissent. En règle générale, le développement du langage n’est pas planifié.
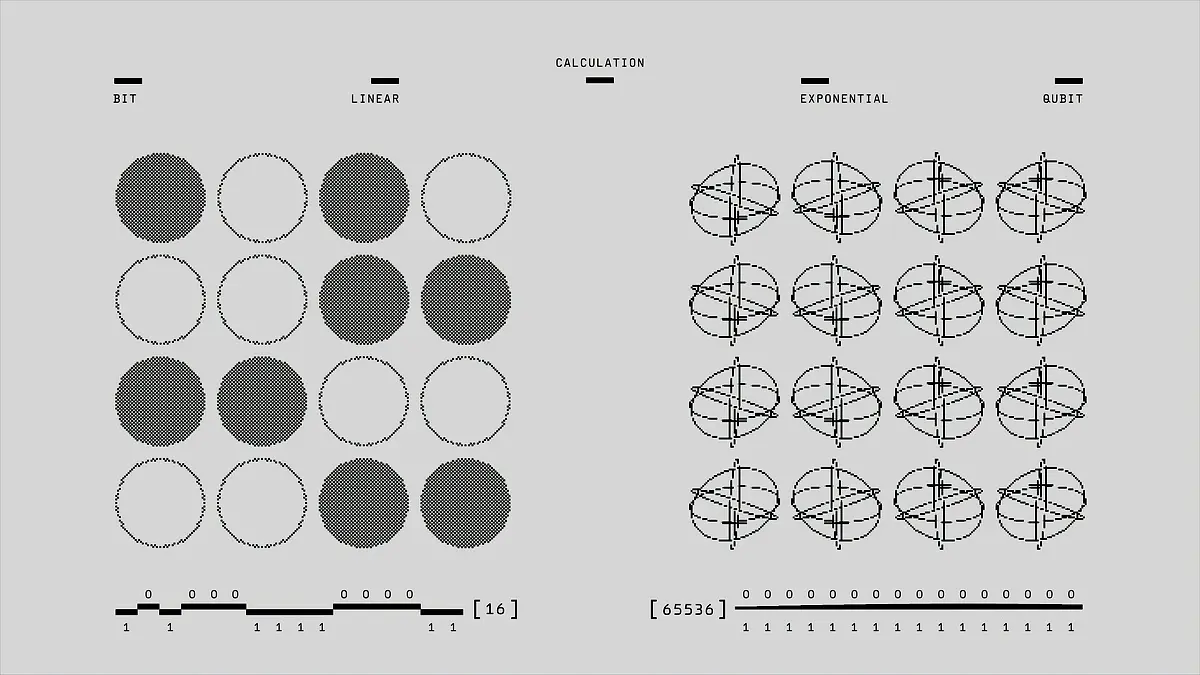
C’est un processus naturel et se produit automatiquement. Mais les gens peuvent aussi varier leur langage tout à fait consciemment. Ils le font lorsqu’ils cherchent à obtenir un certain effet.
Les emprunts occupent une place non négligeable dans le lexique de nombreuses langues, car ils sont le résultat d’une longue interaction historique des langues et prédominent parmi les moyens de l’enrichissement du vocabulaire.
Alors, comme on a mentionné, les langues ne sont pas isolées l’une de l’autre. Elles sont en contact par l’intermédiaire de leurs utilisateurs, en raison du voisinage, de la coexistence des peuples, des migrations ou des colonisations, les phénomènes qui mènent souvent au bilinguisme. Ainsi, l’emprunt est-il le phénomène sociolinguistique le plus important dans le contact des langues.
Le processus d’emprunt de mots d’une langue à une autre est déterminé par des raisons internes et externes. Les raisons externes (extralinguistiques) de l’emprunt devraient inclure la présence de liens politiques, économiques et culturels entre les peuples, la diffusion de la mode des mots empruntés, la supériorité culturelle d’une nation dans un certain domaine d’activité, le motif de prestige, qui est particulièrement forte dans des conditions de bilinguisme, le désir d’originalité, etc.
Les raisons linguistiques internes des emprunts incluent des choses telles que la nécessité de nommer de nouveaux objets et phénomènes, la perceptibilité d’un déficit lexical, l’élimination de la polysémie des mots, la tendance au démembrement du signifié, l’économie des moyens linguistiques, la nécessité de reconstituer les moyens expressifs du langage.
Il est à noter que l’existence de contacts étroits et directs avec un peuple ne conduit pas toujours à un processus d’emprunt intensif à la langue de ce peuple. A l’inverse, les contacts distants peuvent provoquer un afflux actif d’emprunts aux langues des peuples avec lesquels la langue destinataire n’est pas en contact.
Mais alors d’autres facteurs jouent un rôle important : le rôle politique du pays et de la langue, le développement scientifique et économique, le renouvellement constant des moyens lexicaux par la formation de mots qui désignent des phénomènes nouveaux et pertinents. Ceci, à notre avis, peut expliquer une large utilisation de mots empruntés, notamment, à la langue anglaise, dans diverses langues du monde.
Et c’est tout à fait naturel, car cette dernière est la langue de communication internationale. La plupart des linguistes admettent que c’est la langue anglaise, qui a acquis un statut international, qui est devenue un « donneur » linguistique, en particulier terminologique, pour les autres langues.
Un autre aspect, que nous observons souvent est que les langues ne se suffisent pas à elles-mêmes. Autrement dit, elles ne peuvent pas satisfaire toutes les nécessités de communication de leurs utilisateurs sans emprunter des éléments à d’autres langues. Il est tout à fait normal que les mots d’une langue contribuent à dynamiser un autre système linguistique en s’ajoutant aux ressources de celui-ci.
C’est également le cas pour le français, qui a emprunté au grec, au latin, à l’italien, à l’anglais, et ainsi de suite, tout au long de son histoire 17.
Si on considére la question de la définition de l’emprunt, nous penchons vers la formulation du Robert, où l´emprunt est défini comme « processus par lequel une langue accueille directement un élément d’une autre langue ; élément (mot, tour) ainsi incorporé » 5. On peut donc bien observer que le terme emprunt désigne d’une part le procédé, c’est-à-dire l’acte direct d’emprunter, et d’autre part – l’élément emprunté.
Le processus d’enrichissement de la langue au détriment d’unités jusque-là inconnues se déroule constamment, rafraîchissant et mettant à jour la langue, l’adaptant aux besoins des personnes et aux changements qui se produisent constamment dans le monde. Donc la principale raison de l’emprunt peut être considérée comme la nécessité pour les locuteurs d’une certaine langue de nommer une nouvelle réalité pour eux en tant qu’objet, phénomène etc 15.
L’attitude à l’égard des emprunts est ambiguë: certains pensent qu’il menace l’identité de la langue, tout en oubliant souvent l’absence d’équivalent, alors le word étranger est le seul nom de l’objet ou du phénomène correspondant, tandis que les autres utilisent indûment les mots étrangers, en essayant de mettre dans chaque phrase les emprunts.
Cependant, les emprunts ne nuisent pas du tout à la langue, puisque le vocabulaire et la grammaire de base sont préservés. Et la présence de ces mots ne prouve pas sa pauvreté. Une fois qu’un emprunt arrive, est modifié et fixé dans un nouveau système lexical, cela indique l’activité de la langue qui lui succède.
Par rapport à la langue française, le problème des emprunts s’est posé dès le XVIe siècle, lorsque les scientifiques ont commencé à s’en occuper au début de la standardisation de la langue. En général, la majorité était favorable au fait que les emprunts soient nécessaires, notamment aux langues latines et grecques, par exemple, Joachim du Belle était parmi les partisans.
Cependant, des personnalités telles que François de Malherbe ou Henri Bastien s’opposent activement aux emprunts, notant qu’ils occultent l’authenticité et l’originalité de la langue 12.
L’emprunt peut être dénotatif ou connotatif. Il est considéré comme dénotatif lorsqu’il se rapporte à des objets nouveaux, à des inventions technologiques telles que l’informatique et la cibernétique, ainsi que dans le domaine artistique. L’emprunt connotatif, quant à lui, reflète la manière de penser la vie, traduisant des faits de société et désignant un mode de vie 7.
________________________
5 processus par lequel une langue accueille directement un élément d’une autre langue ; élément (mot, tour) ainsi incorporé. ↑
7 L’emprunt connotatif, quant à lui, reflète la manière de penser la vie, traduisant des faits de société et désignant un mode de vie. ↑
12 s’opposent activement aux emprunts, notant qu’ils occultent l’authenticité et l’originalité de la langue. ↑
13 Une langue doit évoluer pour être vivante. ↑
15 la nécessité pour les locuteurs d’une certaine langue de nommer une nouvelle réalité pour eux en tant qu’objet, phénomène etc. ↑
17 C’est également le cas pour le français, qui a emprunté au grec, au latin, à l’italien, à l’anglais, et ainsi de suite, tout au long de son histoire. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les types d’emprunts arabes dans la langue française moderne?
L’article examine les différents types d’arabismes intégrés au français et analyse leur adaptation lexicale et sémantique.
Pourquoi les emprunts linguistiques apparaissent-ils dans une langue?
Les raisons du développement du langage sont diverses, incluant des raisons économiques, la nécessité de nommer de nouveaux objets et phénomènes, et le désir d’originalité.
Quel est l’impact socioculturel des emprunts arabes dans les médias?
L’étude explore l’impact socioculturel de ces emprunts et leur rôle dans la formation du vocabulaire médiatique, ainsi que leur influence sur la perception de l’information dans la société française.