L’innovation technologique en immunologie révèle que le stress environnemental peut affaiblir notre système immunitaire, augmentant ainsi le risque de maladies opportunistes. Cette recherche met en lumière des mécanismes d’immuno-modulation cruciaux, transformant notre compréhension des interactions entre stress et santé.
Conséquence du stress sur le système immunitaire
Maladies opportunistes
Les maladies opportunistes sont dues à des pathogènes peu agressifs mais se développant lorsque le système immunitaire est affaibli [7].
Les herpes virus sont des virus capables de rester dans l’organisme sous une forme latente et de se réactiver lors de déficience de l’organisme. Un stress chronique semble être un facteur de risque de la résurgence de la forme génitale de ce virus (Cohen et al., 1999).
Les conséquences du Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA), telles que le développement de maladies opportunistes, peuvent mettre plus ou moins de temps à se développer selon l’individu. Une étude portant sur l’évolution d’hommes infectés par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH, responsable du SIDA) sur plusieurs années, montre que les individus stressés ont une progression clinique plus rapide par rapport à ceux bénéficiant d’un plus grand support social (Leserman et al., 2002).
Une étude expérimentale portant sur le Virus d’Immunodéficience Simien (VIS) a permis d’explorer de manière plus spécifique l’impact du stress dans le développement du rétrovirus. Le virus est inoculé à des macaques rhésus en bonne santé, un groupe est également exposé à un stress social, les animaux dans un contexte social stable ont survécu plus longtemps et avaient un taux d’ARN viral moindre ainsi qu’un taux d’anticorps anti-VIS supérieur aux primates stressés (Capitanio et al., 1998).
L’exposition à un stress chronique a donc été associée au développement de certaines maladies infectieuses comme la grippe laissant supposer une immunodépression chez les individus stressés (Cohen et al., 1998).
Stress et maladie auto-immune
Les maladies auto-immunes sont la conséquence d’un dysfonctionnement du système immunitaire. En effet, suite à une perte de tolérance envers ses propres constituants, l’organisme libère des lymphocytes auto réactifs qui visent les antigènes du soi [8].
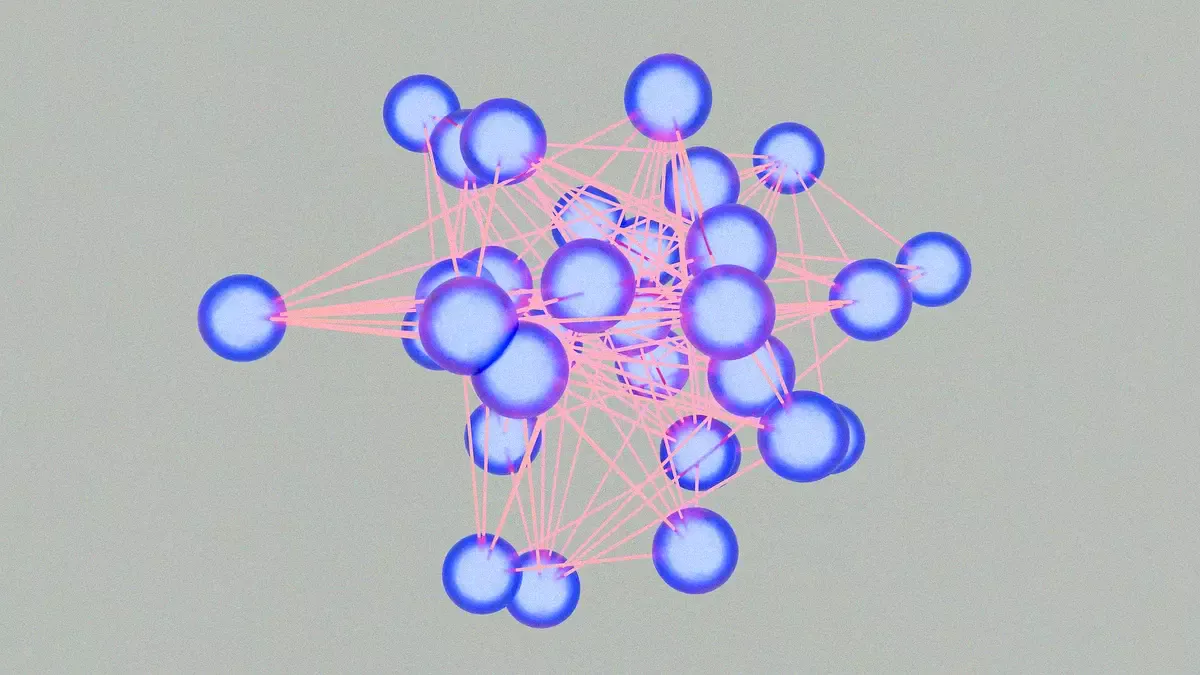
Une recherche sur 10 ans a étudié l’occurrence de pathologies auto-immunes (maladie de Crohn, psoriasis, myasthénie…) chez des individus atteints de maladies liés au stress (Syndrome de stress post-traumatique, choc psychologique, trouble de l’adaptation) comparé à une population témoin assortie (constitué des frères et sœurs et d’individus lambda). Les patients diagnostiqués avec une maladie liée au stress ont développé davantage de maladies auto-immunes que des individus non exposés, le fait que la famille de la population exposée ne présente pas ce même risque montre qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème génétique (Song et al., 2018).
Cependant l’impact négatif du stress chronique sur les maladies auto-immunes ne fait pas l’unanimité. En effet, d’autres études affirment au contraire que le stress a un rôle protecteur sur les maladies autoimmunes. Lorsque des souris transgéniques développant spontanément un diabète de type 1, sont placées en situation de stress chronique (immobilisation ou surpeuplement sur plusieurs semaines), le taux de prévalence de ce diabète diminue. À l’inverse, la suppression des hormones du stress par surrénalectomie augmente le taux de diabétique chez ces souris (Durant et al., 1993).
Stress et cancer
Le stress (perte d’un proche, problème au travail, divorce…) est associé à une plus forte prévalence de certaines tumeurs : cancer colorectal en Australie (Kune et al., 1991), cancer du sein en Finlande (Lillberg et al., 2003).
Une étude expérimentale chez le rat a permis de mettre en évidence l’impact du stress chronique sur l’apparition de tumeur. Les animaux ont reçu un agent carcinogène par injection, puis certains ont été immobilisés plusieurs heures par jour. Le taux d’hépatocarcinome et la taille des lésions hépatiques sont supérieurs chez les animaux qui ont été confinés (Laconi, 2000).
De même, Saul a exposé des rongeurs à un faible taux d’ultraviolet B, trois fois par semaine pendant 10 semaines. Certaines des souris sont également dans une situation de stress chronique (restriction spatiale 4 à 6 semaines). La survenue des tumeurs (carcinome) était plus précoce chez les souris stressées et le taux de lymphocytes protecteurs plus faible (Saul et al., 2005).
Stress et vieillissement
Le stress chronique pourrait être associé au vieillissement prématuré du SI. Au niveau cellulaire, ceci se traduit par exemple par un raccourcissement des télomères, une diminution de l’activité de la télomérase, et une augmentation du stress oxydatif. Pour Robert Barouki, enseignant chercheur de la faculté René Descartes à Paris, « tout se passe comme si on avait un « capital stress » qui, lorsqu’il est épuisé, conduit au vieillissement ». Ainsi, toute condition (environnementale ou génétique) qui augmente l’exposition à des agressions (oxydantes ou non) ou qui diminue les capacités de défenses ou de réparation, devrait se traduire par un vieillissement accéléré (Barouki, 2006).
Stress et inflammation
Le stress augmente la production des cytokines pro-inflammatoires, notamment celle de l’IL-1 et de l’IL-6 par les cellules immunitaires activées (mitogènes, LPS…) in vitro (Stark et al., 2001).
Cette exacerbation des processus inflammatoires pourrait s’expliquer par l’activation des voies du facteur nucléaire B (NFκB) (Bierhaus et al., 2003), par l’augmentation de la réactivité inflammatoire des cellules immunitaires au niveau systémique ou encore la libération locale de CRH par les terminaisons nerveuses périphériques (Elenkov et Chrousos, 1999).
Le stress induit également un état de résistance aux GC (Stark et coll, 2001 ; O’Connor et al., 2003). Chez l’animal par exemple, un stress social chronique ou l’application de chocs électriques diminuent la sensibilité des cellules à l’effet anti-inflammatoire des GC ; ce qui se traduit par un moindre effet inhibiteur de ces hormones sur la production des cytokines inflammatoires et la prolifération des cellules immunitaires (Kiecolt et al., 2002).
Ce phénomène, en plus de n’être pas systématique (il dépend du type cellulaire et du compartiment étudié) reste cependant transitoire (Avitsur et al., 2002).
Les stress physiques et psychologiques peuvent également entraîner des augmentations transitoires des cytokines pro-inflammatoires d’origine non immune, surtout celle de l’IL-6 (Zhou et al., 1993 ; Glaser et Kiecolt, 2005).
Les mécanismes en jeu et l’origine cellulaire de ces cytokines ne sont pas encore élucidés. De même, les conséquences cliniques et physiologiques de cette élévation restent méconnues. D’une part, l’IL-6 est une substance pyrogène : elle pourrait expliquer les phénomènes d’hyperthermies consécutives à un stress. D’autre part, cette cytokine induit la sécrétion des protéines de la phase aiguë de l’inflammation, notamment celle de la protéine C-réactive par les hépatocytes, dont la fonction est de terminer la réponse inflammatoire et de protéger l’organisme contre les effets
négatifs de l’inflammation tels que l’oxydation. L’augmentation concomitante de protéine C-réactive et d’IL-6 pourrait en tout cas expliquer la physiopathologie de certaines maladies liées à l’âge (maladies cardio-vasculaires, ostéoporose, arthrite, diabète de type-2, maladie d’Alzheimer, maladie parodontale..) et certains cancers (leucémies lymphoïdes chroniques, myélome multiple, lymphome non hodgkinien par exemple) (Kiecolt et al., 2003).
L’IL-6 serait même un « marqueur global d’une détérioration imminente de l’état de santé chez les sujets âgés » (Kiecolt et al., 2002).
A l’inverse cependant, le stress diminue la production locale des cytokines pro-inflammatoires au niveau de la peau : on a décrit ce phénomène dans le cadre des processus de cicatrisation. Au final, les effets du stress sur l’inflammation sont relativement disparates : ils dépendent du compartiment de l’organisme auquel on s’intéresse (immunité systémique ou des muqueuses -pulmonaires, digestives ou cutanées), du type cellulaire et de la nature du stress (Kiecolt et al., 2002).
Stress et cicatrisation
Le stress a été identifié comme un cofacteur potentiel pouvant entraver les processus de cicatrisation, dans le cas de blessures ouvertes. Les délais de cicatrisation sont (24 à 40%) plus longs chez des femmes s’occupant de personnes souffrant de démence que chez des femmes non stressées (Kiecolt et al., 1998).
Le stress psychologique et les conséquences délétères du cortisol sur la production locale des cytokines pro-inflammatoires (diminution des taux d’IL-1α et β, IL-8, TGFβ, et TNF) pourraient expliquer ce phénomène. Du coup, plus les patients appréhendent leur opération et sont stressés, plus ils augmentent leur chance de développer des complications post-opératoires, d’être hospitalisés plus longtemps ou de devoir subir une seconde opération chirurgicale (Glaser et Kiecolt, 2005).
Conclusion
La psychoneuro-immunologie ou l’étude des relations entre le plan psychologique, neurologique et immunologique, est un secteur de recherche qui a connu un développement important au cours de la dernière décennie. Elle étudie notamment l’impact de la psyché sur le système immunitaire et indirectement son impact sur le développement des maladies.
L’objectif de notre travail est d’étudier l’effet de stress sur le système immunitaire (innée et adaptive), ainsi que son impact sur le développement des maladies.
Dans notre étude nous avons constaté qu’il existe une relation étroite entre le stress et le réduit de l’efficacité de système de défense immunitaire.
Une étude expérimentale par « Irwin » en 1990 a trouvé une diminution de 50% de l’activité des cellules NK chez les individus souffrant de dépression, aussi d’autres études japonaises montrent que le stress est associé à une baisse de la capacité phagocytaire des neutrophiles chez les hommes âgés, la même observation chez les rats après l’exposition à un stress sonore pendant plusieurs jours diminue la capacité phagocytaire des neutrophiles.
À l’inverse, le stress peut avoir un effet bénéfique pour la santé par la sécrétion des hormones de croissance, la prolactine et l’hormone neurotrophique qui ont un rôle immuno-stimulateur, favoriseraient la prolifération des cellules lymphoïdes, elles stimuleraient ainsi la production d’anticorps, l’activité des cellules NK et maintiendraient l’activité des macrophages.
Cependant, les effets bénéfiques de ces hormones sur le système immunitaire ne sont généralement pas assez puissants pour contrer efficacement les effets immunosuppresseurs des glucocorticoïdes produits massivement lors d’une réponse au stress.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les effets du stress sur le système immunitaire?
L’exposition à un stress chronique a été associée au développement de certaines maladies infectieuses comme la grippe, laissant supposer une immunodépression chez les individus stressés.
Comment le stress influence-t-il les maladies auto-immunes?
Les patients diagnostiqués avec une maladie liée au stress ont développé davantage de maladies auto-immunes que des individus non exposés, montrant que le stress peut avoir un impact négatif sur le système immunitaire.
Le stress est-il lié au développement du cancer?
Le stress est associé à une plus forte prévalence de certaines tumeurs, comme le cancer colorectal et le cancer du sein, et des études expérimentales ont montré que le stress chronique peut influencer l’apparition de tumeurs.