Le cadre théorique sur l’immunité révèle que le stress environnemental peut altérer profondément notre système immunitaire. Comment cette interaction complexe influence-t-elle notre santé ? Découvrez des mécanismes inattendus et des implications cruciales pour notre bien-être.
-Les mécanismes de défense immunitaire
‐ Le système immunitaire inné et adaptatif
Le mécanisme de défense non spécifique, ou inné, est un mécanisme commun à l’ensemble du règne animal alors que le mécanisme de défense spécifique, ou adaptatif, est apparu exclusivement chez les gnathostomes (les vertébrés à mâchoire). Ces deux systèmes agissent en synergie pour neutraliser au mieux le pathogène entrant dans l’organisme. Ainsi, lors de la détection d’un agent pathogène, différents acteurs de la réponse immunitaire vont se mettre en place.
Dans un premier temps vont intervenir les acteurs du SI inné et SI l’immunité innée n’a pas suffi, ce seront les acteurs du SI adaptatif qui interviendront dans un second temps (Topham et Hewitt, 2009).
Tableau 01: Principales fonctions des cellules appartenant au système immunitaire inné.
(Topham et Hewitt, 2009 ; Geissmann et al., 2010).
| Tableau 01: Principales fonctions des cellules appartenant au système immunitaire inné | |
|---|---|
| Cellule | Fonction principale |
| Données à compléter | Données à compléter |
- ‐ Le système immunitaire inné
Le système immunitaire inné est la première ligne de défense de l’organisme contre les agents pathogènes. Il agit de manière immédiate et non spécifique en réponse aux agressions (Turvey et Broide, 2010).
Cette première ligne de défense, très efficace, empêche la plupart des infections de se propager et permet ainsi d’éliminer l’agent infectieux dans les quelques heures qui suivent sa rencontre avec l’organisme (figure 03).
De prime abord, le système immunitaire utilise ses barrières physiques. En effet, le premier obstacle rencontré par les pathogènes sont les barrières anatomiques protectrices de l’hôte. C’est l’exemple de la peau et de la surface des muqueuses qui constituent des barrières efficaces contre l’entrée de la plupart des microorganismes.
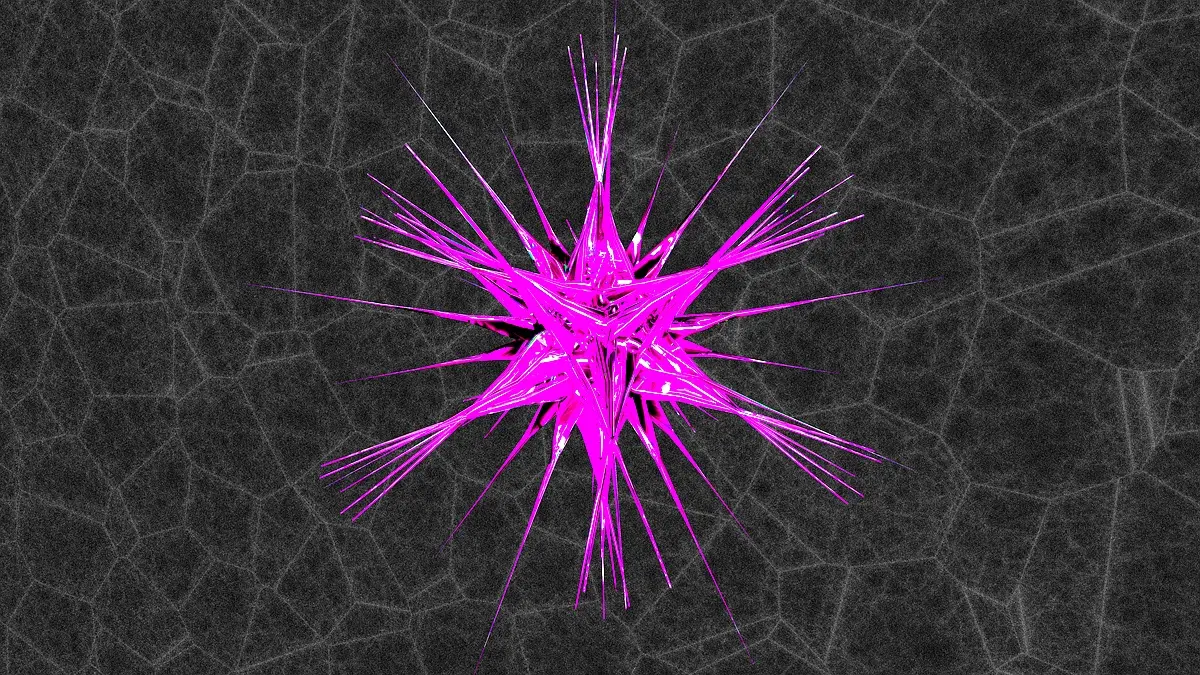
L’acidité de l’estomac et de la transpiration empêche également le développement des organismes incapables de se développer dans des conditions acides. Les enzymes, comme le lysozyme, qui sont présentes dans les larmes peuvent également contribuer à cette défense en altérant la paroi cellulaire de certaines bactéries (Bergereau, 2010).
‐ Le système immunitaire adaptatif
Cependant, il arrive que l’immunité innée ne soit pas suffisante et que le pathogène parvienne à échapper à cette première ligne de défense. Ainsi, afin de reconnaître et d’éliminer cette fois-ci sélectivement les pathogènes, il existe une seconde forme d’immunité, connue sous le nom d’immunité adaptative, dépendante de l’immunité innée, qui se met en place quelques jours après l’infection initiale.
Cette réponse constitue une seconde ligne de défense qui permet d’éliminer les pathogènes qui ont échappé à la réponse innée ou qui persistent malgré cette réponse (figure 03).
Cette réponse adaptative nécessite la communication entre deux populations cellulaires : les lymphocytes et les cellules présentatrices d’antigène (CPA).
Les lymphocytes sont l’un des nombreux types de cellules blanches du sang produites dans la moelle osseuse par le processus de l’hématopoïèse et jouant un rôle important dans cette immunité. Ces lymphocytes quittent la moelle osseuse, circulent dans le sang et les vaisseaux lymphatiques et résident dans différents organes lymphoïdes.
Parce qu’ils produisent et exposent à la surface de leur membrane des récepteurs qui fixent l’antigène, les lymphocytes portent les attributs spécifiquement immunologiques de spécificité, de diversité, de mémoire et de reconnaissance du Soi et du non Soi.
Deux populations de lymphocytes coexistent dans l’organisme : les lymphocytes B (LB), sécréteurs d’anticorps, conduisant à une immunité humorale et les lymphocytes T (LT), schématiquement divisés en cellules auxiliaires et en cellules cytotoxiques, conduisant à une immunité cellulaire.
Les cellules présentatrices d’antigènes, quant à elles, sont en charge de capturer l’antigène et de le présenter aux lymphocytes afin d’initier cette réponse adaptatrice. (Bergereau, 2010).
Ensuite les cellules effectrices et les anticorps produits quittent les organes lymphoïdes vers le site infectieux où, par leurs action coopérées servent à détruire les cellules infectées et éliminer les pathogènes neutralisés par les immunoglobulines en activant le système du complément et par la cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps (Mathieu et al., 2009).
Figure 03: Schéma récapitulatif de la réponse immunitaire innée et adaptative
(Mathieu et al., 2009).
Questions Fréquemment Posées
Quel est le rôle du système immunitaire inné?
Le système immunitaire inné est la première ligne de défense de l’organisme contre les agents pathogènes. Il agit de manière immédiate et non spécifique en réponse aux agressions.
Comment fonctionne le système immunitaire adaptatif?
Le système immunitaire adaptatif se met en place quelques jours après l’infection initiale et nécessite la communication entre les lymphocytes et les cellules présentatrices d’antigène pour reconnaître et éliminer les pathogènes.
Quelles sont les principales cellules du système immunitaire?
Les principales cellules du système immunitaire comprennent les lymphocytes B, qui sécrètent des anticorps, et les lymphocytes T, qui sont divisés en cellules auxiliaires et en cellules cytotoxiques.
Figure 03: Schéma récapitulatif de la réponse immunitaire innée et adaptative(Mathieu et al., 2009).