L’analyse comparative des discours d’Aristide révèle des stratégies discursives inattendues qui transforment notre compréhension de la politique haïtienne. En explorant les discours clés de 1991 à 2004, cette étude met en lumière des relations cruciales entre le discours et le contexte socio-historique, offrant des perspectives inédites sur la crise politique contemporaine.
Chapitre IV – L’ANALYSE DU CORPUS
Dans un premier temps, nous faisons des analyses séquentielles, c’est-à-dire pour chaque discours dans notre corpus. Dans un second temps, l’analyse global du corpus s’échelonne sous l’angle de notre questionnement, ayant pour but d’expliciter les stratégies discursives dont s’est servie Jean-Bertrand Aristide ainsi que sa vision de la politique.
Séction I:
Analyse séquentielle du corpus
Les discours d’investitures
1.1 .1 Le discours d’investiture du 7 février 1991
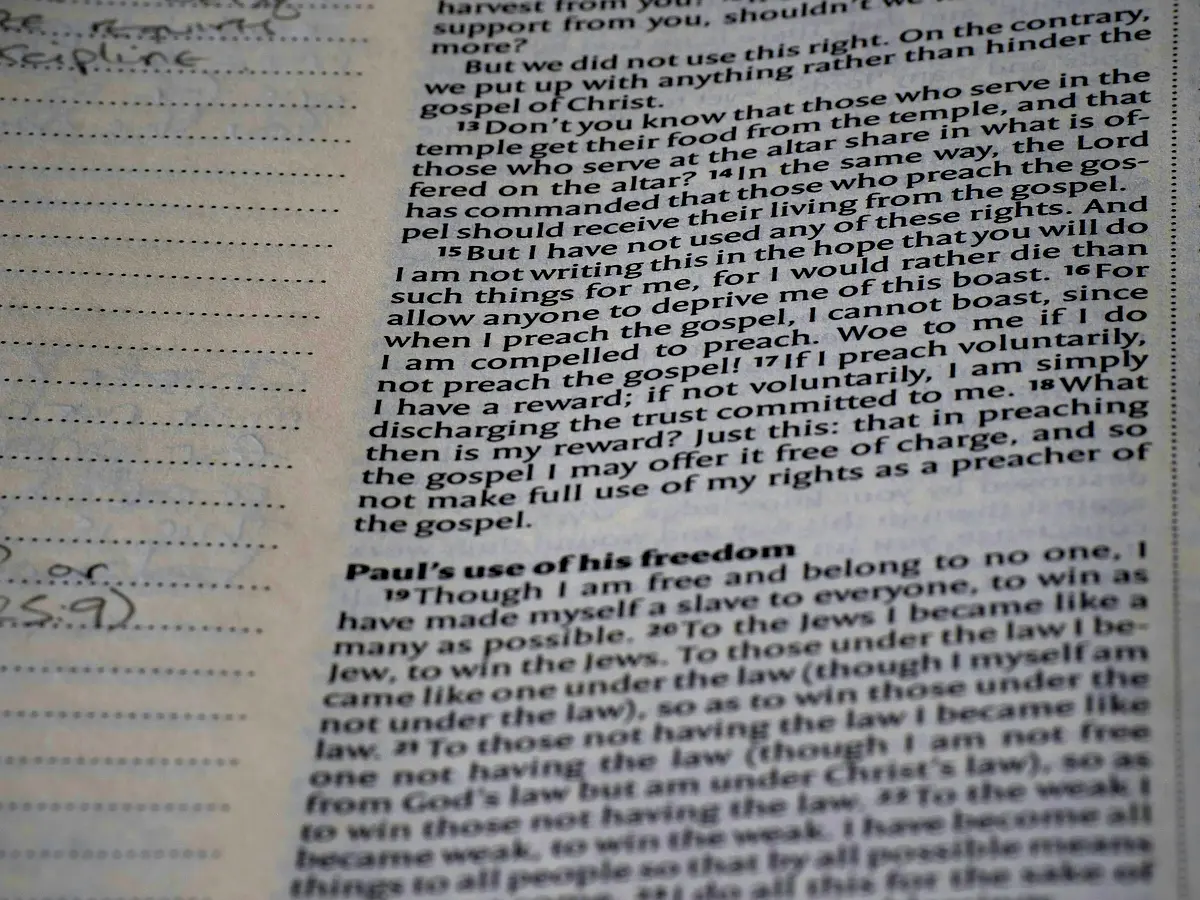
Ce 1er discours officiel de Jean-Bertrand Aristide est marqué par des improvisations, des phrases creuses, un mélange parfois démagogique de plusieurs langues, des expressions idiomatiques, des redondances, des invitations à l’applaudissement et des reprises en chœur à tout bout de champ. Dans un ton propre à lui ; Aristide galvanise la foule.
Il s’exprime grandement en créole, certainement pour marquer une familiarité, une proximité avec le peuple. Sa parole se veut démystificateur, il s’exprime dans la langue du peuple, la langue que parle tous les Haïtiens. Sa victoire électorale est la victoire du peuple, c’est la volonté du peuple s’il est président. Évidemment, le discours de M.
Aristide était le discours à la mode ; la guerre froide vient de terminer, le capitalisme gagne du terrain, et la démocratie est devenue la bonne nouvelle qu’il faut répandre. M. Aristide n’aurait pas été élu président s’il se réclamait du socialisme ou du communisme. Pratiquement, tous les candidats étaient pro démocratie, le peuple vient de voter massivement une nouvelle constitution, dans cette nouvelle constitution, la démocratie est le nouveau système politique choisi par le peuple et dedans le créole est reconnu comme l’une des
deux langues officielles du pays. De plus, les gens étaient disponibles, le peuple était à bout, ils en avaient marre de la transition sanglante des militaires. Et Aristide avait le bon profil : Noir, civil, prête, charismatique, jeune ! le timing était parfait.
« C’est à ce nouveau Carrefour d’histoire que s’assume l’entrer en scène décisive de la force désormais incontournable de la volonté du peuple. C’est à ce nouveau Carrefour d’histoire qu’enfin commence à s’articuler un discours démystificateur de point collectif dénonçant avec les résonnances profondes de la langue que parle et
maitrise le peuple, la langue imposture de la parole voler, interdit à (…) dès le lendemain de l’Independence glorieusement conquise certes mais perfidement escamoter par la suite. Le triomphe (…) du 16 décembre dernier déchire le voile d’enfermement savamment drapper autour de l’isolement du peuple. L’échec du coup d’État Duvaliériste du 7 janvier ainsi que l’investiture 7 février 1991 confirment ce triomphe ».
Il présente sa victoire comme une victoire d’amour, une victoire pour le pays et la démocratie. Les premiers mots de son discours se rapportent à sa famille politique : « Lavalas ». Ce mot est répété vingt (20) fois dans son discours et est utilisé tout au long de son énonciation comme un « fou tout », il met tous ceux qu’il veut dedans.
Il faut dire qu’Aristide n’était pas élu sur la bannière de Lavalas et au moment de l’investiture Lavalas n’était pas un parti politique. Le mot FNCD est prononcé qu’une seule fois. Pourtant, il est élu sur la bannière de FNCD. Les premières phrases de son discours, parlant d’amour sont peut-être tirées de la bible, 1 Corinthiens 13 verset 4 à 7114.
Je cite :
« Nous avons marché, « Lavalasman ». On arrive Lavalasman. Nous allons continuer à nous organiser Lavalasman (Applaudissement). Cet amour de Lavalas va continuer à circuler dans tout le pays
ainsi que dans la diaspora (Applaudissement). C’est dans ce Lavalas d’amour que mon cœur navigue. C’est pourquoi, je ne peux m’empêcher de vous faire cette déclaration d’amour. Ma sœur, je t’aime. Mon frère, je t’aime. Vous qui avez peut-être des doutes, puisque nous ne sommes pas encore rencontrés physiquement, je viens pour vous le dire, car je sais que je t’aime et aujourd’hui ce 7 février 1991 je ne peux m’empêcher, de vous dire, de vous redit, je suis amoureux de vous (Applaudissement).
Je sais que vous amoureux de moi aussi, vous êtes amoureux de notre Haïti chérie. C’est cet amour qui nous emmène là, maintenant, et c’est lui qui nous emmènera dans l’Haïti que nous voulons. L’amour et la démocratie c’est la même chose. L’amour et la justice c’est pareil. L’amour et le respect c’est pareil.
L’amour et la dignité c’est pareil. L’amour et l’union c’est pareil. Que c’est beau l’amour ».
Traduit du créole haïtien
Nul besoin de vous dire que M. Aristide est ancien prêtre catholique romaine. Dans ce 1er discours il ne considère pas son auditoire comme des citoyens ou des compatriotes, mais plutôt des frères et des sœurs. En situation d’énonciation M. Aristide se croit être dans sa paroisse. De plus, il parle de « nettoyage » pour fait référence aux évènements qui ont précédés son investiture.
Dans les faits, ce sont des affrontements sanglants, beaucoup de citoyens haïtiens sont morts pour leur conviction politique. Certainement, comme le souligne Laënnec Hurbon, ceux qui ont été lynchés, assassinés, brûlés vifs c’étaient des anciens partisans du duvaliérisme, couramment appelées « Makout », des Miliciens (VSN : des volontaires pour la Sécurité Nationale) qui étaient au service du régime duvaliériste.
Alors, pour le président fraîchement élu, l’assassinat de ces gens, c’était du nettoyage. Et ce nettoyage comme il dit rend le pays magnifique. Je cite :
« Ma sœur, mon frère, le nettoyage que nous avait fait rend le pays magnifique en attendant que l’organisation « Lavalas » continue ce travail pour le rendre encore plus magnifique. Nous allons continuer à nous organiser « lavalasman » comme nous le savons l’union fait la force. Et si, mains dans la main, nous disons : l’union fait la force. Répète avec moi : l’union fait la force, l’union fait la force. C’est magnifique, c’est merveilleux, l’union fait la force. L’union fait la force et ensemble, ensemble nous sommes « Lavalas », seul on est faible, ensemble on est fort et ensemble on est « Lavalas ». Traduit du créole haïtien.
Vu son passé d’activiste de la gauche radicale, ses discours sont souvent des réponses aux actes de terreur des forces néo-duvaliéristes et de l’armée. Son anti-impérialisme, ses conflits avec le Vatican et le haut clergé, ses critiques acerbes contre la bourgeoisie et la classe politique…
M. Aristide était en croisade, c’était un militant infatigable. Élu président on s’attend que tout
114 L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est pas envieux; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
cela change pour favoriser des changements profonds dans les structures de l’État
« massacreur » qu’avait institué la Dictature. On s’attend que Jean-Bertrand Aristide profite de sa 1ère investiture pour prononcer un discours de rupture, un discours rassembleur, où il se présente comme le président de tous les Haïtiens. Mais non, son 1er discours inquiète et complique la situation de méfiance qui sévit dans le pays. Il dit, je cite :
« Si l’union fait la force, dans un moment ou un autre, les pauvres doivent arrêtés d’enrichir les riches (Applaudissement). Si l’union fait la force, veux ou veux pas, advienne que pourras, les riches
doivent avoir le revers de la médaille ! (Applaudissement) ».
Traduit du créole haïtien
Aristide divise l’opinion publique et l’oligarchie ne va pas tarder à réagir. Dans ses excès, le nouveau président fragilise encore plus les rapports entre les différents Pouvoirs ; économique, politique et militaire. Il ne s’arrête pas, il continue d’agacer et fragiliser encore plus. Devant la foule innombrable massée autour du Palais national, en présence du corps diplomatique, des invités étrangers et du haut commandement de l’armée, le chef de l’État annonce, après avoir parlé de l’amour et du mariage nécessaire entre le peuple et l’armée,
sa décision de révoquer tous les membres de l’état-major, à l’exception du général Hérard Abraham. La tendance autoritaire est manifeste et s’accompagne d’une méfiance arrogante créant une situation de conflit latent entre l’institution militaire et le président. Cet acte s’accompagne d’un autre non moins significatif : la remise, d’une interdiction de départ à l’ancienne présidente provisoire, Mme Ertha Pascal Trouillot, durant la cérémonie de passation de pouvoir, par le commissaire du gouvernement, Monsieur Bayard Vincent.
Au lieu de prendre ses distances face au comportement du commissaire du gouvernement, le président de la République, en guise de récompense, le nomme ministre de la Justice. Ainsi commence à s’affirmer la volonté systématique du pouvoir exécutif d’utiliser l’administration de la justice à des fins de vengeance politique. Telle; la détention illégale de l’ancienne présidente provisoire et de certains juges, ne laissent aucun doute sur le caractère anti-institutionnel et anticonstitutionnel du nouveau régime115.
En effet, les valeurs que partagent une société demeurent bien multiples et évolutives. En cela, les discours ne peuvent se comprendre que dans les pratiques sociales dans lesquelles ils s’inscrivent. Le discours recouvre tout à la fois des idées, des représentations, des
115 JEAN-FRANÇOIS, Hérold, Le coup de Cédras. Une analyse comparative du système socio-politique haïtien de l’indépendance à nos jours, p. 39
connaissances, des valeurs, des croyances, des normes, et ils sont indissociables des locuteurs qui les prononcent116. La stratégie de Jean-Bertrand Aristide est une stratégie de persuasion discursive et phraséologique, le premier consiste en un « parle de soi, à travers l’autre, en parlant du monde ». Le second, c’est l’utilisation de phrases ayant un sens figuré, des particularités structurales et des traits culturels particuliers. Ce 1er discours est fait d’ethos. Le public répète en chœur des phrases simples, faciles à retenir qui ne veulent rien dire concrètement, mais qui amusent tout le monde. Des phrases passe-partout.
« Seul on est faible, ensemble on est fort, ensemble on est Lavalas (Applaudissement) ».
Traduit du créole haïtien
On a l’impression d’assister au carnaval national. De plus, Aristide s’est arrangé pour inspirer à son auditoire confiance et crédibilité, c’est un ancien prêtre catholique, culturellement les haïtiens témoignent du respect aux prêtres et à l’église en général. Les hommes d’église sont des hommes de Dieu, donc, ce ne sont pas des menteurs.
Il parvient à susciter l’émotion de son auditoire, montrer sa crédibilité et son intelligence en jouant sur des cordes symboliques et culturels. En laissant croire qu’il parle plusieurs langues, qu’il est savant et connaissant bien l’histoire du pays. Ainsi, il acquiert sa légitimité et tente d’assoir son pouvoir par son ethos et non pas par la force de ses arguments politiques et / ou un programme politique.
Comme le signale D. Maingueneau, dans la stratégie de persuasion « Ce que l’orateur prétend être, il le donne à entendre et à voir : il ne dit pas qu’il est simple et honnête, il le montre à travers sa manière de s’exprimer. En cela, Aristide est un bon artisan de son art.
En ce sens, la finalité du discours Aristidien tourne autour de la personne d’Aristide. Puisque l’ethos est attaché à l’exercice de la parole, c’est-à-dire le locuteur en situation d’énonciation, et non à l’individu
« réel », appréhendé indépendamment de sa prestation oratoire117. L’ethos et le charisme sont utiles en politique, mais sont-ils suffisants ?
Au moment de sa 1ere campagne électorale, il parcourt le pays, et se fait orateur infatigable, convaincant. Il propose de passer de « la misère indigne à la pauvreté digne », désireux de rendre le pouvoir au peuple. Aux médias internationaux, il parle de « démocratie sociale », de
116 P. Charaudeau. Le discours politique ; les masques du pouvoir, p.12-16.
117 Woerther Frédérique. Aux origines de la notion rhétorique d’èthos. In: Revue des Études Grecques, tome 118, Janvier-juin 2005. pp. 79-116; p.95
« théologie de la libération ». On le présente en osmose avec le petit peuple, certainement à juste titre. Il promet à tous « la justice », dans un sens double : à la fois l’égalité sociale et un programme en direction des plus faibles, mais aussi la fin de l’impunité pour les anciens tortionnaires, duvaliéristes ou militaires.
Il promet aussi la « transparence » : une gestion démocratique du pays, la fin de la corruption, la liberté de parole. Enfin, il parachève son triptyque par le mot « participation », en promettant une démocratie réelle. Il est indéniable que la clef de l’accession au pouvoir d’Aristide est l’appui populaire massif dont il a bénéficié en 1990.
Celui-ci s’est construit rapidement. La radicalité de son discours contre la dictature, puis contre les gouvernements militaires, la simplicité de ses propos vis-à-vis du peuple, la sincérité perçue de son discours par les masses ainsi qu’un contexte très favorable, l’ont conduit à prendre la direction du pays. Il apparaît alors aux yeux de nombreux comme l’ultime Espoir.
Toutefois, jeune (38), sans expérience politique, sans programme politique solidement constitué, gouverner un pays après 29 ans de dictature est loin d’être simple. L’héritage est lourd ! Il faut préciser ; toutes les structures de l’ancien régime étaient là. Si bien que, moins d’un mois avant son investiture, le 7 janvier 1991, un groupe de putschistes ayant à leur tête Roger L’affrontant, ancien ministre de l’Intérieur et de la Défense Nationale sur la dictature de Jean-Claude Duvalier, a pris le palais national et forcé
la Présidente provisoire, Ertha Pascal Trouillot à lire un message dans lequel elle déclare démissionner. Les partisans du président nouvellement élu envahissent les rues de la capitale, la FAD’H à intervenir et arrêter Roger Lafontant. Ce dernier fut assassiné dans sa cellule au pénitencier national dans la nuit du 30 septembre 1991, soir du coup d’état militaire qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide.
Le président est contraint de partir en exil au Venezuela puis aux États-Unis.
Le discours Aristidien s’enlise très vite dans une forme de désuétude puisque la parole – pensée, dans son sens rhétorique le logos (la logique et la rationalité) laisse trop de place à l’improvisation et l’émotion.
Ainsi, nous sommes d’accord pour dire, dans ce 1er discours la stratégie discursive de M. Aristide est une stratégie d’éthique, de phraséologie et de persuasion discursive qui relèvent de l’éthos au sens de la rhétorique Aristotélicienne. En effet, chez Aristote, la stratégie éthique consiste à se montrer sous un jour favorable ; le locuteur doit chercher à plaire à son auditoire et doit chercher à transférer la confiance que l’auditoire lui accorde, sur le propos qu’il défend118. Aristide met en question son salaire, il estime qu’on lui paye trop dans un pays qui
118 Aristote, Rhétorique I, 1356a, [1932], pp. 76-77, Les Belles Lettres cité dans https://journals.openedition.org/corpus/357 , p. 4.
a tant de misères et de difficultés économiques. Cette stratégie lui réussit bien, car l’existence d’une morale commune (doxa) permet à l’orateur d’incarner dans son discours les vertus qui inspirent la confiance publique.
Évidemment, si Aristide arrive à prendre le pouvoir par le discours, c’est-à-dire influencer l’univers de croyances et de représentations, persuader et rallier bon nombre de citoyens à sa cause, il n’arrive pas à le maintenir par le discours.
Questions Fréquemment Posées
Quel est le thème principal du discours d’investiture de Jean-Bertrand Aristide du 7 février 1991?
Le discours d’investiture de Jean-Bertrand Aristide est marqué par des improvisations, un mélange démagogique de plusieurs langues, et il se veut démystificateur, exprimé en créole pour établir une proximité avec le peuple.
Comment Jean-Bertrand Aristide présente-t-il sa victoire électorale?
Aristide présente sa victoire comme une victoire d’amour, une victoire pour le pays et la démocratie, affirmant que c’est la volonté du peuple qui l’a porté à la présidence.
Quelle est l’importance du mot ‘Lavalas’ dans le discours d’Aristide?
Le mot ‘Lavalas’ est répété vingt fois dans son discours et est utilisé comme un ‘fou tout’, englobant tous ceux qu’il souhaite inclure, bien qu’il n’ait pas été élu sous cette bannière.