Quels sont les véritables défis et solutions en Haïti ? Cette analyse sémantique des discours de Jean-Bertrand Aristide révèle des stratégies discursives inattendues, éclairant les relations complexes entre le langage et le contexte socio-politique, tout en offrant des perspectives cruciales sur la crise politique actuelle.
Chapitre 2
Le chapitre II, définit notre approche théorique : la socio sémiotique. D’abord, nous définissons les fondements. Le chapitre se termine par des éléments spécifiques dans l’univers symbolique et culturel du peuple haïtien à savoir.
Section 1 : L’approche socio sémiotique dans le contexte haïtien
La socio sémiotique
Inspirée du signe tel que défini par Saussure70 ou Peirce,71 constitué d’un signifiant et d’un signifié et tenant compte non pas de l’arbitraire du signe (et sa réalité objective) mais plutôt de la multiplicité des points de vue et de « l’essence double du langage » comme énoncé par Maigret (2003, p. 107), la sémiotique permet d’étudier tout système de signes et tous les éléments qui s’inscrivent et entourent un discours.
Définie par Umberto Eco (1980, p. 30) comme « La discipline qui étudie la sémiose », la socio sémiotique est envisagée par l’auteur dans sa versatilité et son appréciation de certaines formes de culture de masse72.
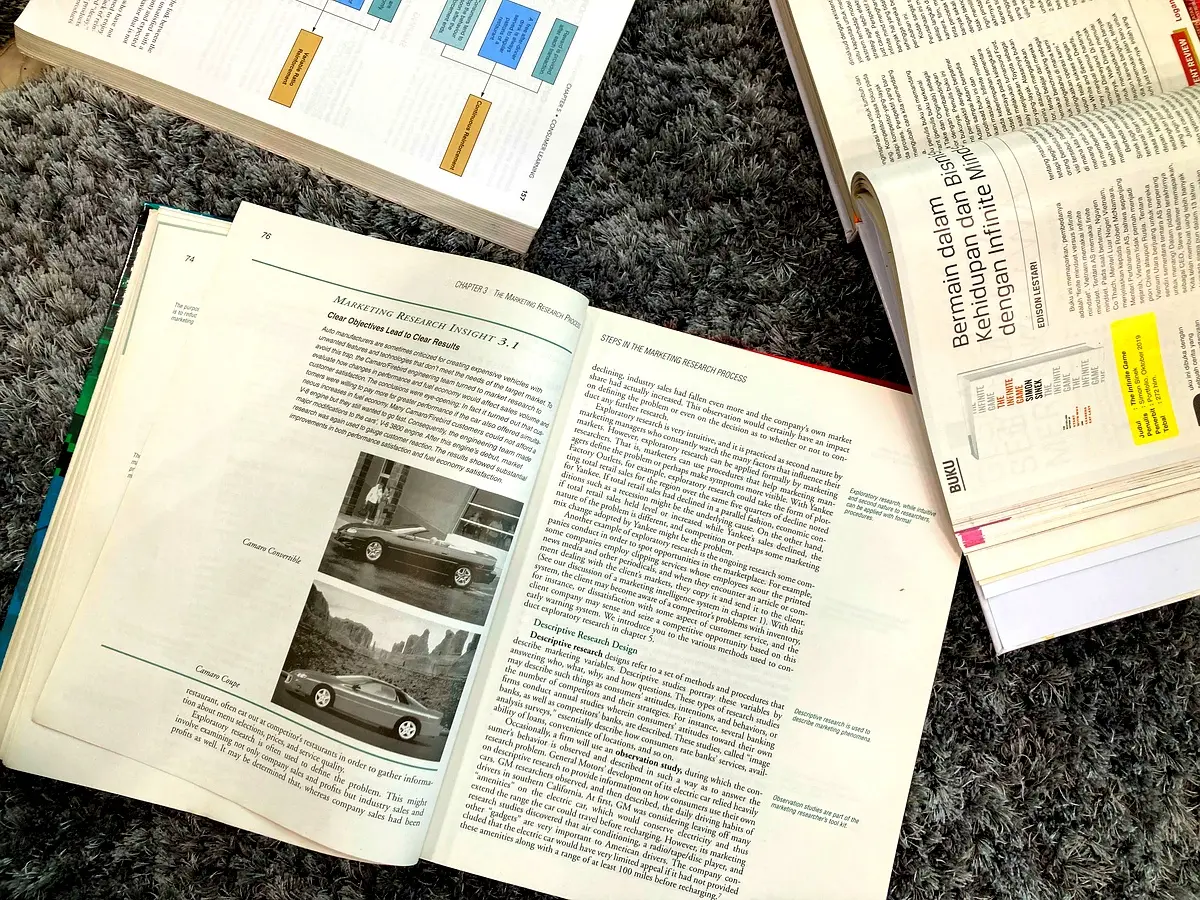
Considérant la sémiotique comme applicable à l’ensemble des discours et des signes, Éco souligne l’importance de la culture dans la compréhension et l’interprétation de ces signes. Notre représentation et notre connaissance du monde se construit, d’après l’auteur, par le biais d’une culture et d’un code linguistique commun73.
Ayant pour corpus des discours politique, il nous semble important de souligner l’importance d’une approche ancrée dans différentes disciplines des sciences humaines et tenant compte d’un contexte socio-culturel bien précis.
Définie par Veron (1983, p. 100) comme la « théorie des discours sociaux », la socio sémiotique « trouve son point de départ dans les discours sociaux tels qu’il se donnent à l’expérience, et est obligée d’affronter le fait que ceux-ci sont toujours des « paquets » constitués par des matières signifiantes hétérogènes ».
L’approche socio sémiotique tient compte du contexte de production, du discours mais également de la mise en scène. Cette ouverture sur l’ensemble des indices porteurs de sens, qu’ils soient sociologiques, linguistiques, communicationnels, culturels ou visuels nous est particulièrement évocatrice et est en adéquation avec notre corpus.
Le contexte de production et ses aspects culturels ou sociaux, sont autant d’éléments à prendre en compte, dans le cadre d’une analyse socio sémiotique.
La théorie du signe-fonction de Umberto Eco.
La théorie du signes- fonctions développée par U. Eco rejoint la conception de J. Derrida, selon laquelle il y a absence de signifié transcendantal (un seul signifié, un seul contenu, absolu, par signifiant, par forme du signe), mais plutôt une chaîne de signifiant à signifiant, infinie, s’apparentant à la sémiosis illimitée de Peirce (« aussitôt qu’un signe […] a atteint le niveau de l’interprétant, il est prêt […] à devenir le ground d’un nouveau signe » (Fisette, 1990 :16)).
Dans le sillage de ces deux théoriciens, la théorie met l’accent sur la non-univocité de la signification du signe et parlera, à cet effet, de signe-fonction. Umberto Eco aborde l’univers sémiotique non comme étant composé de signes, mais bien de fonctions sémiotiques (signes- fonctions).
En regard des triades de Peirce, il élabore donc une sémiotique non référentielle : les expressions utilisées peuvent être pour se référer aux choses ou aux états du monde, mais renvoient à la culture et aux contenus élaborés par une culture.
Un signe (signe-fonction) ne correspond plus à un référent précis et figé (c’était le cas avec le signe linguistique), mais peut revêtir plusieurs significations, peut désigner différentes réalités en regard du contexte socioculturel. Le « signe » déborde le simple signe linguistique (ex. : le panneau d’arrêt n’est pas un signe linguistique, les nuages non plus, etc.).
Il propose plutôt une représentation du signe comme inférence et système d’instructions contextuelles, c’est-à-dire que « le signe est une instruction pour l’interprétation 74 » (1988 [1984], p.33). « Néanmoins, une donnée sensorielle, même médiate par une empreinte, une trace, une réduction de dimensions, reste un signe à interpréter75 » (Eco, 1975, p6).
La socio-sémiotique interactionnelle de Éric Landowski
L’approche socio-sémiotique de l’interaction développée par Éric Landowski au début des années 80 ne déroge pas à une règle socio-sémiotique cardinale : le sens ne peut pas qu’être immanent et n’est donné, a priori, qu’à partir d’un « modèle canonique » figé et standardisé à mobiliser devant tous les cas d’étude. Il n’y a donc pas ideal-type (Max Weber) Il est donc une construction qui réalise à partir d’un regard qui pose pour base le questionnement et ré- questionnement de la circulation discursive dans le social ou en de termes plus constitués de la rencontre d’une instance productrice avec une (des) instance(s) sociale(s) qui permettent de dégager le sens d’un discours (ou d’une pratique sociale).
Pour Éric Landowski (2004 : 15-16) dans son ouvrage intitulé : Passions sans nom : essai de socio-sémiotique III, « comprendre ce n’est pas découvrir un sens déjà tout fait, c’est au contraire le constituer à partir du donné manifeste (d’ordre textuel ou autre), souvent le négocier, toujours le construire ».
.4 La socio sémiotique discursive et énonciative de Andrea Semprini
Le courant socio sémiotique considère les textes comme des produits de la société qui nécessite de les réinscrire dans sa rencontre avec le social afin de décrypter comment ils font sens. Il faut dès lors rompre avec la fameuse formule d’Agiras Julien Greimas, « Hors du texte, point de salut ! ».
La perspective socio sémiotique dite discursive s’est développée avec notamment Andrea Semprini. Dans son livre : Analyser la communication 2. Comment analyser la communication dans son contexte socioculturel76, il écrit : « En réalité, les textes ne sont pas donnés en nature, ce sont des produits humains et sociaux et justement pour pouvoir les analyser correctement, il devient important de porter son attention, de tourner son regard, qui sera alors socio sémiotique, vers l’activité de textualisation, ou bien vers l’ensemble des pratiques, sociales ou individuelles, qui conduisent à la définition d’un texte, de ses limites, et également de ses modalités de circulation et de réception ».
En effet, la saisie d’un texte, compris dans son sens le plus large à savoir tous les langages de signe et de signification, est ici appréhendée comme un produit culturel qui commande non pas d’oublier sa dimension véritablement textualiste, c’est-à-dire narrative et discursive, mais de la potentialiser pour envisager sa compréhension dans une perspective de sa prise en charge par un dispositif social.
________________________
70 De Saussure, F. (1913) 1972. Cours de linguistique générale. Paris, Éditions Payot ↑
71 Peirce, Ch. S. (1978). Écrits sur le signe (rassemblés, traduits et commentés par G. Deledalle ), Paris, Seuil ↑
72 Éric Maigret cite Umberto Eco dans son ouvrage intitulé «Sociologie de la communication et des médias» (2003, p. 108) pour définir le cadre sociosémiotique. ↑
73 Eco, U. (1980, p. 30). « Il tente de donner un nom à des stimuli imprécis : en les dénommant, il les culturalise, c’est à dire qu’il range ce qui jusque-là n’était qu’un ensemble de phénomènes naturels sous des rubriques précises et codifiées» Cette notion fait référence à une langue partagée par l’ensemble d’une communauté et les connaissances communes qu’elle génère. ↑
74 ECO, U. (1988) [1984], Sémiotique et philosophie du langage, Paris, Presses universitaires de France. ↑
75 ECO, U. (1992) [1975], La production des signes, Paris, Livre de Poche. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que l’approche socio-sémiotique dans le contexte haïtien?
L’approche socio-sémiotique est une méthode qui étudie les systèmes de signes et les éléments entourant un discours, tenant compte du contexte de production et des aspects culturels ou sociaux.
Comment la théorie du signe-fonction d’Umberto Eco s’applique-t-elle à l’analyse des discours?
La théorie du signe-fonction d’Umberto Eco met l’accent sur la non-univocité de la signification du signe, considérant les signes comme des fonctions sémiotiques qui peuvent revêtir plusieurs significations selon le contexte socioculturel.
Pourquoi est-il important d’analyser les discours politiques en Haïti?
Analyser les discours politiques en Haïti permet de comprendre les relations entre les discours et les contextes socio-historiques de production, ainsi que d’explorer les facteurs expliquant la faiblesse de l’État haïtien.