L’innovation linguistique et discours de Jean-Bertrand Aristide révèle des stratégies inattendues qui redéfinissent notre compréhension de la crise politique haïtienne. Cette analyse sémantique, ancrée dans un cadre socio-sémiotique, met en lumière les relations complexes entre discours et contexte, offrant des perspectives cruciales pour la démocratisation en Haïti.
La théorie sémantique historico-descriptive de Tullio De Mauro
La thèse de l’historicité radicale de la langue traverse la réflexion de Tullio De Mauro. Ce dernier est l’un des premiers linguistes européens qui développe l’héritage saussurien quant à l’inscription historique du fait linguistique. Dès ses premiers traités de sémantique – Introduzione alla semantica (1965, trad. fr. 1969) et Senso e Significato (1971) –
De Mauro fait valoir la nécessité d’étudier la langue dans son articulation avec les deux facteurs qui lui sont coextensifs : le temps et la masse parlante. Dans le troisième cours de linguistique générale de 1910-1911, Saussure expliquait que la combinaison de ces facteurs détermine le caractère sémiologique de la langue.
Temps et masse parlante permettent de distinguer cette dernière de la simple convention et en font une institution sans analogue dont la modalité d’existence est la transmission, entendue comme héritage que les communautés linguistiques reçoivent par le biais de la tradition. La temporalité est dès lors la dimension au sein de laquelle la langue se crée à travers les usages de la collectivité, et c’est pour cela que Saussure considère temps et masse parlante comme des facteurs internes de la langue (ELG, p. 290), ce qui est une prérogative des langues historico-naturelles.
De Mauro (1974, p. 58) reconnaît ici un troisième principe de la théorie saussurienne après l’arbitraire du signe linguistique et la linéarité du signifiant. Cette reconnaissance de l’historicité54 radicale d’un état
52 Sème : Trace doter de sens.
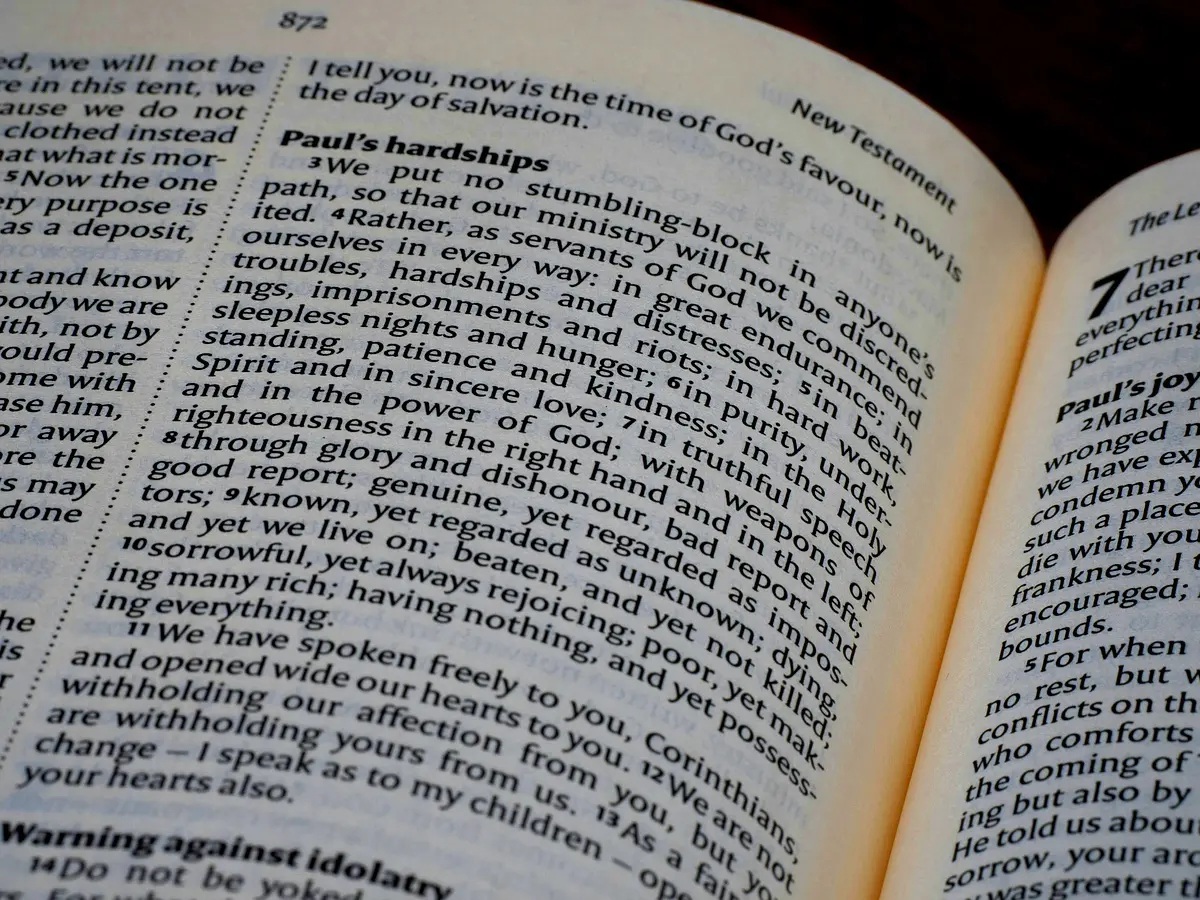
53 Champagnol, R. (1993). Théories des traits sémantiques. Dans : R. Champagnol, Signification du langage (pp. 157-168). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.
54 E. Coseriu (2001, en ligne) énumère l’historicité parmi les universaux secondaires du langage : « Le langage est caractérisé par cinq universaux parmi lesquels on distingue trois universaux primaires : créativité, sémanticité, altérité et deux universaux secondaires ou dérivés : historicité et matérialité. […] L’historicité résulte de la créativité et de l’altérité. Elle signifie que la technique de l’activité linguistique se
de langue comporte une dissociation nécessaire des notions d’histoire et de diachronie. Dans son introduction au Cours de linguistique générale (1967), De Mauro thématise explicitement le principe de l’historicité du fait linguistique : « Un état de langue est historique, non pas parce qu’il “se développe”, mais parce que les motivations qui le soutiennent sont de caractère contingent, temporellement et socialement déterminé » (Introduction, CLG/D 2005 [1916 ; 1922], p. xiv).
Loin de la nier, cette conception de l’histoire inclut la diachronie, entendue comme une succession de contingences qui créent la langue à travers l’exercice de la parole. Tirant toutes les conséquences des thèses saussuriennes, De Mauro s’attache à démontrer et à documenter comment la temporalité traverse la langue.
Querelle épistémologique : Pour et contre l’analyse sémique
La méthode structurale de l’analyse sémique fait débat dans la linguistique européenne des années 1960-1970. Au XIVe Congrès international de Philologie et Linguistique romane (Naples, 1974), Tullio De Mauro et le romaniste suisse Gerold Hilty (1927-2014) sont appelés à réfléchir à l’état des études sémantiques. Leurs communications, intitulées respectivement « Stato attuale della semantica » et « L’état actuel de la sémantique dans le domaine roman », sont suivies d’un débat auquel prennent part, entre autres, Eugenio Coseriu et Bernard Pottier.
De Mauro pose des questions principielles sur la possibilité d’une analyse du contenu. Après avoir fait état du dégel des rapports entre logiciens et linguistes, il relativise l’hypothèque que les formalismes exercent sur la saisie de la signification en langue naturelle, le formalisme étant l’expression du régime de scientificité des sciences humaines au XXe siècle.
Il constate que la construction théorique de la logique des classes dans la représentation des signifiés traverse les théories modernes, de Jerrold Katz et Jerry Fodor pour la tradition américaine, à Louis Hjelmslev, Luis Jorge Prieto et Eugenio Coseriu pour la linguistique d’expression européenne. La question qu’il pose concerne dès lors la réductibilité de la substance du contenu à un calcul, autrement dit l’analysabilité de la substance du contenu en unités distinctives minimales, approche commune aux sémantiques structurale européenne et générative américaine.
De Mauro (1978, p. 110) se démarque de Coseriu qui considère les traits pertinents comme étant entièrement calculables et argumente, pour sa part, qu’il existe toute
présente toujours sous la forme de systèmes traditionnels propres à des communautés historiques, systèmes qu’on appelle langues : ce qui se crée dans le langage se crée toujours dans une langue. »
une série de propriétés des langues naturelles (redondance, correptio, autonymie, antanaclase ou énantiosémie, fonction-listage, créativité) qui semblent incompatibles avec l’hypothèse de la calculabilité syntaxique et sémantique d’une langue. La langue serait tout au plus « une drôle d’arithmétique » parce que le statut de l’erreur linguistique n’a pas la même portée invalidante qu’en arithmétique (ibid., p. 113).
Si l’on arrive à se comprendre, c’est grâce au dispositif de l’« imitation coutumière » (imitazione consuetudinaria) mis en avant par Leonard Bloomfield, et à la capacité de maîtrise créative de l’extensibilité des signifiés, qui avait été valorisée par Benedetto Croce (p. 116).
De son côté, Hilty développe une théorie sémantique syntagmatique en guise de correctif aux sémantiques structurales européennes de type paradigmatique, comme celles de Pottier, Coseriu et plus tard Kurt Baldinger (1977 [1970], trad. fr. 1984). Il y relève deux dangers : la confusion entre sèmes et traits extralinguistiques et l’incomplétude intrinsèque de la méthode paradigmatique, qui n’est pas en mesure de décrire tous les sèmes d’un sémantème.
Hilty propose un modèle d’analyse sémique à partir de l’exemple du verbe voler, dont il dégage les traits d’après une analyse syntagmatique comprenant huit phrases55. De toute évidence, il surestime la valeur de découverte de la méthode syntagmatique la croyant capable d’étudier « le sémantème dans tous les emplois possibles » (1978, p. 123)56.
De surcroît, il rattache cette méthode à l’approche des dictionnaires et leur attribue en quelque sorte la responsabilité de la réussite de l’analyse sémique :
Au fond, elle est à la base de tout bon dictionnaire. Les différentes acceptions d’un mot correspondent, en principe, à des sémèmes du sémantème analysé. Cette méthode est employée […] surtout par la grammaire générative-transformationnelle, depuis le fameux article de
J. J. Katz et J. A. Fodor […] publié en 1963. On a reproché aux auteurs d’avoir « distillé » leurs semantic markers et distinguishers à partir d’un dictionnaire. Le reproche n’est justifié que dans la mesure où le dictionnaire utilisé est mauvais. S’il est bon, il réalise […] une bonne partie du travail à faire dans l’analyse syntagmatique. Le problème n’est donc pas de savoir si on peut utiliser des dictionnaires, mais de vérifier si dans un dictionnaire donné se trouve réalisée, d’une façon valable, une partie de l’analyse syntagmatique. (Ibid.)
55 Les phrases considérées sont : un oiseau vole ; un avion vole ; ce pilote a cessé de voler ; il paraît que nous volons à haute altitude ; une flèche (pierre, balle) vole ; le vent fait voler les flocons (la poussière) ; son petit cheval volait ; elle volait d’un bout à l’autre ; le temps vole ; la nouvelle volait de bouche en bouche.
56 Lors du débat E. Coseriu ne manque pas de relever cette aporie, voir Hilty 1978, p. 131.
Dans la discussion qui s’en suit, Pottier reconnaît que « tout est paradigmatique et syntagmatique à la fois » et, dans la continuité de son article de 1965, il objecte que l’« on ne fait pas de la sémantique à partir d’un mot de dictionnaire » (ibid., p. 136). Quant à la possibilité de réaliser une typologie de sèmes, Hilty avance que ceux-ci s’organisent « dans une structure hiérarchique dont la représentation en diagramme arborescent est la plus adéquate » (p. 127), et dans le sillage de Coseriu, il range la notion de sème parmi les universaux du langage.
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
54 E. Coseriu (2001, en ligne) énumère l’historicité parmi les universaux secondaires du langage : « Le langage est caractérisé par cinq universaux parmi lesquels on distingue trois universaux primaires : créativité, sémanticité, altérité et deux universaux secondaires ou dérivés : historicité et matérialité. […] L’historicité résulte de la créativité et de l’altérité. Elle signifie que la technique de l’activité linguistique se ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment l’innovation linguistique influence-t-elle les discours d’Aristide ?
L’innovation linguistique façonne les discours d’Aristide en intégrant des éléments historiques et sociaux qui reflètent le contexte de la langue.
Quelle est la contribution de Tullio De Mauro à l’analyse sémantique ?
Tullio De Mauro développe l’héritage saussurien en soulignant l’importance de l’historicité et de la temporalité dans l’étude de la langue.
Quels discours d’Aristide sont analysés dans l’étude ?
L’étude analyse cinq discours clés, dont deux discours d’investiture et deux discours aux Nations Unies.