Les stratégies de mise en œuvre des discours de Jean-Bertrand Aristide révèlent des dynamiques inattendues au sein du contexte socio-politique haïtien. Cette analyse sémantique offre des perspectives cruciales sur la crise politique contemporaine, transformant notre compréhension des enjeux de la démocratisation en Haïti.
Partie 1 – ÉLÉMENTS THÉORICO-CONCEPTUELS
Cette première partie est divisé en deux chapitres, dont chacun est divisé en deux sections. Nous débuterons par des rappels théoriques autours de la sémantique et des éléments conceptuels que nous serons amenés à utilisés dans ce travail.
Chapitre 1 : Éléments théoriques autours de la sémantique
Section 1 :
La sémantique
Dans les années 1950 on assiste en France et en Europe à un renouveau d’intérêt pour la sémantique historique, et ce malgré le désaveu saussurien vis-à-vis de la discipline mise à l’honneur par Michel Bréal. Plus tard, en rupture avec la doctrine structurale, les approches cognitivistes des années 1970-1980 marqueront un retour aux positions de la sémantique diachronique et à son caractère herméneutique et psychologique, l’histoire des mots étant expliquée dans ces modèles à partir du procédé cognitif de l’association d’idées. Ce retour ne doit pourtant pas dissimuler les différences substantielles qu’il existe entre les deux approches.
La sémantique historique qui se développe au XXe siècle garde l’empreinte sémasiologique qui avait marqué les débuts de la discipline en France et en Allemagne. Néanmoins, une évolution s’est produite depuis ses origines. Comme l’a montré Brigitte Nerlich (1992), entre 1830 et 1930, les études sémantiques élargissent leur regard aux facteurs culturels du changement linguistique.
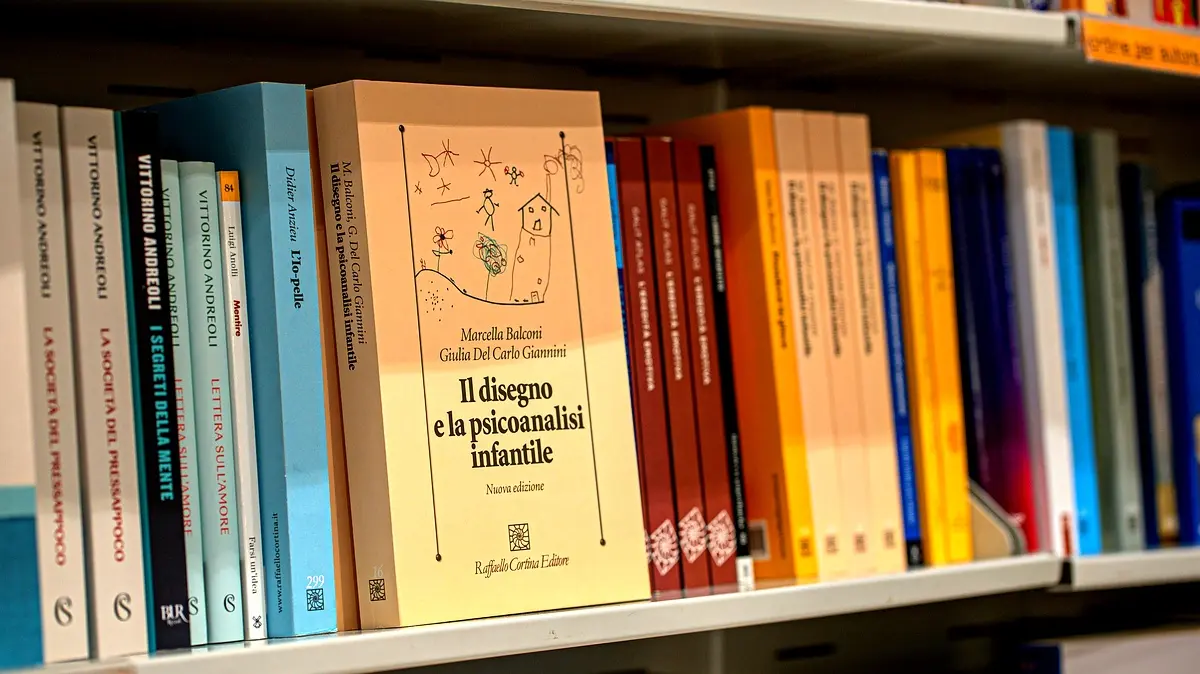
La discipline ne vise plus à étudier les lois du changement sémantique calquées sur les lois phonétiques. En raison de la découverte de l’impact des phénomènes sociaux mis en avant par Antoine Meillet, elle emprunte une voie manifestement extralinguistique. Le changement sémantique est dès lors relié au changement socio-culturel, le sens des mots reflétant toujours des structures sociales données.
Les recherches de Leo Spitzer (1887-1960) vont dans cette direction. Le philologue autrichien souligne l’influence de l’arrière-fond culturel dans les transformations sémantiques51. Son approche se détache autant de l’histoire des idées à cause de l’excès d’intellectualisme de celle-ci que de l’histoire de l’esprit (Geistesgeschichte) par son excès d’irrationalisme ( Neubauer 2004 et Hülzer-Vogt 1993).
Par-delà la variété de ses recherches, son affiliation au domaine de la sémantique historique est affirmée dans le titre de l’ouvrage Essays in Historical Semantics (1948), dont le principe est que le sens est le baromètre le plus sensible du climat culturel. Aussi regrette-t-il l’absence d’un « macro- dictionnaire historique européen » (« European historical super-dictionary ») (p. 11), la sémantique historique étant pour Spitzer une combinaison particulière de lexicographie et d’histoire des idées (Welleck dans Spitzer 1963, p. VI).
À la fin des années 1970, une sémantique historique d’inspiration onomasiologique se trouve confortée par l’approche de Reinhart Koselleck (1923-2006), épistémologue de l’histoire et historien des concepts (Begriffsgeschichte). La sémantique historique de Koselleck s’intéresse à l’interpénétration constante entre langue et société et au décalage entre les usages actuels et passés d’un même concept.
Selon l’historien allemand, les concepts politiques et sociaux changent de sens et acquièrent un statut normatif car loin de se limiter à décrire les événements, ils ont tendance à les influencer. Ils cessent dès lors d’être tournés uniquement vers le passé pour s’ouvrir au futur. L’histoire des concepts de Koselleck n’est pas une étude purement linguistique, il s’agit plutôt d’une étude des concepts examinés dans leur contexte social et historique.
Le même intérêt pour les aspects socio-historiques de la signification marque l’œuvre de Tullio De Mauro, figure de proue de l’école romaine de linguistique. Dès ses premiers traités de sémantique, il propose une approche de nature historico-empirique qui étudie les sens des mots à la lumière de la stratification socio-culturelle, complexe et instable, des sociétés qui l’emploient.
Dans Senso e Significato (1971, p. 7), tout en regrettant la marginalité des études sémantiques, il remarque cependant un changement d’ambiance par rapport au début des années 1960 alors qu’il était encore question de revendiquer la légitimité de la sémantique au sein de la science du langage. De Mauro réagit à la provocation d’André Martinet formulée dans des Éléments de linguistique générale (1960) intitulé « Éliminer le sens ? ».
Sans défendre des positions extrêmes, Martinet émettait des réserves à propos de la question posée. De Mauro (1971, p. 68) y répond, au contraire, de manière résolument négative, la question des unités significatives ayant un rôle central dans le programme de la linguistique générale et historico-descriptive (ibid., p. 72).
Or si les études de sémantique historique se poursuivent, elles subissent l’ostracisme du courant dominant qu’est le structuralisme phonologique pragois, élaboré par Nikolai S. Troubetzkoy (1890-1938) dans Grundzüge der Phonologie (1939, trad. fr. Principes de Phonologie, Klincksieck, 1949). Parallèlement, les tentatives de sémantique structurale cherchent à appliquer à la série des signifiés d’une langue la notion de trait pertinent utilisée avec succès en phonologie et qui est la seule manière pour les structuralistes de créditer la signification comme objet d’étude.
Or la transposition de cette méthode, efficace en phonologie, ne fait que donner un « air de science » (De Mauro 1971, p. 8) à une sémantique structurale qui n’a aucun intérêt scientifique et qui « semble traduire le sentiment de jalousie […] que beaucoup de sémanticiens nourrissent à l’égard des phonologues » (Matoré 1973 [1953], p. XIX). Algirdas J. Greimas (2002 [1966], p. 8) convient, quant à lui, de la nécessité de ne pas déplaire aux logiciens et aux mathématiciens « qui constituent un groupe de soutien et de pression dont la linguistique ne peut pas ne pas tenir compte ». Chez les partisans d’une approche historique, il s’agit, au contraire, de mobiliser les ressources de la langue elle-même évitant à la fois l’hypertrophie des langages formels ( De Mauro 1971, p. 10) et le recours à des modèles logico-mathématiques qui jouent un rôle secondaire par rapport au discours ordinaire, seul savoir apte à nous faire accéder aux structures sémantiques d’une langue historico-naturelle.
Le défi pour les structuralistes étant la possibilité de formaliser une théorie de la signification, il s’agit d’abord de comprendre quel est le rapport entre la théorie et son objet. C’est la question préliminaire que pose Louis Hjelmslev (1968-1971 [1943], p. 23) : « Est-ce l’objet qui détermine et affecte la théorie, ou est-ce la théorie qui détermine et affecte son objet ? ».
Et Greimas (1970, p. 21) de se demander à son tour : « Les structures que l’on décrit sont-elles “réelles” ou “construites”, existentielles dans les choses ou dans les consciences ? » Comme l’observe Denis Slakta (1969), à partir des définitions de structure se dessinent deux conceptions parallèles. D’une part, la structure est conçue comme étant incluse dans l’objet.
On retrouve alors la position de Martinet (1968, p. 15, cité dans Slakta 1969, p. 87) pour lequel « la structure […] est dans les faits eux-mêmes. Elle n’est pas toute la réalité observable, mais elle est comprise dans cette réalité ». Et Slakta (ibid., p. 88) d’ajouter que « séduisante que soit la démarche, elle fait surgir, particulièrement dans le domaine du lexique, plus de doutes que de connaissances ».
D’autre part campe l’aréalisme de la glossématique hjelmslevienne, qui rompt avec la thèse empiriste d’une connaissance immédiate des données sensibles. Hjelmslev (1966, p. 140) fait valoir en effet que « l’expérience n’est pas une base suffisante pour une théorie de la structure linguistique (V. Bisconti, 2017, p. 35-56).
La théorie sémantique de J. J KATZ et J. A FODOR
Les théories des traits sémantiques s’inscrivent à la suite des théories de la recréation. Ces théories postulent, que les signifiés sont construits à l’aide d’unités sémantiques, et que la composition de ces unités, n’est pas sans corrélation avec les transactions empiriques du sujet avec l’environnement. L’analyse des signifiés en unités abstraites, non figurales, confère cependant à ces théories une indiscutable unité.
Ces unités hypothétiques, désignées de façon générale les termes de traits sémantiques, sont appelés sèmes dans la tradition linguistique. L’analyse de la signification lexicale peut se faire en unités d’un seul niveau, ou unités éléments. Cependant, les psycholinguistes Katz et Fodor, dégageant les conditions d’une théorie sémantique, ils distinguent deux sortes d’unités sémantiques emboîtées. Par ailleurs, des linguistes, notamment Rastier (1987), proposent une typologie d’unités sémantiques désignées par le terme générique de sèmes52.
Le travail de Katz et Fodor illustre l’approche la plus habituelle de l’étude de la signification en termes de traits sémantiques, par une analyse de type dictionnaire de la signification des mots. Dans une analyse de cette sorte organisée « vers la droite », c’est-à-dire en décomposant les éléments de la définition jusqu’à ce que la décomposition devienne impossible, les derniers définissants peuvent représenter, ou donner une idée, des sèmes53.
________________________
51 L. Spitzer étudie le mot d’abord pour son signifié et cherche à endessiner le champ conceptuel empruntant la notion de Bedeutungsfeldélaborée par J. Trier et L. Weisgerber, qui désigne l’ensemble desynonymes existant à un certain moment dans une langue donnée (voir Spitzer 1948, p. 303). ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les approches de la sémantique historique mentionnées dans l’article?
L’article mentionne des approches cognitivistes des années 1970-1980 et une sémantique historique d’inspiration onomasiologique, notamment celles de Leo Spitzer et Reinhart Koselleck.
Comment le changement sémantique est-il relié au changement socio-culturel selon l’article?
Le changement sémantique est relié au changement socio-culturel car le sens des mots reflète toujours des structures sociales données, comme l’indiquent les recherches d’Antoine Meillet.
Quelle est l’importance de la sémantique historique selon Leo Spitzer?
Pour Leo Spitzer, la sémantique historique est une combinaison de lexicographie et d’histoire des idées, et le sens est considéré comme le baromètre le plus sensible du climat culturel.