L’analyse comparative des discours de Jean-Bertrand Aristide révèle des stratégies discursives inattendues qui éclairent la crise politique haïtienne. En examinant cinq discours clés, cette étude offre des perspectives cruciales sur le contexte socio-historique et les défis de la démocratisation en Haïti.
Cadre théorique et Méthodologique
Nous considérons deux approches conceptuelles dans ce travail. La première relève de l’analyse du discours (AD) développée à la fin des années 60 avec plusieurs tendances et écoles qui se sont constituées, qui se sont formées au travers du groupe de Coulthard et Sinclair à Birmingham, de Halliday et Martin à Sydney, et qui se sont entendues « sur la nécessité de travailler sur des corpus authentiques et sur l’intérêt des études relatives à l’inter connectivité des niveaux discursif, lexical et syntaxique, sur l’importance qu’il y a à tenir compte des applications pratiques de la théorie »38.
Cette démarche de l’analyse du discours nous permettra de questionner les logiques discursives qui caractérisent et accompagnent les revendications socio-politiques d’Haïti de 1991 à 2004. Nous comptons utiliser, pour comprendre les discours de M. Aristide, l’approche de l’analyse du discours née de la « tendance » française.
Il est important de noter le fait que, « le retentissement du courant d’analyse du discours souvent appelé “École française” a eu pour effet de susciter une équivoque entre “École française d’analyse du discours” et “analyse du discours menée en France” »39 nombre de références théoriques, de présupposés et de gestes méthodologiques40.
De cette tendance figurent les travaux de Patrick Charaudeau et de Dominique Maingueneau qui supposent que la compréhension d’un discours n’est pas essentiellement d’extraire ou reconstituer les informations pour les intégrer à ce que l’on connaît, mais, plutôt identifier la fonction de l’information dans la situation du discours où elle est produite.
Et Nous mobiliserons en cas de besoin, la rhétorique en général et la rhétorique aristotélicienne en particulier en termes de preuves discursives qui permettent à un orateur/locuteur de persuader et de manipuler son allocutaire/interlocuteur. Les concepts d’ethos41, de logos : « “l’art de penser correctement”, c’est-à-dire de combiner les propositions de façon à transmettre à la conclusion la vérité des prémices »42 et de pathos : « pour inspirer la confiance ou émouvoir, la meilleure stratégie n’est pas forcement de dire qu’on est une personne de confiance ou qu’on est ému, il est préférable d’agir dans les registres sémiotiques non-verbaux »43 seront convoqués.
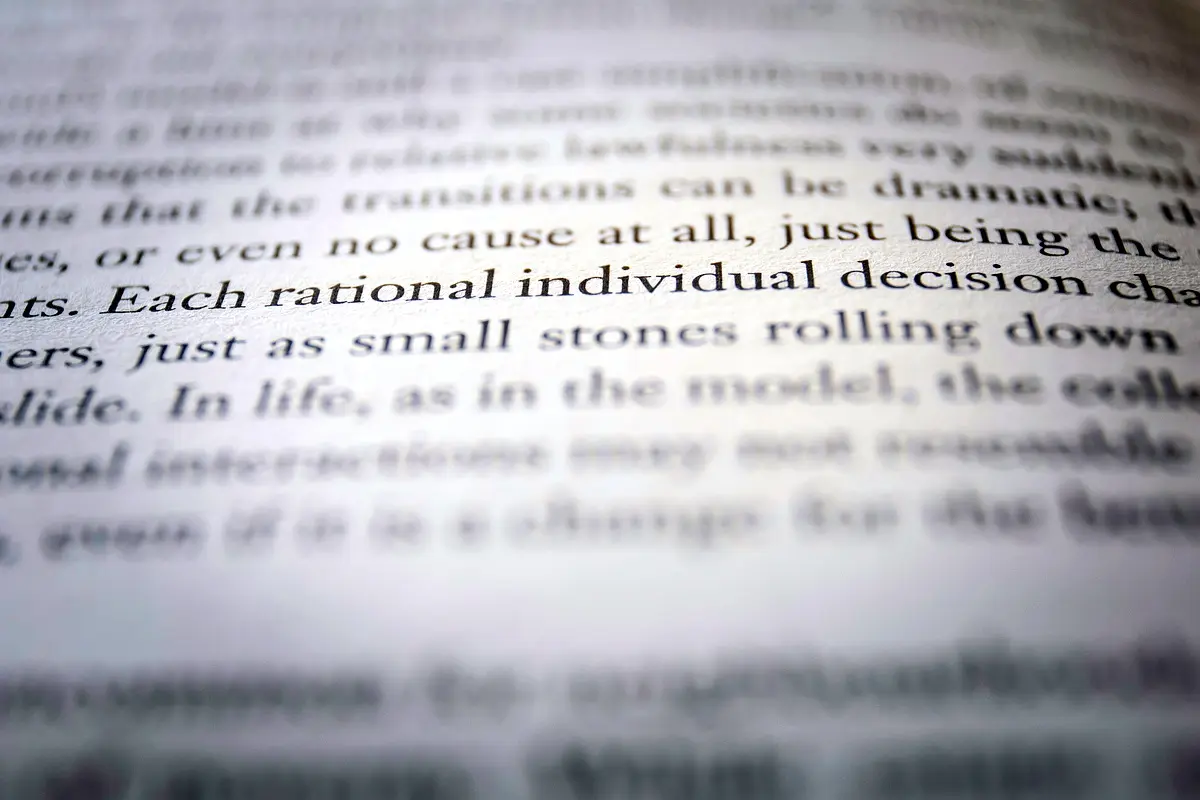
L’approche dite énonciative qui consiste à prendre en compte des phénomènes liés aux conditions de production du discours pour saisir le fonctionnement de la langue comme le définit Émile Benveniste :
« mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation »44 sera également convoquée. Cette forme d’énonciation distingue en effet les embrayeurs (je/tu, nous/vous), les référents (il/ils) considérés comme des non-personnes et des temps du discours45.
Notre deuxième approche, s’inscrit dans le domaine des approches dites socio sémiotiques qui peuvent être considérées selon Andrea Semprini comme : La branche de la sémiotique qui s’occupe de la discursivité sociale ou bien, dans une version légèrement différente, de la dimension sociale de discursivité. Les termes “discours”, “discursifs” et “discursivité” doivent être compris ici selon leur acception technique d’objets de sens énoncés, ou bien pris en charge par un dispositif énonciatif, ou bien encore, en simplifiant, pris en charge par les sujets sociaux »46.
Ainsi, en prenant pour base historico-linguistique la définition saussurienne de la sémiotique, à savoir : « une science qui étudie la vie des signes au sein de la société »47, l’on comprend subséquemment que l’approche socio sémiotique n’entreprend pas une étude séparée du mot, c’est-à-dire : d’une part, une étude sociologique, d’autre part, une étude sémiotique d’un corpus donné.
Cette approche n’est pas un simple usage des modèles sémiotiques pour expliquer les faits sociaux. Il s’agit de mobiliser les ressources scientifiques d’un champ constitué, dont Nil Özçağlar-Toulouse et Bernard Cova essayent de présenter clairement la démarche, à savoir : « la socio sémiotique utilise, comme une métasociologie, des modèles sémiotiques pour expliquer ce qui est ou qui n’est pas social dans une période historique, un endroit géographique, ou une culture spécifique »48.
Prenant donc cette posture scientifique, notre étude compte mettre en œuvre les modèles sémiotiques à la fois Greimassiens49 et Peirciens pour comprendre les signifiés socio-politiques prononcé par l’ex-président Haïtien, Jean-Bertrand Aristide dans ses discours.
La constitution du corpus
Notre travail exige l’analyse des sources primaires (les discours ; écrit et situation d’énonciation (son et image)), le contexte historique.
Nous allons tenir compte des discours médiatiques (documents issus de la presse écrite : magazines, articles de presse, les évènements autours des deux élections, etc.) Bien évidement en amont, ce travail passera par une recherche documentaire qui permettra d’identifier les aspects axiologique et épistémologique des connaissances théoriques qui rythment concernent les concepts centraux de notre recherche. Ce travail ne vise aucunement de faire des entretiens. Nous faisons un travail documentaire.
Notre corpus : les discours prononcés par Jean-Bertrand Aristide du 7 février 1991 à 1er janvier 2004. Il est pertinent de souligner que notre thème de recherche va forcément s’inscrire dans une logique d’interdisciplinarité, mieux de transdisciplinarité, alliant des ressources en sciences sociales, en science politique, l’analyse du discours, et en sciences du langage.
Sont retenus les discours suivants :
Le discours d’investiture du 7 février 1991.
Le discours du 29 novembre 1992 à la 47ème l’assemblée générale des Nations Unis (chef d’État d’Haïti en exil).
Le discours du 04 octobre 1994 au 17e séance plénière de l’ONU annonçant son retour en Haïti.
Le discours d’investiture de son second mandat le 7 février 2001.
Le discours du 1er janvier 2004 à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance.
Ils ne sont pas choisis aléatoirement. Nous avons choisi ces discours pour leurs singularités50 dans l’histoire récente du peuple Haïtien, pour mieux comprendre l’ancrage de la politique d’Aristide, son logiciel idéologique, et son approche discursive, qui a su s’imposer dans le jeu politique haïtien depuis 1990.
50 Importance historique.
Annonce du plan
Ce travail comporte deux parties, divisées en quatre chapitres. La première partie intitulée « éléments théorico-conceptuels » nous passerons en revue les grandes théories qui fondent notre entendement sur la sémantique. Puis des rappels conceptuels qui se rapportent à la persuasion, la rhétorique : l’éthos, le pathos et le logos. Et pour le besoin de ce travail, nous apporterons des éléments de définition aux concepts : élection, démocratie, populisme. Dans le second chapitre, il est question de l’analyse de discours et la socio sémiotique.
Dans la deuxième partie intitulée : « contexte socio-historique et analyse sémantique » il sera question du contexte socio-politique ; nous dressons le contexte politique qui sévit en Haïti, nous exposerons la situation socio-politique de 1991 à 2004. Ensuite, nous nous attardons sur l’influence de la communauté internationale en Haïti, notamment les États-Unis d’Amérique. Dans le second chapitre, l’analyse du corpus s’échelonnera sous l’angle de notre questionnement, ayant pour but d’expliciter les stratégies discursives dont s’est servie Jean- Bertrand Aristide ainsi que sa vision de la politique et de la démocratie.
________________________
38 C. Sanders, « Regards anglo-saxons sur le registre et les genres discursifs », Le Français dans le monde, numéro spécial, juillet 1996, Paris, Edicef, 1996, p. 46. ↑
39 D. Maingueneau, « L’Analyse du discours en France aujourd’hui », Le Français dans le monde, numéro spécial, juillet 1996, Paris, Edicef, 1996, p. 8. ↑
41 Il faut noter que le terme ethos (en grec ηθoσ, personnage) et désigne l’image de soi que le locuteur construit dans discours pour exercer une influence sur son allocutaire. ↑
42 P. Charaudeau et D. Maingueneau (éds.), Op., cit., p. 354. ↑
44 E. Benveniste, Problème de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, p. 251. ↑
45 E. Benveniste, op.cit., p.251. ↑
46 A. Semprini (éd.), Analyser la communication : Tome 2, Regards socio sémiotiques, Paris, L’Harmattan, 2007,p.13. ↑
47 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Lausanne-Paris, Payot, 1922. ↑
48 N. Özçağlar-Toulouse et B., Cova, Contributions françaises à la CCT : Histoire et concepts clés, p. 39. ↑
49 L. Hébert, Dispositifs pour l’analyse des textes et des images. Introduction à la sémiotique appliquée, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2010, p. 87. Dans le chapitre de son ouvrage consacré au schéma actantiel, l’auteur résume le modèle «un dispositif permettant, en principe, d’analyser toute action réelle ou thématisée (…). Dans le modèle actantiel, une action se laisse analyser en six composantes, nommées actants. L’analyse actantielle consiste à classer les éléments de l’action à décrire dans l’une ou l’autre de ces classes actantielles. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est l’approche méthodologique utilisée pour analyser les discours d’Aristide ?
L’étude utilise un cadre méthodologique socio-sémiotique pour analyser les discours, en se basant sur des approches conceptuelles de l’analyse du discours.
Quels types de discours sont analysés dans l’étude sur Aristide ?
L’étude analyse cinq discours clés, dont deux discours d’investiture et deux discours aux Nations Unies.
Comment l’analyse des discours d’Aristide contribue-t-elle à la compréhension de la crise politique haïtienne ?
Cette recherche constitue une contribution à la compréhension de la crise politique haïtienne contemporaine et du processus de démocratisation.