La méthodologie d’analyse sémantique révèle comment les discours de Jean-Bertrand Aristide, entre 1991 et 2004, reflètent des tensions socio-politiques en Haïti. Cette étude met en lumière des stratégies discurssives essentielles, offrant des perspectives cruciales sur la crise politique contemporaine et la démocratisation.
Université de Yaoundé I
Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
Centre de Recherche et de Formation
Doctorale en Arts, Langues et Cultures
Département des Sciences du Langage
Master Professionnel en Sémiotique et Stratégies
Spécialité: Sémiotique de la communication.
Mémoire de Master II pour l’obtention du grade de maître en sémiotique et stratégies.
Analyse sémantique des discours de l’ancien président Haïtien, Jean-Bertrand Aristide de 1991 à 2004.
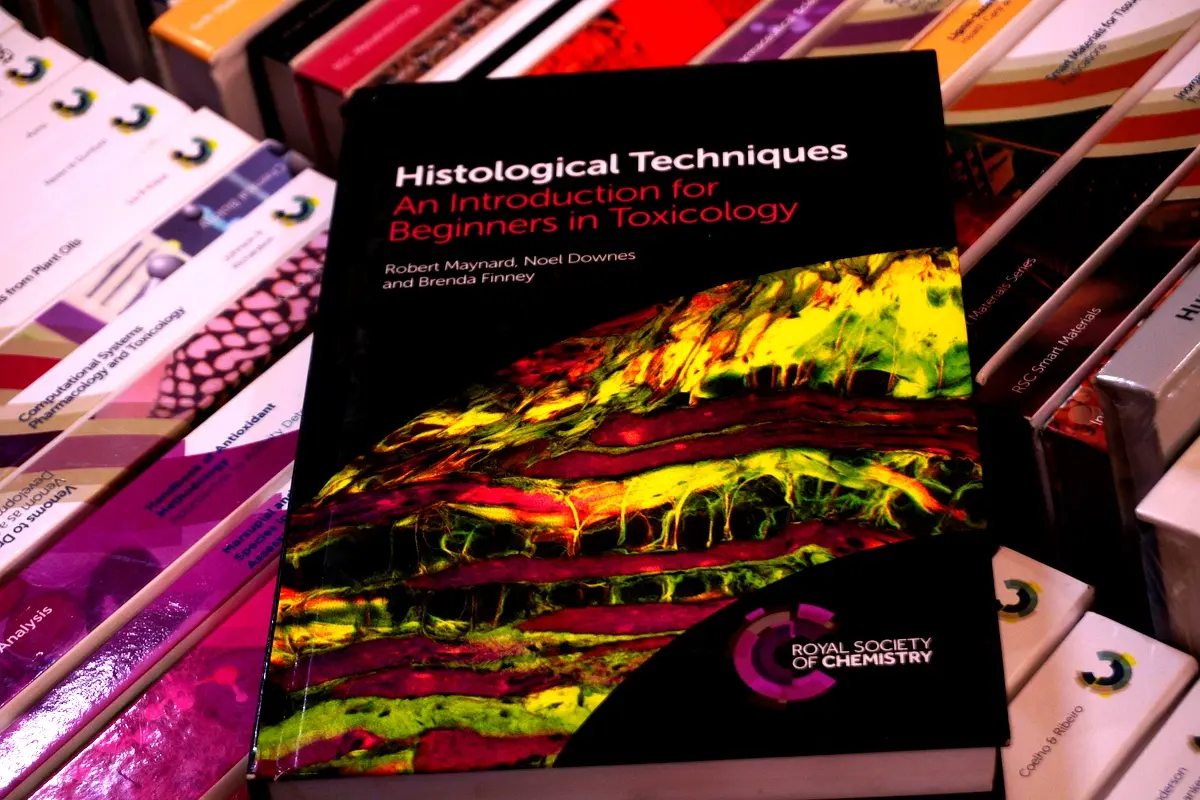
Travail Présenté par l’étudiant :
Daniel Lamour
Sous la direction de :
Dr. Colette Djadeu
Yaoundé, décembre 2022
Résumé
Ce mémoire s’intéresse à la sémantique des discours de Jean-Bertrand Aristide en mettant l’emphase sur la stratégie discursive, le contexte socio-politique post-86, le contexte de production des discours, l’émergence puis la prise du pouvoir. Le discours Aristidien galvanise les foules depuis plus de 30 ans en Haïti, acteur politique d’influence, élu président de la République à deux reprises, également forcé de quitter le pouvoir et le pays à deux reprises.
M. Aristide est donc un contributeur majeur de la crise Haïtienne contemporaine et peut aider à la comprendre.
Nous nous interrogerons sur son choix langagier, l’usage politique de la langue créole, sa phraséologie, cela en s’appuyant sur un cadre méthodologique socio-sémiotique. Ce travail procède à une analyse contextuelle et détaillée de chacun des discours retenus sur une base symbolique et / ou historique. Le processus historique est central dans ce travail, nous avons essayé d’établir les relations entre les discours et les contextes socio-historique de production.
Ce travail s’appuie sur la socio-sémiotique, donc, il est sorti du simple cadre langagier et textuel, il n’est pas figé dans la posture Greimasienne : « Hors du texte, point de salut ! » mais de préférence, chez Landowski : « comprendre ce n’est pas découvrir un sens déjà tout fait, c’est au contraire le constituer à partir du donné manifeste ».
Notre corpus est constitué de cinq (5) discours, deux discours d’investiture, deux discours aux Nations-Unis et le discours du bicentenaire. Cette étude a tenté de mettre en évidence les divers facteurs qui expliquent la faiblesse de l’État, ainsi que les divers éléments de crise qui ponctuent le processus de démocratisation et favorisant l’émergence du populisme.
Cette analyse se veut être modestement une contribution, peut-être un point de départ pour d’autres recherches et analyses de contenus dans le champs politique haïtien.
Mots-clés : crise post-duvaliériste, démocratie en Haïti, analyse sémantique, Jean-Bertrand Aristide, discours, socio-sémiotique.
Abstract
This dissertation focuses on the semantics of Jean-Bertrand Aristide’s speeches by emphasizing his discursive strategy, the post-86 socio-political context, the context of speech production, his emergence and his seizure of power. The Aristidian speech has galvanized the crowds for more than 30 years in Haiti, an influential political actor, elected President of the Republic twice, also forced to leave power and the country twice. Mr. Aristide is therefore a major contributor to the contemporary Haitian crisis and can help to understand it.
We will question his language choice, the political use of the Creole language, his phraseology, based on a socio-semiotic methodological framework. This work proceeds to a contextual and detailed analysis of each of the selected discourses, on a symbolic and/or historical basis. The historical process is central in this work, we have tried to establish the relationships between the discourses and the socio-historical contexts of production.
This work is based on socio-semiotics, so it has come out of the simple linguistic and textual framework, it is not fixed in the Greimasian posture: “Outside the text, there is no salvation! but preferably, with Landowski: “to understand is not to discover a meaning already made, it is on the contrary to constitute it from the manifest given”.
Our corpus consists of five (5) speeches, two inaugural speeches, two speeches at the United Nations and the bicentennial speech. This study has attempted to highlight the various factors that explain the weakness of the state, as well as the various elements of crisis that punctuate the process of democratization and favor the emergence of populism.
This analysis is intended to be a modest contribution, perhaps a starting point for other research and content analysis in the Haitian political field.
Keywords: post-duvalierist crisis, democracy in Haiti, semantic analysis, Jean-Bertrand Aristide, discourse, socio-semiotics.
Sommaire
Dédicace 2
Remerciements I
Liste des sigles et abréviations II
Tableaux III
Introduction générale – 7 –
1. Contexte – 8 –
2. Contraintes et limites – 9 –
3. Motivations et justifications du choix du sujet – 10 –
4. Les termes et concepts opératoires – 13 –
4.1 Analyse – 13 –
4.2. La sémantique – 13 –
4.3 Analyse sémantique – 15 –
4.4 Discours – 15 –
4.5 Politique – 17 –
4.6 Le discours politique – 17 –
5. Problématique – 18 –
5.1 Problème de recherche – 19 –
5.2 Questions de recherche – 20 –
5.3 Hypothèses – 20 –
5.4 Objectifs de recherche – 20 –
6. Revue de littérature – 21 –
7. Cadre théorique et méthodologique – 25 –
8. La constitution du corpus – 27 –
9. Annonce du plan – 28 –
4. Images des différents moments forts dans la vie politique d’Aristide. – 148 –
Table des matières – 153 –
Introduction générale
Contexte
« La liberté politique fait partie de la liberté de l’homme en général. »
(Amartya Sen)
Depuis son indépendance le 1er janvier 1804, Haïti se caractérise par une instabilité politique endémique, une transition démocratique qui n’en finit pas, une succession de coups d’État, d’affrontements et de crises. En effet, le 7 février 1986 la présidence à vie des Duvalier a pris fin. Le 29 mars 1987, les Haïtiens ont massivement voté au referendum une « Constitution de changement ».
C’est la première constitution haïtienne qui inscrit noir sur blanc, dans son préambule comme dans l’armature de ses articles, les « droits inaliénables et imprescriptibles » de tout Haïtien, en référence explicite à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Les buts déclarés sont : constituer une nation haïtienne socialement juste, implanter la démocratie et l’alternance politique, affirmer les droits inviolables du peuple haïtien.
La Constitution du 29 mars 1987 a créé la provision légale pour l’institutionnalisation du « changement », pour la transition vers la démocratie. (Midy, 2006, p.2). Alors, Haïti entre officiellement dans une transition démocratique. Ce passage de l’arbitraire à l’État de droit connaitra un certain nombre de péripéties ; la première joute électorale de « l’ère démocratique » a été avortée à la suite d’un massacre sanglant orchestré par le Conseil National du Gouvernement (CNG).
Depuis, chaque élection se fait sous la direction d’un nouveau Conseil Électoral Provisoire (CEP), qui est contraire aux prescriptions de la constitution. De plus, les élections sont généralement toutes contestées, soit par la classe politique, soit par l’opinion publique, soit par les candidats ou par des violentes manifestations de rue. Le taux de participation de la population est souvent faible.
Des cas dit, de corruption sont souvent révélées. Du coup, le renouvellement de la classe politique ne se fait pas à temps ni facilement. En somme, organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays est devenu problématique. Et la démocratie tarde à s’établir comme le veut la constitution de mars 1987.
Sur le plan économique, Haïti s’enlise. Depuis près d’un siècle le pays est connu comme le plus pauvre du continent américain. Ayant accédé à l’indépendance dans des conditions difficiles au début du dix-neuvième siècle, la population Haïtienne a vécu jusqu’à la fin des années 60 dans une économie à prédominance agricole basée sur la petite exploitation paysanne de faible productivité. L’économie urbaine est restée rachitique et liée au commerce international. L’essai de modernisation amorcé au début des années 70 par François Duvalier n’a pas donné
les résultats escomptés. Les crises politique post-86 : la transition des militaires, le coup d’état de 1991, l’embargo économique en 1992/1994, les Programmes d’Ajustements Structurels (PAS) sont des facteurs aggravante de la situation économique post-Duvaliériste.
Dans la période 1987-2003 l’économie Haïtienne a enregistré des modifications importantes dues entre autres :
- À des raisons d’ordre politique, caractérisées par une instabilité qui a eu des conséquences néfastes sur l’investissement privé ainsi que l’exécution des programmes publics de développement.
- Des raisons d’ordre économique, caractérisées par un changement notable de politiques économiques en 1986 et 1987 renforcé en 1996/97, politiques qui ont consisté pour l’essentiel à aménager l’ouverture très large de l’économie au commerce international et secondairement à libéraliser le marché financier.
Ces changements, introduits dans le cadre de deux Programmes d’Ajustement Structurel1 très partiellement appliqués par les gouvernements Lavalas (Jean-Bertrand Aristide et René Préval), n’ont pas donné les résultats espérés notamment en matière d’accroissement du volume et du poids relatif des exportations. La réforme de la fonction publique et des entreprises publiques est restée très partiels.
Après 1999, les ressources financières et humaines du secteur public se sont même anémiées par rapport à leur niveau des vingt années antérieures. De plus, l’émigration massive de nombreux professionnels et techniciens qualifiés ainsi que de la main-d’œuvre semi et non qualifiée s’est intensifiée durant la période 1999 /2003. Les crises socio-politiques se prolifèrent de 2003 à nos jours (2022), Haïti peine à retrouver le chemin de la démocratie et du progrès économique.
Contraintes et limites
Comme tout travail de recherche ce travail n’était pas facile. Le défi majeur rencontré, est la quasi absence d’archive des discours officiels en Haïti. Aucun institution étatique (la présidence, la primature, le ministère de la culture et de la communication, etc…) n’étaient en mesure de nous fournir des copies des discours du Président Aristide. Nous avons été contraints d’utiliser des sources non-officielles, non moins fiables. Nous avons globalement utilisé internet
1 https://www.alterpresse.org/spip.php?article4538 (consulté le 30 novembre 2022).
(OEA, ONU, YouTube, sites de certains médias, et Université) puis transcrit les audio et/ou vidéos en texte. Le contexte socio-politique avait constitué un handicap de taille aussi, on était obligé de déménager pour fuir la guerre des gangs armés à Port-au-Prince.
Dans un sens plus personnel, la disparition de ma mère a affaibli ma motivation, c’était une dure épreuve, j’ai à plusieurs reprises pensé à laisser tomber …
Ce travail ne se focalise pas sur la lexicométrie ni la grammaticalité des discours. Il se limite à la sémantique en prenant pour base le processus historique, l’histoire, et le contexte social global de la production des discours.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la méthodologie utilisée pour analyser les discours de Jean-Bertrand Aristide ?
L’étude utilise un cadre méthodologique socio-sémiotique pour analyser cinq discours clés.
Quels discours de Jean-Bertrand Aristide sont analysés dans cette recherche ?
Le corpus est constitué de cinq discours, dont deux discours d’investiture, deux discours aux Nations-Unis et le discours du bicentenaire.
Comment l’analyse sémantique contribue-t-elle à la compréhension de la crise politique haïtienne ?
Cette analyse tente de mettre en évidence les divers facteurs qui expliquent la faiblesse de l’État, ainsi que les divers éléments de crise qui ponctuent le processus de démocratisation.