L’analyse de cas en modélisation révèle que l’optimisation du décobaltage primaire peut transformer le rendement de précipitation du cobalt. Cette étude innovante, en utilisant des plans composites, identifie des facteurs clés, offrant des solutions cruciales pour l’industrie minière.
MODELISATION PAR L’APPROCHE DES PLANS COMPOSITES
Les plans composites sont proposés par Wilson et Box en 1951, ils font partie de la catégorie des plans de surface de réponse qui donnent un ajustement des modèles du second ordre, leurs premiers plans, appelés les plans composites, sont de différentes classes (Karima, 2008) :
- Si les points en étoile sont sur les faces du cube (ou hyper cube), le plan est dit plan composite à faces centrées.
- Si les points en étoile sont à l’extérieur du domaine cubique, le plan est composite centré extérieur (CCE).
- Si les points en étoile sont à l’intérieur du domaine cubique, le plan est composite centré intérieur (CCI).
Modélisation
La science est un ensemble de savoirs qui permettent de comprendre et d’expliquer ce qui se passe dans la nature. Pour cela, les scientifiques utilisent la modélisation, qui est une façon de représenter la réalité avec des concepts, des théories et des expériences. La modélisation peut servir à décrire ce qu’on observe, mais aussi à utiliser ce qu’on sait déjà pour interpréter de nouvelles observations et faire des prédictions.
La modélisation est donc très importante pour la science, mais elle n’est pas simple. Il faut savoir comment la faire correctement, surtout en physique et en chimie. Voici quelques objectifs généraux de la modélisation :
- Réduire la complexité de la réalité ;
- Trouver des liens entre les grandeurs d’entrées et de sorties ;
- Etablir un modèle qui correspond aux faits ;
- Faire des prévisions et optimiser (eduscol, 2019).
Modèle
Le terme « modèle » se réfère à un ensemble d’équations mathématiques construit sur la base de données expérimentales acquises sur le système réel et permettant de représenter les relations entre les sorties et les entrées du système (Truong-Meyer, 2023).
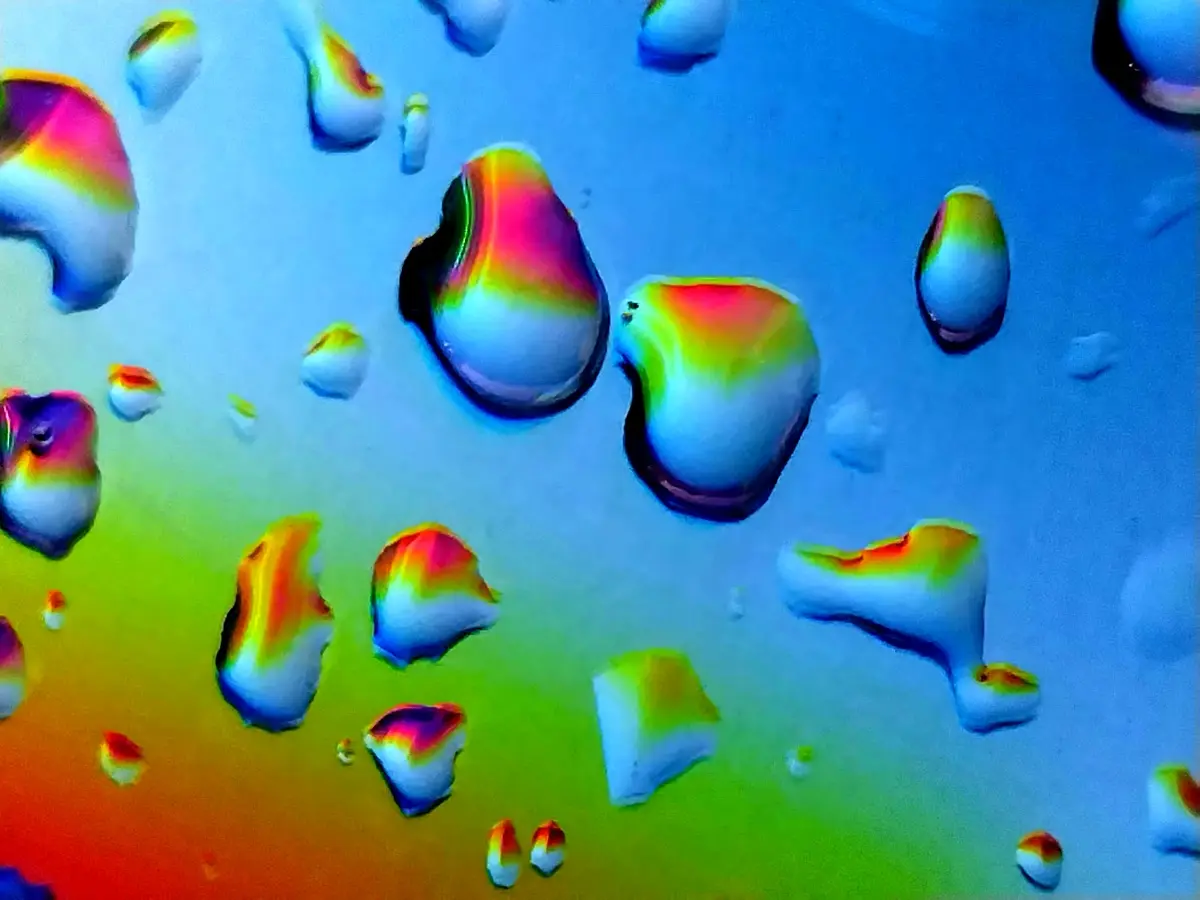
[5_analyse-de-cas-modelisation-pour-optimisation_4]
Figure II-2 : Modèles, outils de connexion entre le monde des théories et le monde matériel (eduscol, 2019)
Il existe différents types de modèle permettant de répondre aux différents objectifs poursuivis lors d’une étude. La construction d’un modèle s’appuie sur deux facteurs clé : l’expérience et la connaissance. Ces deux facteurs sont liés, l’analyse des données expérimentales conduisant forcément à un approfondissement de la connaissance.
La capacité à développer un type de modèle plutôt qu’un autre va dépendre en grande partie de la connaissance théorique que le modélisateur a du système et de l’information expérimentale disponible. De manière très schématique, on peut classer les modèles en quatre grandes classes :
- Les modèles empiriques (modèles comportementaux ou modèles type boite noire),
basés uniquement sur l’information expérimentale ;
- Les modèles de connaissance pure basés uniquement sur la connaissance théorique du système (lois fondamentales de la physique) ;
- Les modèles phénoménologiques, basés sur les lois poussées de la physique ;
- Les modèles hybrides, interviennent dans le cadre des phénomènes complexes (Truong- Meyer, 2023).
Méthodologie des plans composites
Les plans composites sont une extension des plans factoriels, ils sont constitués d’un plan factoriel complet ou fractionnaire, des points centraux et des points axiaux (ou étoile). A la différence des plans factoriels, les plans composites donnent un ajustement des modèles du second degré (Karima, 2008).
Objectifs
Comme tous les plans pour surfaces de réponses, les plans composites ont un but ambitieux, car ils offrent en même temps les avantages suivants (Gauchi, 2016) :
- D’identifier les facteurs importants ;
- De faire des prévisions de haute qualité ;
- De détecter avec une bonne sensibilité le manque d’ajustement des modèles ;
- De détecter les optimums de la réponse ou bien des zones optimales ;
- De permettre la séquentialité de la mise en œuvre des expériences.
Planification des essais
L’expérimentation se déroule en deux grandes phases : la planification des expériences, avant de les réaliser, et l’analyse des données, après les avoir obtenues. Il faut noter que ces deux phases font partie intégrante de la méthode proposée (Perrin, et al., 1993) :
- Une bonne planification permet généralement de recourir à des techniques d’analyse des données assez simples (analyse de la variance, régression linéaire, etc.) ;
- Une absence de planification en amont des expériences implique souvent l’utilisation d’outils mathématiques et statistiques beaucoup plus sophistiqués (analyses factorielles, classifications, etc.) sans être sûr d’obtenir des résultats satisfaisants.
La planification exige que l’expérimentateur puisse établir un lien de causalité entre certains paramètres du phénomène (appelés facteurs), qui sont censés influencer le comportement du phénomène, et d’autres (appelés réponses) qui décrivent le résultat du phénomène. Le schéma systémique de la boite noire illustre bien cette situation Figure II-3, où les entrées sont les facteurs et les sorties sont les réponses (Perrin, et al., 1993).
Figure II-3 : Systémique d’une boite noire (Yahiauoi , 2015)
Domaine d’étude
On appelle domaine d’étude (domaine expérimental) tout ensemble de l’espace cartésien dans lequel il est possible de réaliser les expériences. Le domaine d’étude est obtenu en croisant les diverses plages de variations des facteurs. (Tinsson, 2010).
[5_analyse-de-cas-modelisation-pour-optimisation_5]
Figure II-4 : Domaine d’étude d’un plan composite centré à trois facteurs (Goupy, et al., 2006)
Diagramme de surface
Le diagramme de surface fait partie des outils graphiques permettant d’analyser un modèle mathématique, il aide à rechercher un maximum ou un optimum de la réponse étudiée. Le diagramme de surface permet de visualiser la surface de régression dans un espace à trois dimensions. Sur les axes X, Y, on retrouve les facteurs, et sur l’axe Z la variation de la réponse modélisée (Alarcon, 2016).
[5_analyse-de-cas-modelisation-pour-optimisation_6]
Figure II-5 : Diagramme de surface
Plan d’expériences
Les plans d’expériences sont des outils statistiques qui aident à planifier les essais nécessaires pour une investigation scientifique ou industrielle. Ils s’appliquent à tous les domaines et à tous les secteurs où l’on veut comprendre la relation entre une variable d’intérêt, y, et des facteurs, Xi. Les plans d’expériences sont utiles quand on étudie une fonction de la forme :
Y = f (Xi) | (II-5) |
Les plans d’expériences permettent de gagner du temps et de l’information en réduisant le nombre d’essais à réaliser. Pour cela, il faut respecter des principes mathématiques et suivre une méthode rigoureuse. Il existe une grande variété de plans d’expériences adaptés à chaque situation rencontrée par un expérimentateur (Goupy, 2006).
Pour obtenir des informations pertinentes, une démarche méthodologique doit être suivie (Yahiauoi , 2015) :
- Définition des objectifs et critères ;
- Définition des facteurs à étudier et du domaine expérimental ;
- Construction du plan d’expériences ;
- Expérimentation ;
- Analyse des résultats ;
- Conduite éventuelle d’essais supplémentaires ;
- Validation des résultats ;
- Conclusion de l’étude.
Critères d’optimalité
Pour un type de modèle donné, on cherchera le placement « optimal » des points d’expériences pour lequel l’erreur sur les réponses prédites est la plus faible possible (Yahiauoi , 2015).
Critère d’isovariance par rotation
Si l’on veut que le plan composite satisfasse ce critère, il faut placer les points en étoile à une distance « » égale à la racine quatrième du nombre de points du plan factoriel (Nf). Dans la littérature anglo-saxonne, on parle de critère de rotatabilité « » est calculé en utilisant la relation suivante (Yahiauoi , 2015) :
α = N1/4 f | (II-6) |
Critère de presque orthogonalité
Une matrice d’expériences X est presque orthogonale si sa matrice d’information (XTX) privée de sa première ligne et de sa première colonne est diagonale, autrement dit, la propriété de presque orthogonalité consiste à rapprocher la matrice de dispersion d’une matrice diagonale,
« » est calculé en utilisant la relation suivante (Gauchi, 2016):
1/4 Nf(√N − √N )2 𝛼 = ( f ) 4 | (II-7) |
Critère de précision uniforme
Elle est obtenue quand la variance de la réponse prédite est constante à l’intérieur du domaine. Son intérêt est d’assurer une même précision de réponse prédite sur tout le domaine. Le Tableau II-1 permet de choisir la valeur de « » et le nombre des essais au centre du domaine pour les cas les plus souvent rencontrés (Gauchi, 2016).
Tableau II-1 : Valeur de et de no selon les propriétés recherchées pour le plan composite (Yahiauoi , 2015)
k | 2 | 3 | 4 | 5 | 2(5-1) | 6 | 2(6-1) | |
Nf | 2k (ou 2k-p) | 4 | 8 | 16 | 32 | 16 | 64 | 32 |
Ne | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Isovariance par rotation | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |
no | Précision uniforme | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 15 | 9 |
Presque orthogonalité | 8 | 12 | 12 | 17 | 10 | 24 | 15 | |
| 1,41 | 1,68 | 2 | 2,38 | 2,00 | 2,83 | 2,38 |
Avec :
- Nf : nombre d’essais du plan factoriel
- Ne : nombre d’essais en étoile
- no : nombre d’essais au centre du domaine
- k : nombre de facteurs
Nombre d’essais
Pour un plan composite centré, le nombre d’essais « N » devant être mené va dépendre du nombre de facteurs « k » choisis pour une étude, du nombre d’essais en étoile « Ne » et du nombre d’essais au centre du domaine d’étude « no », le nombre d’essais au centre du domaine est prédéfini suivant le critère d’optimalité choisi lors d’une étude, les informations détaillées sont données dans le Tableau II-1. Le nombre d’essais pour un plan composite centré se calcule en utilisant la relation suivante (Faucher, 2006) :
N = 2k + 2k + n0 | (II-8) |
Modélisation mathématique
Le modèle mathématique postulé utilisé avec les plans pour surfaces de réponse est un modèle du second degré avec interactions du second degré, pour une étude à trois facteurs, le modèle mathématique est donné par (Goupy, et al., 2006) :
Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a12x12 + a13x13 + a23x23 + a11x2 + a22x2 + a33x2 + e 1 2 3 | (II-9) |
Avec :
- Y : réponse prédite
- xi : facteurs i
- ai : coefficients du modèle
- e : résidu.
Validation du modèle
Il existe plusieurs tests statiques qui permettent de valide un modèle, pour le cadre de ce travail, nous retiendrons :
- Le coefficient de détermination et le coefficient de détermination ajustée ;
- L’analyse des résidus ;
- La valeur de la probabilité (p-value).
Logiciels pour les plans d’expérience
Pour mener une étude avec un plan d’expérience, l’outil informatique est nécessaire. Il permet de gagner du temps et de la précision. Il offre aussi plusieurs avantages : il aide à choisir le plan d’expérience le plus adapté (plan standard, plans optimaux, etc.), il effectue tous les calculs complexes (estimation des paramètres, tests statistiques, etc.) et il fournit toutes les sorties utiles (diagrammes de Pareto, graphiques des surfaces de réponses, etc.) (Tinsson, 2010).
Dans le cadre de notre travail, pour planifier les essais et réaliser la modélisation, nous avons utilisé le logiciel Minitab 18.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les types de plans composites en modélisation?
Les plans composites peuvent être classés en trois types : plan composite à faces centrées, plan composite centré extérieur (CCE) et plan composite centré intérieur (CCI).
Comment la modélisation aide-t-elle à optimiser le décobaltage?
La modélisation permet de réduire la complexité de la réalité, d’établir des liens entre les grandeurs d’entrées et de sorties, et de faire des prévisions pour optimiser le processus.
Quels sont les objectifs des plans composites dans l’expérimentation?
Les objectifs des plans composites incluent l’identification des facteurs importants, la prévision de haute qualité, la détection du manque d’ajustement des modèles, et la recherche des optimums de la réponse.