Les meilleures pratiques de financement révèlent comment l’Agence Française de Développement a façonné les relations franco-africaines depuis 1941. En explorant son rôle crucial, cette étude met en lumière des transformations essentielles avec des implications profondes pour le développement économique et social en Afrique francophone.
La Caisse centrale de la France d’Outre-mer et le F.I.D.E.S. dans le financement et l’exécution des politiques de développement.
L’ordonnance du 24 juillet 1942 qui suspendit le privilège d’émission à la Banque de l’Afrique de Occidentale dans les territoires de l’A.E.F. et du Cameroun confia à la C.C.F.O.M. ce privilège. Cette décision correspondait tout d’abord à la nécessité de donner à l’A.E.F. et du Cameroun, ralliés à la France libre, une circulation monétaire distincte de celle de l’A.O.F., qui relevait encore, à l’époque du gouvernement de Vichy.
Elle était également justifiée par la volonté de confier désormais le privilège de l’émission, véritable fonction publique à un établissement public, uniquement guidé par des considérations d’intérêt général.
Illustration 3 : Spécimen de billet de 20 francs de la C.C.F.O.M.
[12_meilleures-pratiques-de-financement-de-afd-en-afrique_3]
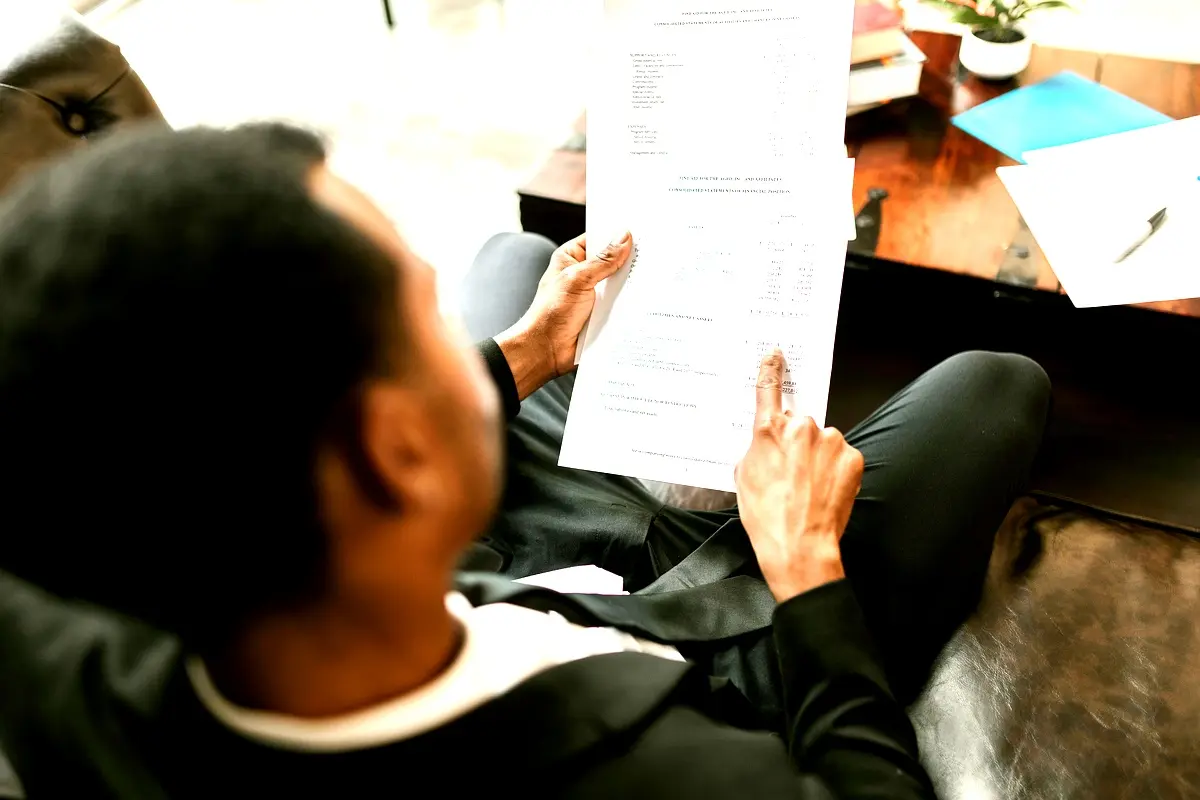
Source : Les Mémoires d’André POSTEL-VINAY, p.47.
Plus tard, avec la constitution de 1946, avait prescrite par la loi du 30 avril 1946 l’établissement de plans de développement économique et social des territoires d’Outre-mer. Cette loi avait également confié à la Caisse centrale de la France d’Outre-mer le soin d’assurer le financement de ces plans.
La réalisation des plans supposait ainsi un important effort financier évalué par la Commission de modernisation des territoires d’Outre-mer pour 134 LICKERT Victoria, idem, p.29.
une durée de dix années d’exécution à un somme d’ordre de 285 milliards de franc métropolitain dont 150 milliards environ pour la première tranche quinquennale135 (1947- 1951).
Cependant, des investissements aussi importants ne pouvaient être réalisés que par un fonds commun de la métropole et des territoires d’Outre-mer. La participation directe de ces derniers au financement des plans restait fortement limitée compte tenu de leur manque d’épargne.
L’effort principal devait donc venir de la métropole soit à titre de don, sous la forme d’une subvention dans le budget de l’Etat français, soit à titre de prêt, sous la forme d’avances consenties aux territoires.
La loi du 30 avril 1946 en concrétisant cette association de la métropole et des T.O.M., créa un fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’Outre-mer (F.I.D.E.S.), qui rassemblait toutes les ressources publiques affectées à la mise en œuvre des T.O.M.
La loi avait également confiée à la C.C.F.O.M. la triple mission de gérer ces fonds, d’assurer la création de sociétés d’Etat et d’économie mixte et d’avoir une action propre de banque de développement136.
Tableau 3 : Chronologie de la création des sociétés de crédit de la loi de 1946 en Afrique (avant 1959)
Territoire / Pays / Département | Raison social | Date de création |
Afrique ŔEquatoriale française | Crédit de l’Afrique-Equatoriale française | 1949 |
Cameroun | Crédit du Cameroun | 1949 |
Dahomey | Crédit du Bénin | 1954 |
Madagascar | Crédit de Madagascar | 1954 |
Guinée | Crédit de Guinée | 1955 |
Cote d’Ivoire | Crédit de Cote d’Ivoire | 1955 |
Sénégal | Crédit du Sénégal | 1956 |
Haute-Volta | Crédit de Haute-Volta | 1957 |
Soudan français (Mali) | Crédit du Soudan | 1957 |
Niger | Crédit du Niger | 1957 |
Togo | Crédit du Togo | 1957 |
135 La Caisse centrale, La Caisse centrale de la France d’Outre-mer, Note et étude des documentaires, Paris, la Documentation, 1950, p.9.
136 Caisse française de développement, Caisse centrale de coopération économique, 30 ans au service du développement 1946-1976, Paris, Imprimerie Nationale, 1976, p.10.
Source : Les Mémoires d’André POSTEL-VINAY, p.97.
Ni administration propre, ni personnalité juridique, le F.I.D.E.S. était géré par la Caisse centrale sous l’autorité et le contrôle de son Comité directeur. Ce dernier assurait d’ailleurs la répartition de la subvention de l’Etat français au fonds.
Le Comité directeur du F.I.D.E.S. était de ce fait un véritable Conseil d’administration, présidé par le ministre de la France d’Outre-mer et comprenant un représentant du ministre des finances, le Commissaire général du Plan, le directeur général de la Caisse centrale.
Le Fonds de la loi du 30 avril 1946 était toutefois approvisionné en recette par une dotation du budget de l’Etat français fixée chaque année par la métropole, mais aussi par des contributions des territoires constitués soit sur leurs propres ressources (impôts et taxes locaux, fonds de réserve…), soit par des emprunts à long terme contractés auprès de la C.C.F.O.M.
Sur ces ressources, le F.I.D.E.S. assurait le financement des « programmes d’équipement », dans les conditions fixées par le décret du 3 juin 1949 pour les territoires qui relevaient du ministère de la France d’Outre-mer.
Dans les départements comme dans les territoires, les programmes d’équipement comportaient « une section générale » du 30 juin 1950 dont les dépenses étaient portées en totalité par la subvention de l’Etat français au F.I.D.E.S.
La section générale pourvoyait ainsi :
- Aux dépenses de recherche scientifique ;
- A la constitution du capital des Sociétés d’Etat ;
- Aux prises de participation dans le capital des Sociétés d’économie mixte ;
- A la réalisation de projets qui, par leur nature ou leurs conséquences, intéressent la métropole et plusieurs territoires d’Outre-mer.
Dans le tableau qui suit, on répertorie les crédits couverts au titre de la section générale du 30 juin 1950. Ces crédits ne sauraient être appréciés uniquement de manière globale à l’échelle des T.O.M. et des D.O.M. En effet, les écarts des crédits sont sensibles entre les différents domaines d’activité en fonction des caractéristiques de ces activités : aux cotés des Sociétés d’Etat et d’Economie Mixte (Couleur Bleu) et de l’Equipement Economique (Couleur Rouge), figure la Recherche Scientifique (Couleur Jaune) qui englobe plus de domaines d’activité et recevait beaucoup plus de crédits, mais aussi l’Equipement Social (Enseignement et assistance technique et Urbanisme, Habitat et Hôtellerie) et la Documentation.
Tableau 4 : Crédits de paiement ouverts à la Section Générale du 30 juin 1950 (Territoires et Départements d’Outre-mer)
Participation au capital des Sociétés | 907.566.000 |
Dotation | 2.925.170.000 |
Développement de la production | 3.085.250.000 |
Offices et instituts de recherche | 2.257.214.623 |
Recherche minières | 1.148.000.000 |
Carte géologique | 123.400.000 |
Etude et mission | 454.792.768 |
Cartographie | 517.900.000 |
Enseignement et assistance technique | 227.811.070 |
Urbanisme Habitat et Hôtellerie | 120.200.000 |
Documentation | 32.000.000 |
Divers | 265.950.000 |
Total | 12.065.254.000 |
Source : La Caisse centrale, La Caisse centrale e la France d’Outre-mer, Note et étude des documentaires, Paris, La Documentation française, 1950, pp.10-11.
Commentaire tableau 3 : l’examen de ce tableau permet notamment de mesurer l’importance de l’effort accompli pour le développement de la « recherche scientifique. Ceci montre tout simplement l’intérêt que portait la métropole dans la richesse des colonies et dans l’exploitation futures des ressources des dites colonies.
La mise en œuvre du Plan d’équipement nécessitait d’importants capitaux, l’emploi de ces ressources supposait des études économiques et financières approfondies. A cette fin, la Caisse centrale s’était préoccupée de réunir tous les éléments d’information indispensables.
Elle disposait en effet de service de documentation et d’études générales qui s’efforçaient d’établir une documentation statistique sur chacun des territoires intéressés dans les domaines de la monnaie et des finances, des salaires et des prix, de la production, du crédit et du commerce extérieur.
Par ailleurs, en 1949, furent mis en place des programmes annuels d’exécution pour les équipements d’outre-mer. Le deuxième plan quadriennal (1953·1956) intéressait en partie les colonies.
Le retard était tel que le résultat obtenu ne fut pas celui attendu : « il reste cependant que le plan a consacré ses plus grands efforts aux équipements de base qui ne comportent aucune rentabilité directe pour les territoires, mais, bien au contraire, des frais d’entretien et de renouvellement considérables qui constituent ainsi un problème préoccupant de la planification outre-mer »137
Cette transformation globale de la politique économique coloniale eut des répercussions dans la colonie du Sénégal. En effet, en 1953 fut créé l’ENCOOP138, qui avait pour but de fixer les points de traite et de déterminer les points de vente de l’arachide.
En 1954, apparurent les Centres d’Expansion Rurale, qui servirent de relais entre l’administration centrale et les communautés villageoises.
En 1956, furent fondées, à Thiès et en d’autres lieux, des « sociétés mutuelles de production rurale », qui prirent la suite des « sociétés de prévoyance139 » de 1910. L’objectif était de familiariser le producteur sénégalais avec les techniques modernes afin d’aboutir à une amélioration des rendements.
En 1958, ces sociétés furent transformées en « sociétés mutuelles développement rural140 ».
La même année était déjà en place un Gouvernement sénégalais, dans le cadre de la Communauté.
Indépendamment, la C.C.F.O.M. assumait les fonctions de grand établissement public de financement du développement économique de l’Outre-mer. La loi du 30 avril 1946 prévoyait à cette fin, dans son article 4, une série d’attributions qu’il est possible de classer en deux grandes catégories :
- d’une part, la Caisse centrale a été autorisée à octroyer des avances sollicitées par les territoires pour parfaire leurs contributions propres aux dépenses du F.I.D.E.S. Ces prêts, une fois prise la décision définitive du Comité directeur du F.I.D.E.S., sur l’accord des autorités locales compétentes, sont au demeurant toujours consentis d’une manière en quelque sorte automatique et sans que le Conseil de Surveillance de la Caisse ait autre chose à faire qu’à les entériner ;
- d’autre part, elle a été habilitée, en premier lieu : « à constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital de ses Sociétés d’Etat des Sociétés d’Economie ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d’avance, les moyens de le faire » ; en second lieu : « à assurer ou garantir aux collectivités ou aux
137 SOUDET Pierre, Les plans d’investissement Outre-mer, Revue d’économie politique n°5, vol.62, L’Economie de l’Union française d’Outre-mer, 1952, p.823.
138 Idem.
139 GASTELLU J-M, Politique coloniale et organisation économique des pays serer, Sénégal, 1910-1950, Dans A.O.F. : réalités et héritages. Sociétés Ouest-africaines et ordre colonial, 1895-1960, Tome 2, sous la direction de Charles BECKER, Saliou MBAYE, IBRAHIMA Thioub, Dakar, Direction des Archives du Sénégak, 1997, pp.566-567.
140 Idem.
entreprises concourant à l’exécution des programmes directement ou par l’intermédiaire d’établissements publics, toutes opérations financières autorisées par la loi et destinées à faciliter cette exécution. Il a été stipulé que toutes ces opération, définies comme « Opération propre » de la Caisse centrale, devraient recevoir l’approbation du Comité directeur du F.I.D.E.S141.
Dans ce dernier cas, l’objectif poursuivi était assez éloigne de celui assigné aux deux premières catégories d’établissements. Mais, à travers leurs différences d’attribuions, la création de ces divers types de sociétés répondait pour la Caisse centrale à une deuxième préoccupation de portée générale : celle de contribuer à mettre en place des organismes où se formait du personnel d’origine locale, qui serait le « banc d’essai » de différentes actions de développement et qui, dans le cas des territoires appelés à évoluer vers un statut d’Etat indépendant, pourraient ainsi constituer l’amorce de leurs futures institutions nationales.
Payeur du F.I.D.E.S., la C.C.F.O.M. intervient également comme prêteur. Toutefois, la constitution de 1946 revoyait de fond en comble la fiscalité des colonies. Dès lors, la métropole prenait désormais en charge une partie des lourdes dépenses qui étaient gérées par les territoires.
Au-delà d’une nouvelle fiscalité coloniale142, l’Etat français officialisait la création d’une monnaie commune en décembre 1945, le franc CFA à la parité de 1,70 F ; plus tard, à partir du 18 octobre 1948 le taux initial fut porté à 2 F métropolitain143.
Les premières actions d’aide bilatérale de la France datent donc de la mise place du F.I.D.E.S. et des premiers plans de modernisation et d’équipement de l’Union française.
Toutefois, les crédits consacrés par le F.I.D.E.S. et la C.C.F.O.M. au développement de l’A.O.F. allèrent régulièrement : 200 millions de franc CFA en 1947 ; 2.800 millions en 1948 ; 5.200 en 1949 ; 9.300 en 1950144.
En plus de la création de sociétés d’Etat et d’Economie Mixte, la Caisse centrale créait d’autres types de sociétés prévue par la loi : les sociétés de crédit, les sociétés d’énergie électrique et les sociétés immobilières. Le FIDES fut 141 LEDUC Gaston, La politique des investissements dans l’Outre-mer, in Revue des Sciences financières n°1, janvier-mars 1957, pp.102-103. Voir Journal Officiel de l’Afrique Occidentale Française du 30 novembre 1946, décret n°46-2356 du 24 octobre 1946, déterminant les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de la France d’Outre-mer effectuait les opérations autorisées par la loi du 30 avril 1946. A.N.S. sous-série 3Q Ŕ 261 Versement 165.
142 TOURE Abdoulaye, « Un aspect de l’exploitation coloniale en Afrique : fiscalité indigène et dépenses d’intérêt social dans le budget du Sénégal », Thèse pour le doctorat de 3èm cycle, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Département Histoires, 1991, pp.26-33.
143 CHAILLEY Marcel, Histoire de l’Afrique Occidentale : 1638-1959, Berger-Levrault, 1968, p.455.
144 DEBENOIST J-R, ibidem.
également intervenu dans la création de ces sociétés145. La mise en œuvre de celles-ci impliquait de suivre une même procédure, à savoir il fallait un arrêté du ministre de la France d’Outre-mer et une délibération du comité directeur du FIDES146.
Dans le tableau qui suit, est répertorié les sociétés d’énergie électriques crées par la loi du avril 1946.
Tableau 5 : Chronologie de la création des sociétés d’énergie électrique de la loi de 1946 (avant 1959).
Territoire / pays / département | Raison social | Date de création |
Afrique-Equatoriale français | Energie électrique de l’Afrique-Equatoriale française (EEAEF) | 1948 |
Cameroun | Energie électrique du Cameroun (ENELCAM) | 1948 |
Guinée | Energie électrique de Guinée (EEG) | 1950 |
Gabon | Société d’énergie de Port-Gentil (SEPG) | 1950 |
Sénégal (A.O.F) | Energie de l’Afrique-Occidentale française (EAOF), devenue, après 1960 Société africaine d’électricité | 1951 |
Madagascar | Energie électrique de Madagascar (EEM) | 1951-1952 |
Cote d’Ivoire | Energie électrique de Cote d’Ivoire (EECI) | 1951 |
Source : les mémoires d’André Postel-Vinay.
Quant à les sociétés immobilières, un travail de construction de logements économiques a été fait. Elles avaient pour objet de créer des logements bon marché, accessibles aux cadres africains.
Ces sociétés furent démarré graduellement leurs activités et finissaient par réaliser des œuvres considérables, notamment à Dakar et Abidjan. Cela jouait un rôle important notamment dans la formation et le logement des cadres africains147.
145 « La création de ces divers types de sociétés répondait pour la Caisse centrale à une préoccupation de portée général : celle de contribuer à mettre en place des organismes où se formait du personnel d’origine local, qui serrait le banc d’essai de différentes actions de développement et qui, dans le cas des territoires appelés à évoluer vers un statut d’Etat indépendant, pourraient ainsi constituer l’amorce de leurs futures institutions nationales ». Caisse centrale de coopération économique, 30 ans au service du développement 1946-1976, Paris Imprimerie Nationale, p.17.
146 POSTEL-VINAY André, op.cit., p.93.
147 Idem, p.96.
Tableau 6 : Chronologie de la création des sociétés immobilières de la C.C.F.O.M. en Afrique (avant 1959)
Territoire / pays / département | Raison social | Date de création |
Sénégal | Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) | 1950 |
Madagascar | Société Immobilière de Madagascar | 1951 |
Cameroun | Société Immobilière du Cameroun | 1952 |
Cote d’Ivoire | Société Immobilière de Habitats à bon marché de Cote d’Ivoire (SIHCI) | 1952 |
Source : Les Mémoire d’André Postel-Vinay, p.96.
Ces sociétés ont été créées d’abord avec les fonds du F.I.D.E.S., puis avec des souscriptions de la Caisse central, sous forme de prêt.
Dirigé par André POSTEL-VINAY de 1944 à 1972, la C.C.F.O.M. acquit une influence décisive sur le choix des projets d’investissement et le suivi de ces projets.
Son approche a été conçue dès l’origine dans sa dimension territoriale par son implantation dans les géographies relevant de sa compétence. Cette dimension territoriale a été en effet attestée par une large présence sur le terrain ; la Caisse centrale implante des agences en Afrique dès les années 1940 : d’Abidjan à Dakar en passant par le Congo Brazza.
Ce qui en fait un précurseur parmi les bailleurs de fonds distribuant l’aide française au développement.
C’est dans ce cadre, à la fois souple et stricte que s’est progressivement bâtit l’institution, au cours des années qui précédent l’accession des territoires d’Afrique noire et de Madagascar à l’indépendance, et qu’elle a ensuite pu, sans difficulté, à un contexte nouveau et à des fonctions élargies.
En fin, la Caisse centrale pouvait également accorder des avances, qui complétaient celles accordés par l’institut d’émission lorsque ce dernier fut intégré à la sphère publique à partir de 1955.
Le F.I.D.E.S. fut alors transformé en F.A.C. (Fonds d’aide et de coopération, crée en 1959), qui attribuait des aides, tandis que la Caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.), nouvelle dénomination148 de la C.C.F.O.M., à partir de 1958, proposait des prêts directs et des prises de participation en capital.
Toutefois, l’accession des Etats africains et malgache à l’indépendance n’avait aucune raison de poser de grands problèmes à un organisme comme la C.C.C.E., dont la vocation 149 Caisse française de développement, Caisse centrale de coopération économique, 30 ans au service du développement 1946-1976, Paris Imprimerie Nationale, 1976, p24.
était de « prêter en fonction de données purement objectifs, de caractère technique, économique et financier, en identifiant son intérêt à celui des pays aidés »150.
Mais face à cette situation, la France se voyait obliger de restructurer administrativement son dispositif, en mettant en place des moyens et des mécanismes pour mener à bien la politique de coopération avec les nouveaux Etats d’Afrique Noire d’expression française et Madagascar.
Banque française de développement, il va de soi, cependant qu’elle devait veiller particulièrement à insérer son action dans la politique d’aide de la France150 aux nouveaux Etats indépendant. Politique dont la conduite incombait au ministère de la coopération.
Illustration 4 : logo de la C.C.C.E.
[12_meilleures-pratiques-de-financement-de-afd-en-afrique_4]
Source : https://www.afd.fr/fr/notre-histoire.
149 Caisse française de développement, Caisse centrale de coopération économique, 30 ans au service du développement 1946-1976, Paris Imprimerie Nationale, 1976, p24.
150 Ibidem.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les principales missions de la Caisse centrale de la France d’Outre-mer (C.C.F.O.M.) ?
La C.C.F.O.M. a pour mission de gérer les fonds, d’assurer la création de sociétés d’Etat et d’économie mixte, et d’avoir une action propre de banque de développement.
Comment le financement des plans de développement économique et social des territoires d’Outre-mer a-t-il été assuré ?
Le financement des plans était assuré par un fonds commun de la métropole et des territoires d’Outre-mer, avec une participation directe limitée des territoires, le principal effort venant de la métropole sous forme de dons ou de prêts.
Quel rôle a joué le F.I.D.E.S. dans le développement des territoires d’Outre-mer ?
Le F.I.D.E.S. a été créé pour rassembler toutes les ressources publiques affectées à la mise en œuvre des territoires d’Outre-mer et était géré par la C.C.F.O.M. sous l’autorité de son Comité directeur.