La prévention des inondations à Douala révèle des enjeux cruciaux : une étude récente montre que l’occupation non réglementée des lits de cours d’eau aggrave les risques. Ce système d’information géographique innovant promet de transformer la gestion des inondations, offrant des solutions vitales pour les communautés vulnérables.
Le rapport confluence ou Coeficient de bifurcation de Font
Où : 𝑵𝒙 est le nombre de tronçon de rivière d’ordre 1 selon Strehler 97
𝑹𝒄 = 𝑵
𝑵𝒙
𝒙+𝟏
et 𝑵
𝒙+𝟏
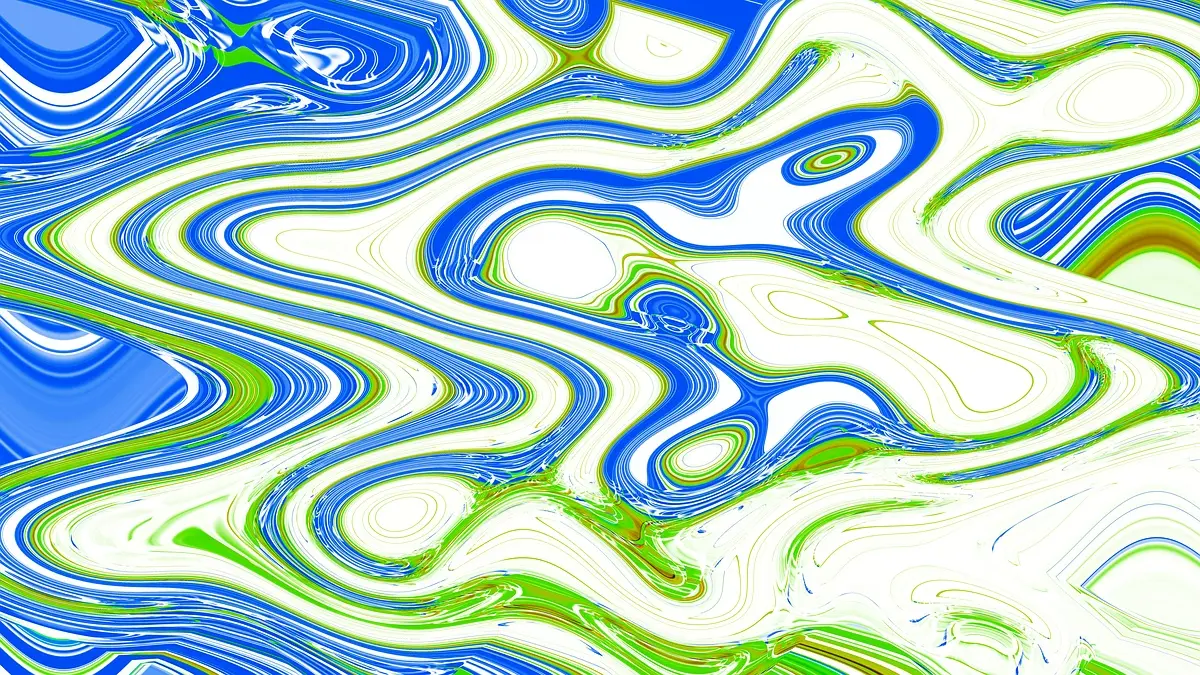
le nombre de tronçon de rivière supérieur à l’ordre 1 selon
Strehler 32
Le rapport de confluence est de 3,03
Le coefficient de bifurcation décrit le degré de hiérarchisation ou l’étendu de l’arborescence d’un réseau hydrographique en d’autres termes. Il est inférieur à 5 si le réseau hydrographique est bien développé, et supérieur à 10 si le réseau hydrographique est très peu développé.
Pour un seuil d’observation S donné, si S augmente, le nombre de sources N augmente également.
Dans un bassin versant de forme plus allongé, le rapport de confluence est plus élevé. Plus le coefficient de bifurcation est bas, plus l’arborescence du réseau hydrographique est étendue.
Un coefficient de bifurcation bas renvoi à un bassin de forme ramassé ou arrondi. Le résultat obtenu dans notre cas d’espèce démontre que l’arborescence du réseau hydrographique est bien développée bien qu’il soit moins dense.
Cela accroit rapidement le débit des eaux le long du réseau hydrographique un paramètre très important dans la prévention des crues.
Le rapport de longueur du réseau hydrographique de Horton
𝑳𝒙+𝟏
𝑹𝒍 =
𝑳𝒙
Où : 𝑳𝒙+𝟏 est la longueur moyenne des tronçons de rivière supérieur à l’ordre 1 selon Strehler 1 217m
et 𝑳𝒙 la longueur moyenne des tronçons de rivière d’ordre 1 selon Strehler 450 m
Le rapport de longueur du réseau hydrographique est de 2,70
Le rapport de longueur éclaire sur la longueur des ordres des rivières du réseau hydrographique. Ces deux indicateurs (rapport de confluence et rapport de longueur) sont parfois constants, mais en pratique, ne doivent pas être très éloignés l’un de l’autre.
Le rapport de longueur est inférieur à 5 si les tronçons de rivière ne sont pas très longs, comme dans la majorité des bassins arrondis, et supérieur à 10 si les longueurs des tronçons de rivières sont très importantes, comme dans la majorité des bassins allongés.
Il tombe donc évident dans notre cas d’espèce que les tronçons de rivière de même ordre selon Strehler ne sont pas très longs comparé à la superficie du bassin. Une architecture pareille multiplie rapidement le débit des eaux le long du réseau hydrographique.
Les profils en long et en travers des cours d’eaux
Les profils en long des quatre cours d’eau principaux du bassin révèlent une inégalité de longueur et d’intensité des pentes (figure 14). En lisant et en comparant les profils en long, on peut comprendre si un cours d’eau est loin, ou proche de son profil d’équilibre.
On constate dans les profils que, plus la pente est accentuée, et moins la longueur du cours d’eau est importante.
Cela est un indicateur dans la classification de la taille des cours d’eaux. Les cours d’eaux les plus longs ont les débits les plus importants et par ricochet, les plus importantes crues sont localisées à l’endroit de ces dernières.
Partant de cette loi, nous pouvons classer les cours d’eau par débit sans les quantifier : La rivière du Tongo-bassa aurait donc le plus grand débit, suivit du Ngongue, puis du Nkondi, et enfin du Ngim.
De même, l’ampleur des crues pourrait épouser la même graduation.
[16_solutions-pratiques-pour-la-prevention-des-inondations-a-douala_13]
Profil en long du Ngim
Profil en long du Nkondi
Profil en long du Ngongue
Profil en long du Tongo-Bassa
Source : Tchameni Franck DIT 2017
77
Figure 14 : Profil en long des principales rivières du bassin. Du haut vers le bas, le Ngim, le Nkondi, le Ngongue et le Tongo-Bassa
[16_solutions-pratiques-pour-la-prevention-des-inondations-a-douala_14]
Profil en travers du Ngim
Profil en travers du Nkondi
Profil en travers du Ngongue
Profil en travers du Tongo-bassa
Source : Tchameni Franck DIT 2017
Figure 15 : Profil en travers des principales rivières du bassin. Du haut vers le bas, le Ngim, le Nkondi, le Ngongue et le Tongo-Bassa.
Les profils en travers des quatre cours d’eau principaux révèlent la forme et l’encaissement des vallées au milieu du parcours des cours d’eaux (figure 15). On constate que, plus la vallée est encaissée (forte hauteur et forte pente), et moins le cours d’eau est long.
Mais le plus frappant est la forme des vallées. Elles passent progressivement de la forme V à la frome U au fur et à mesure que le débit devient important, renseignant ainsi d’une manière graduelle sur la taille, l’âge, et l’intensité du travail des différents cours d’eaux : autant d’indicateur très utiles dans la prévention des crues.
La carte physique suivante révèle les coupes et les profils reliant les zones stratégiques du bassin versant.
[16_solutions-pratiques-pour-la-prevention-des-inondations-a-douala_15]
Source : Azimut Geocarte, CUD, DIGAC, Tchameni Franck DIT 2017
Figure 16 : Modèle du relief du bassin du Tongo-Bassa
Questions Fréquemment Posées
Quel est le rapport de confluence dans le bassin versant du Tongo-Bassa?
Le rapport de confluence est de 3,03, ce qui indique que l’arborescence du réseau hydrographique est bien développée.
Comment le coefficient de bifurcation affecte-t-il la prévention des inondations?
Un coefficient de bifurcation bas renvoie à un bassin de forme ramassé ou arrondi, ce qui accroit rapidement le débit des eaux le long du réseau hydrographique, un paramètre très important dans la prévention des crues.
Quels cours d’eau ont les débits les plus importants dans le bassin du Tongo-Bassa?
La rivière du Tongo-Bassa aurait le plus grand débit, suivie du Ngongue, puis du Nkondi, et enfin du Ngim.
