L’analyse comparative des MTI révèle des applications révolutionnaires dans la sphère oro-faciale, transformant le traitement des pathologies complexes. Découvrez comment ces thérapies innovantes, allant de la thérapie génique à l’ingénierie tissulaire, pourraient redéfinir les pratiques médicales en Algérie.
Médicaments de la thérapie génique :
Définition légale :
Un médicament de thérapie génique est un médicament biologique qui possède les caractéristiques suivantes :
- il contient ou constitue un acide nucléique recombinant utilisé ou administré à des personnes en vue de réguler, de réparer, de remplacer, d’ajouter ou de supprimer une séquence génétique ;
- son effet thérapeutique, prophylactique ou diagnostique est directement lié à la séquence d’acide nucléique recombinante qu’il contient, ou au produit de l’expression génétique de cette séquence.
On retrouve deux types de thérapie génique : la thérapie génique in vivo et la thérapie génique ex vivo.
Cette thérapie a été initialement conçue comme une approche thérapeutique destinée aux malades monogéniques (liée à la dysfonction d’un seul gène), délivrant aux cellules un gène « sain » capable de suppléer le gène « malade ». Aujourd’hui, les modalités et les indications se révèlent beaucoup plus larges, avec 65% des essais cliniques qui concernent le traitement des cancers, les approches se sont beaucoup diversifiées, reposant sur différentes stratégies correctives, vecteurs et modalités de thérapies géniques.
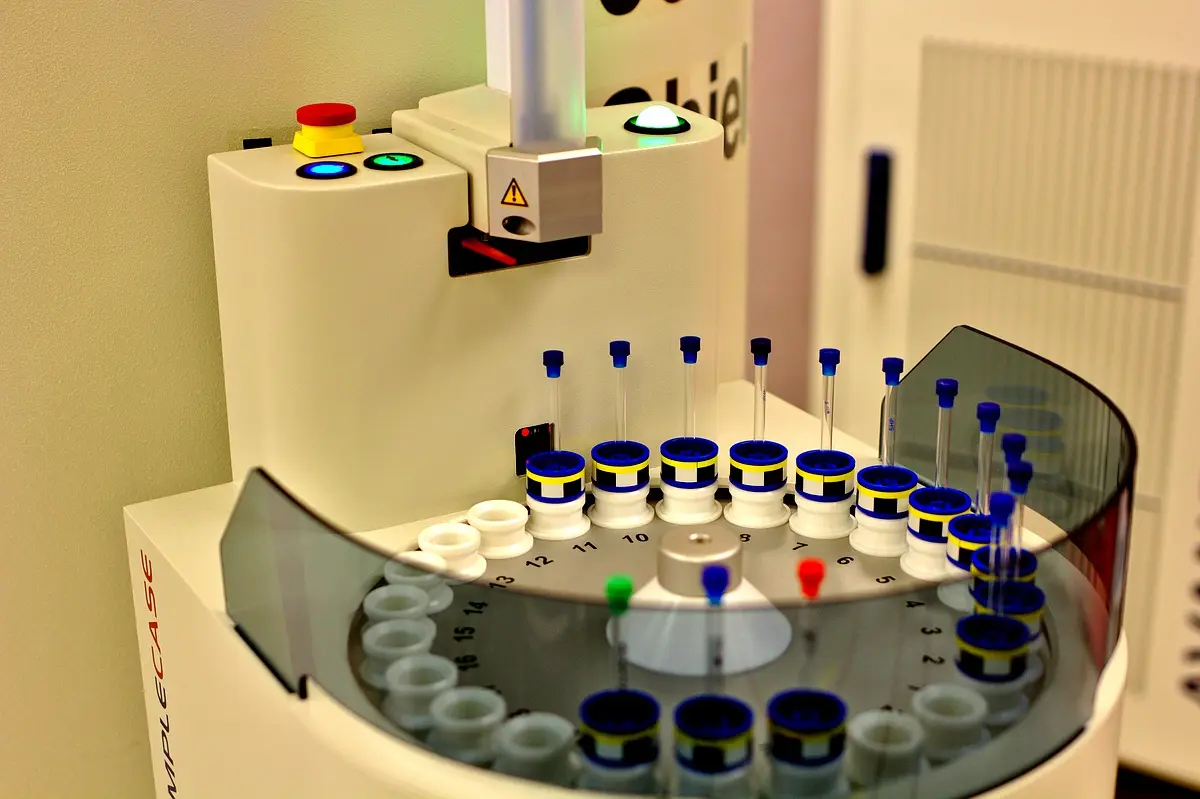
Corriger un gène défectueux implique d’abord de connaître le gène et le rôle de la protéine qu’il encode. Ensuite, l’isolation de gène non muté à partir des cellules saines en le munissant de séquences indispensables à sa régulation permettra d’insérer la
« construction génique » dans un vecteur sous forme d’un virus désactivé. L’étape ultérieure est d’injecter les vecteurs modifiés « ex vivo » ou « in vivo » chez le malade espérant de conférer une modification thérapeutique durable (figure 13).
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_78]
Source: URL
EX VIVO : injection des cellules modifiées génétiquement
IN VIVO : injection directe
Figure 13 : Stratégie des thérapies géniques.[57]
Les vecteurs transporteurs de gènes :
L’étape cruciale de la thérapie génique est de faire pénétrer le transgène dans l’organisme du patient, pour cela le vecteur doit promouvoir l’interaction spécifique avec la cellule cible (ciblage cellulaire), assurer la pénétration intra cytoplasmique, transporter le gène recombiné jusqu’au noyau et assurer le maintien stable de l’expression du gène thérapeutique. Il existe actuellement différents types de vecteurs : les vecteurs viraux : ce sont les plus efficaces, mais peuvent déclencher des réponses immunitaires ou promouvoir des cancers en s’insérant dans certaines séquences du génome et les vecteurs non viraux qui ont été conçus pour leur facilité de fabrication et pour assurer le transport de grandes quantités d’ADN.
Vecteurs type Rétrovirus | Vecteurs type Lentivirus | Vecteurs type adénovirus | Vecteurs type Virus‐Adéno associés(AAV) | Vecteurs non‐ viraux | |
Capacités d’empaquetage | 8.0 kb | 8.0 kb | 30.0 kb | 4.8 kb | Illimité |
Facilité de production | + /‐ | +/‐ | Difficile | +++++ | |
Intégration dans le génome de l’hôte | Oui | Oui | Non | Rarement (<10%) | Rarement |
Tropisme cellulaire | Uniquement dans les cellules qui se devisent | Large spectre | Large spectre | Large spectre | Large spectre |
Expression dans le temps | Long terme | Transitoire | Long terme dans les cellules post‐ mitotiques | Généralement transitoire | |
Réponse immunitaire | Faible | Faible | Elevée | Relativement faible | Faible |
Problème de sécurité | Mutagène | Mutagène | Réponse inflammatoire | Aucune | Aucune |
Transmission dans les cellules germinales | +/‐ | Aucune | +/‐ | Aucune | |
Avantages | Expression stable dans les cellules filles | Expression stable dans les cellules filles | Transfert efficace dans la plupart des tissus | Non pathogénique | Non virulent |
Désavantages | S’intègre uniquement dans les cellules qui se divisent et risquent de développer des cancers au moment de l’intégration | Risque de développer des cancers au moment de l’intégration | L’enveloppe virale peut induire une forte réaction immunitaire | Transfert de petites séquences d’ADN | Assez inefficace concernant la transduction |
Tableau 1 : Propriétés des différents types de vecteurs en thérapie génique.
Les vecteurs viraux :
Les débuts de la thérapie génique ont été marqués par des accidents liés à l’utilisation de vecteurs viraux qui se sont introduits dans des organes non cibles, ou qui ont provoqué l’intégration du gène modifié dans des séquences dites « pro-oncogènes » de l’ADN du patient, déclenchant des cancers. Suite à ces accidents, les scientifiques ont développé des vecteurs viraux « domestiqués » plus sûrs et plus efficaces de sorte à réduire le risque d’insertion aléatoire dans le génome de l’hôte.
Les autres propriétés que les vecteurs doivent acquérir pour une utilisation optimale en médecine sont qu’ils doivent être produits en grande quantité, induire une faible réaction immunitaire et pouvoir intégrer des grands fragments d’ADN. Ces vecteurs sont impliqués dans 75% des essais cliniques de thérapie génique, trois familles se discernent à savoir les rétrovirus intégratifs avec une stabilité à long terme, les adénovirus non intégratifs et les virus associés aux adénovirus.
Les vecteurs viraux intégratifs :
Les vecteurs viraux intégratifs insèrent leur ADN (qui contient le gène thérapeutique) dans le génome de l’hôte, en conséquence, le gène thérapeutique est transmis aux cellules filles en cas de divisions cellulaires. C’est le cas des vecteurs lentiviraux dérivés de virus humains comme le VIH mais rendus inoffensifs.
Les vecteurs non intégratifs :
Quand il s’agit de faire pénétrer un transgène dans des cellules qui ne se divisent plus (cellules post-mitotiques), les vecteurs non intégratifs sont privilégiés. Avec ces vecteurs, le gène thérapeutique reste dans la cellule de l’hôte, mais sans s’insérer dans son génome. Il s’exprime pendant la durée de vie de la cellule et disparaît avec la mort de celle-ci.
Les adénovirus, virus à double brin sont des vecteurs non intégratifs très utilisés dans le passé et restent actuellement des vecteurs de choix en immunothérapie contre le cancer. Ils peuvent transporter de plus grandes séquences d’ADN que les virus intégratifs, même si la taille maximale des transgènes transportés reste parfois inférieure à celle de gènes humains, ce type de vecteur présente plusieurs avantages : il pénètre bien dans les cellules qui ne sont pas en division comme celles du foie, des muscles et les neurones,
il n’est pas très nocif et il est associé à un niveau élevé d’expression du gène thérapeutique. Cependant, comme le transgène n’est pas intégré dans l’ADN de la cellule hôte, son expression est transitoire impliquant une répétition régulière du traitement dans les maladies telles que la mucoviscidose.
Un autre point négatif est le développement de réactions immunitaires dirigées à l’encontre des vecteurs adénoviraux de la part de l’organisme hôte qui peuvent compromettre l’utilisation ultérieure de ces mêmes vecteurs chez un patient lors du renouvellement de la thérapie génique.
Les vecteurs dérivés de virus adéno-associés (ou AAV) :
Les virus associés aux adénovirus sont des virus à ADN simple brin appartenant à la famille des parvovirus, non pathogènes et très répandus chez l’homme, peu inflammatoires, plus sécuritaires et peuvent infecter les cellules en dehors des phases de mitoses.
Les vecteurs non-viraux :
Les vecteurs non-viraux sont plus faciles à produire, à manipuler et à stocker. Ce sont principalement des liposomes et ne sont pas virulents, ils restent très inefficaces au transfert d’une information génique puisqu’une fois injectés par voie intraveineuse, les vecteurs s’agrègent en particules de grande taille mécaniquement retenues et rejetées principalement par le poumon et le foie.
De plus, il faut au moins 100.000 molécules d’ADN par cellule cible pour qu’une seule séquence parvienne à pénétrer dans le noyau ce qui pourrait poser des problèmes de toxicité.
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_79]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_80]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_81]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_82]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_83]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_84]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_85]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_86]
Figure 14 : Les différents vecteurs utilisés lors des essais cliniques en thérapie génique (1989-2017).[20]
Généralement bien tolérée, la thérapie génique pourrait supplanter certains traitements de référence et être proposée en première ligne lorsque les études comparatives auront été réalisées. On voit donc aujourd’hui se mettre en place une nouvelle filière thérapeutique.
Modalité d’administration de la thérapie génique :
- GTMP EX VIVO : CAR-T :[61]
Consiste à modifier génétiquement les cellules en laboratoire avant de les réinjecter au malade.
Biologie et ingénierie des CAR T-cells :
L’idée consiste à prélever au patient des globules blancs spécialisés dans la reconnaissance et la destruction de cellules pathogènes (des lymphocytes T), puis à les « améliorer » en modifiant leur patrimoine génétique, à les faire multiplier, puis à les réinjecter au patient pour qu’ils détruisent les cellules tumorales présentes dans son organisme.
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_87]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_88]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_89]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_90]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_91]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_92]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_93]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_94]
[6_analyse-comparative-des-medicaments-de-therapie-innovante_95]
Figure 15 : Principe des CAR-T.[61]
Cette modification génétique va permettre aux lymphocytes T d’exprimer une molécule qui les rend particulièrement efficaces dans l’identification et l’élimination des cellules cancéreuses, les scientifiques appellent cette molécule « récepteur antigénique chimérique », Chimeric Antigen Receptor en anglais, ou encore CAR en abrégé.
Les CAR-T sont donc des lymphocytes T équipées d’une molécule CAR adaptée au cancer à traiter.
Les CARs sont des immuno-récepteurs synthétiques dont le domaine extracellulaire est généralement un fragment variable à chaîne unique (scFv) dérivé d’un anticorps qui reconnait spécifiquement une protéine à la surface d’une cellule tumorale.
Les CAR anti-CD19 (les premiers à avoir été utilisés avec succès pour le traitement des patients ayant une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL)), les deux premières générations de CAR utilisaient la région transmembranaire de CD8 ou de CD4 et Pour obtenir les CAR, les lymphocytes T sont activées par un cocktail d’anticorps monoclonaux anti-CD3 (comme OKT3) et anti-CD28 couplés à des billes puis par l’IL-2 et enfin infectées par un virus recombinant codant le récepteur chimérique.
1ere Génération
2ème
énération
3ème Génération
4ème Génération
Figure 16 : Générations améliorées des CAR-T.[60]
- IN VIVO :[27]
La thérapie génique in vivo consiste en un transfert direct des gènes soit par injection systémique dans la circulation sanguine soit par injection locale au niveau d’un tissu ou organe. On peut citer comme exemple ici le transfert direct des gènes par injection au niveau de la rétine dans les approches de thérapie génique de certaines maladies génétiques affectant la vision.
Un autre exemple est celui des dystrophies musculaires d’origine génétique dans lesquelles l’objectif pourrait être d’effectuer un transfert de gènes dans différents muscles et ceci par injection directe dans le muscle ou par injection dans la circulation sanguine.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce qu’un médicament de thérapie génique?
Un médicament de thérapie génique est un médicament biologique qui contient ou constitue un acide nucléique recombinant utilisé pour réguler, réparer, remplacer, ajouter ou supprimer une séquence génétique.
Quels sont les types de thérapie génique?
On retrouve deux types de thérapie génique : la thérapie génique in vivo et la thérapie génique ex vivo.
Comment fonctionne la thérapie génique?
La thérapie génique implique d’abord de connaître le gène et le rôle de la protéine qu’il encode, puis d’isoler un gène non muté et de l’insérer dans un vecteur sous forme d’un virus désactivé pour l’injecter chez le malade.
Quels sont les vecteurs utilisés en thérapie génique?
Il existe différents types de vecteurs en thérapie génique, notamment les vecteurs viraux comme les rétrovirus, lentivirus, adénovirus, et les vecteurs non viraux, chacun ayant des propriétés spécifiques.