L’étude de cas sur la création révèle comment la théologie biblique peut offrir des solutions novatrices à la crise écologique actuelle. En s’inspirant de Saint François d’Assise, cette recherche propose une transformation nécessaire des relations entre l’homme, la nature et le Créateur, avec des implications cruciales pour notre avenir.
La perspective biblique de la création chez Paulin Poucouta.
Se basant sur la pluridisciplinarité de la science écologique l’auteur soutient que
« la théologie biblique de la création est un point de départ d’une théologie africaine de l’écologie »455. Bien que le langage écologique ne soit pas celui de la bible dont les auteurs n’avaient pas la même connaissance du monde qu’aujourd’hui, il est impératif d’interroger les écritures pour fonder tout discours théologique sur la création.
Deux récits complémentaires
L’auteur s’appuie sur les deux premiers récits de la création dans la bible. Il s’agit de (Gn 1,1-2,4a) attribué à la tradition exilique sacerdotale, et celui de (Gn 2,4b-3,24) attribué à la tradition yahviste. Le récit sacerdotal désigné aussi comme récit cosmogonique est « un hymne au créateur qui a une fonction liturgique soutenue par l’importance accordée au sabbat comme clou de la semaine laborieuse »456. Ce récit se présente comme une cosmogonie à l’instar de celles des peuples orientaux environnements.
« Le récit yahiviste est plutôt anthropogonique, plus centré sur le couple humain, sa création et son destin »457. Il est construit de manière d’un conte où Dieu est présenté comme un potier qui crée le couple humain et le place dans un jardin. Bref, le récit yahviste est centré sur le projet de Dieu sur la création et sur la place centrale de l’homme dans ce projet divin. En fait, c’est avec l’homme que Dieu peut dialoguer comme avec un vrai partenaire.
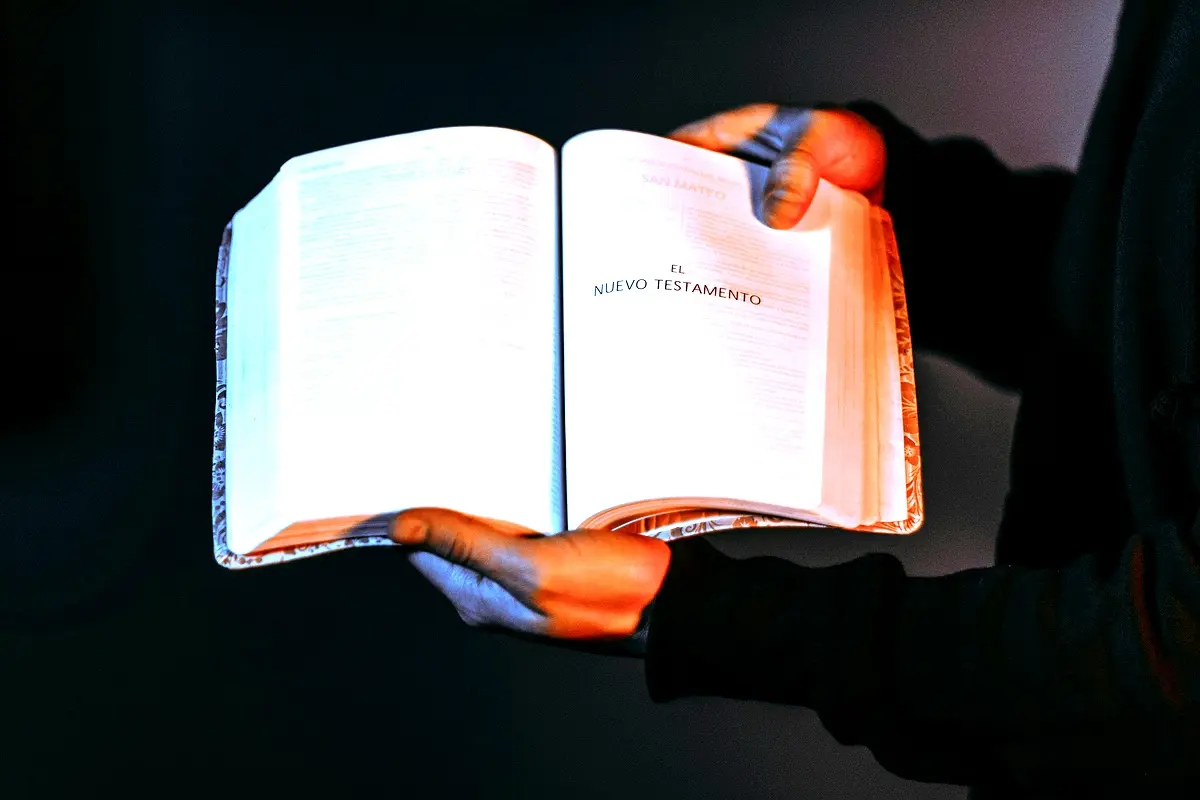
On le voit, les deux récits ci-haut bien que différents au point de vue stylistique et théologique, se rejoignent et ils sont fondamentalement complémentaires. « Les deux passages sont avant tout une hymne au Dieu créateur, présenté soit comme un architecte, soit comme un potier ».458 Ils sont aussi une tentative de désacralisation du cosmos pour contrecarrer sa sacralisation dans les religions cosmogoniques orientales. Enfin, ces passages visent tous « à donner une place primordiale à l’être humain, centre de la création chez le yahiviste et sommet de la création chez le sacerdotal »459. Voyons maintenant la place de l’homme dans la création.
L’homme dans la création
L’auteur soutient qu’au-delà de la protestation contre la sacralisation du monde naturel, les textes bibliques exaltent la dignité du couple humain. Rappelons que dans les cosmogonies orientales460, la place de l’homme dans l’univers était plutôt présentée comme celle d’un esclave. « Les auteurs bibliques réagissent contre la soumission de la personne humaine aux forces de la nature ».461 Le couple humain est créé à l’image de Dieu, capable de raison d’amour. Ainsi pour les auteurs sacrés le Dieu créateur est aussi le Dieu libérateur. Ils établissent un double lien entre la création divine et l’humanité : celui de son établissement pour que l’homme vive et celui de son inauguration d’une histoire dans laquelle l’homme est responsable »462.
Mais cet apparent anthropocentrisme biblique ne serait-il pas la cause d’une relation difficile entre les judéo-chrétiens et reste de la création ? Plusieurs penseurs s’y accordent. Pour eux, la théologie judéo-chrétienne trop anthropocentrique serait à l’origine du manque de respect à l’endroit de la création. Teilhard de Chardin prône la correction de cet anthropocentrisme biblique.
Pour lui, « l’homme n’est pas le centre statique du monde, mais un centre dynamique et contingent. Il n’est que le sommet momentané d’une anthropogenèse couronnant elle-même une cosmogénèse »463. Pour l’auteur, il serait inopportun d’ignorer ces critiques au risque de tomber dans la naïveté. Il épouse la réflexion de Ronald A.
Simkins qui comporte deux éléments : « une inaltérable distinction entre Dieu le créateur et la création et une corrélation entre l’humanité et le reste de la création ».464 Il est vrai que durant les siècles il y a eu soit une insistance sur la domination absolue de l’homme sur la création, soit sa soumission.
Toutefois, la Bible propose des relations harmonieuses entre l’homme, Dieu et la création, entre l’homme et la création et ainsi une cosmo-théandricité harmonieuse.
Dans la perspective de l’auteur, la désacralisation de la création va de pair avec le respect de toute l’œuvre de Dieu. « Bien que l’homme ait un grand dessin, il reste fragile, il est pétri de la terre et il et mortel. Tiré de la poussière il est appelé à y retourner ».465 Il est fait à l’image de Dieu mais il fait partie de la création.
Comme l’affirme l’apôtre Paul, « la création toute entière gémit en travail d’enfantement » (Rm 8,22), et pour l’auteur de l’Apocalypse, l’événement du règne eschatologique de Dieu se manifeste par « des cieux nouveaux et une terre nouvelle », (Ap 21,5). Il s’agit ici d’une réalisation plénière de la personne qui se fait avec Dieu et avec l’environnement naturel.
« En somme, la vision biblique de la création est en même temps bio-centrique, anthropocentrique et théocentrique ».466
L’éthique écologique biblique
L’auteur affirme que la théologie biblique de la création nous propose une éthique biblique écologique. « L’autorité de l’homme sur le reste de la création et celle d’un gestionnaire responsable, scrupuleux et respectueux ».467 Comme les autres aspects de l’existence, l’écologie est essentiellement un problème éthique dont la référence est Dieu. Ainsi l’homme est appelée à utiliser la terre dans la justice et la charité. En plus,
« l’éthique écologique biblique met l’homme au centre, sans quoi on retombe dans l’idolâtrie de la nature et de l’environnement »468. Dans cette perspective, un combat pour l’environnement est un combat pour l’homme. Aimer le monde avec passion ce sera toujours se battre pour les humains en pèlerinage sur terre commune et aussi se battre pour la qualité de leur vie. Mais cela signifie toujours, « maintenir ouverte la double brèche qui distingue l’être humain de l’homo technicus et la nature de la divinité ».469
________________________
455 P.POUCOUTA, art.cit., p.172. ↑
460 L’auteur donne comme exemples l’Egypte où les cosmogonies sont nombreuses et diverses. Il évoque le récit de la création par Atum, gravée sur les parois de pyramides et dont témoigne également la cosmogonie héliopolitainne. Ici la création est l’œuvre non pas de la divinité suprême, mais des démiurges. Elle est conçue comme engendré par les dieux, ou fabriquée par un dieu potier ou métallurgiste, ou encore le fruit de la pensée et de la parole du démiurge. Il va de même pour les cosmogonies babyloniennes qui sont toutes liées à une sacralisation du cosmos. Cf. Ibidem., p. 175. ↑
462 P. GIBERT, Principe d’écologie et idée de la création, dans Ecologie et création – Lumière et Vie, n° 214, (1993), p.82. ↑
463 Cf. P. TEILHARD DE CHARDIN, Le phénomène humain, Paris Seuil, 1995, p. 58. ↑
464 Cf. R.A.SIMKINS, Creator and Creation. Nature in the worldview of Ancient Israel, Massachusetts, Hendrickson, 1994, p. 253. Cité par P. POUCOUTA, art.cit. p.178. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la thèse de Lynn White Jr. sur la crise écologique?
Lynn White Jr. attribue les racines historiques de la crise écologique à l’anthropocentrisme du christianisme occidental.
Comment les récits de la création dans la Bible influencent-ils notre compréhension de l’écologie?
Les deux récits de la création dans la Bible, bien que différents, se rejoignent pour donner une place primordiale à l’être humain et tentent de désacraliser le cosmos.
Quel modèle écologique propose Saint François d’Assise?
Saint François d’Assise est présenté comme un modèle d’écologie intégrale, inspirant une transformation théologique nécessaire face à la crise écologique.