Les approches écologiques innovantes révèlent un paradoxe frappant : la crise écologique contemporaine trouve ses racines dans l’anthropocentrisme du christianisme occidental. Cette recherche propose une transformation théologique inspirée de Saint François d’Assise, essentielle pour rétablir l’harmonie entre l’homme, la nature et le Créateur.
La reconnaissance de la théorie par l’Eglise Catholique
Dans sa lettre encyclique Humani Generis (12 aout 1950), le Pape Pie XII avait déjà affirmé qu’il n’y avait pas d’opposition entre l’évolution et la doctrine de la foi sur l’homme et sur sa vocation. Cependant, selon lui « il fallait adopter l’attitude de prudence et de modération pour ne pas perdre de vue quelques points fermes émanant des sources de la révélation ».236 Egalement le Pape n’a pas voulu intégré dans le discours chrétien sur la création « les nouvelles connaissances obtenus par les sciences biologiques, paléontologiques et géologiques, ayant pour l’objet de reconstituer le passé lointain de l’homme ».237 Dans cette encyclique, le Pape condamne particulièrement la théorie du polygénisme.238
233 Ibidem, p. 31.
234 J-M, MALDAME, Création et évolution. L’évolution est-elle contre la création ? Conférence donnée à l’occasion de la présentation de son dernier livre : Création et providence. Bible, science et philosophie, Paris, Cerf, 2006. Consulté sur https://www.portstnicolas.org, le 30 avril 2019.
235 La sélection naturelle est l’un des mécanismes moteurs de l’évolution des espèces qui explique le succès reproductif différentiel entre des individus d’une même espèce et le succès différentiel des gènes présents dans une population. Elle est ainsi « un avantage ou un désavantage reproductif1, procuré par la présence ou l’absence de variations génétiques propices ou défavorables, face à un environnement qui peut se modifier2 », le système évolutif de la nature étant un immense jeu d’essais et d’erreurs.
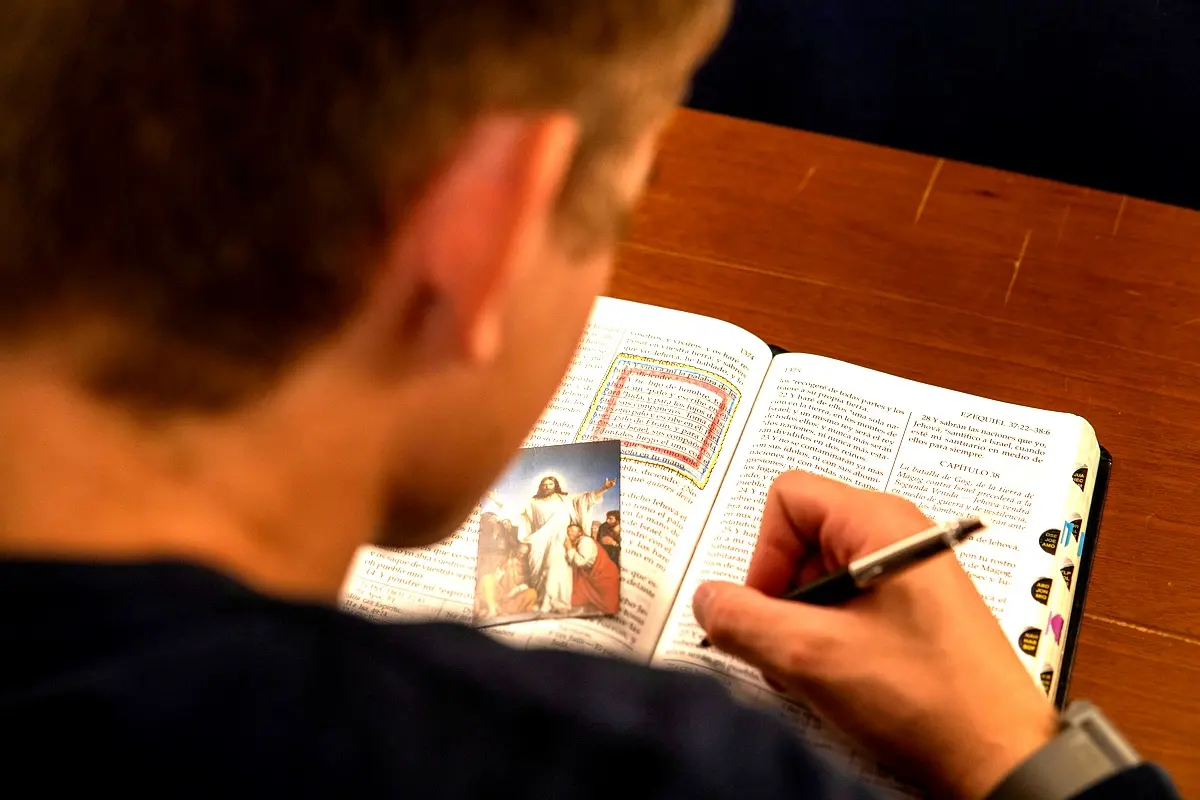
C’est un des aspects majeurs de la biodiversité, sur la planète, comme au sein des écosystèmes et des populations. La théorie de la sélection naturelle permet d’expliquer et de comprendre comment l’environnement influe sur l’évolution des espèces et des populations en sélectionnant les individus les plus adaptés, et elle constitue donc un aspect fondamental de la théorie de l’évolution.
C’est le fait que les traits qui favorisent la survie et la reproduction dans un milieu donné voient leur fréquence s’accroître d’une génération à l’autre. Cela découle « logiquement » du fait que les porteurs de ces traits ont plus de descendants, et aussi que ces derniers portent ces traits. Consulté sur https://fr.wikipedia.org/wiki, le 26 avril 2019.
236 PIE XII, Lettre encyclique Humani Generis, dans AAS, n° 42, (1950), p. 575-576. Pour le Pape Pie XII, toutes les conclusions devraient se soumettre au jugement de l’Eglise à qui le mandat a été confié par le Christ d’interpréter avec autorité les Saintes Ecritures et de protéger les dogmes de la foi.
237 A.KUMBU KI KUMBU, art.cit., p. 230.
238 Le polygénisme est une théorie qui affirme ou bien qu’après Adam il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle, ou bien qu’Adam désigne tout l’ensemble des innombrables premiers pères. Cette théorie ne s’accorde pas avec ce que les sources de la vérité révélée et les Actes du magistère de l’Eglise enseignent sur le péché originel.
Quant au Pape Jean Paul II, son pontificat a marqué un tournant décisif dans l’acception de la théorie de l’évolution. Dans son message adressé à l’Académie pontificale des sciences, il a surtout reconnu la valeur de la théorie de l’évolution. La mention par le Pape de l’évolution comme théorie, et non plus seulement comme hypothèse, mérite d’être soulignée. Il affirme ;
Aujourd’hui […], de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse. […] La convergence, nullement recherchée ou provoquée, des résultats des travaux menés indépendamment les uns des autres, constitue par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie […]. À vrai dire, plus que de la théorie de l’évolution, il convient de parler des théories de l’évolution. Cette pluralité tient, d’une part, à la diversité des explications qui ont été proposées du mécanisme de l’évolution et, d’autre part, aux diverses philosophies auxquelles on se réfère239.
Tout en faisant un pas en avant par rapport à Pie XII, le Pape Jean Paul II distingue soigneusement entre la théorie scientifique de l’évolution et les philosophies de ses promoteurs ou adversaires. Il met en garde à l’égard des lectures réductionnistes tant matérialistes que spiritualistes.
Le commencement et l’Origine.
Pour répondre aux « difficultés soulevées par la théorie de l’évolution »,240 l’auteur développe une distinction classique entre « le commencement » et « l’origine ». Cette
lequel procède d’un péché réellement commis par une seule personne Adam et, transmis à tous par génération, se trouve en chacun comme sien. Cf. PIE XII, op.cit. p. 575
239 JEAN PAUL II, L’Eglise devant les recherches sur les origines de la vie et son évolution, Message à l’Académie Pontificale de Science (22 octobre 1996), dans La Documentation Catholique, n° 2148, le 17 novembre 1996, p. 952.
240 La théorie synthétique de l’évolution remet en cause plusieurs éléments de l’enseignement traditionnel de l’Eglise, affirmés par le Catéchisme de l’Eglise Catholique, tels que.
- Le problème chronologique : Personne aujourd’hui ne peut dire que le monde a été créé quelque quatre mille ans avant Jésus-Christ. La Terre s’est formée voici quelques 4, 5 milliards d’années. De même, personne ne saurait dire que l’humanité a été créée six jours après le commencement du monde – un vendredi matin.
- Le problème lié au lien entre la mort et le péché : Dans une cosmologie qui utilisait comme cadre la semaine, on pouvait imaginer qu’avant la faute de l’homme, la mort n’existait pas. On pouvait donc établir un lien strict entre la mort et le péché et, corrélativement, proposer un message de salut qui, libérant du péché, libérait de la mort. Or nous savons l’homme tard venu dans l’histoire des êtres vivants. La mort n’est pas le contraire logique de la vie, mais son revers.
- Le problème lié aux origines de l’humanité. Puisque l’homme est pris dans l’arbre évolutif, il est lui aussi soumis aux lois de la biologie : Il faut parler de l’avènement de l’humanité comme d’une
distinction n’est pas facile à faire, car le langage courant confond les deux termes. Cependant, en toute rigueur scientifique, il faut les distinguer. L’habitude prévaut même d’employer le pluriel et de dire les origines quand il s’agit du commencement. Il importe de préciser leur sens.
Le commencement
L’auteur précise que « le concept du commencement fait partie de l’expérience commune, où toute action se situe dans la durée, puisque tout ce que nous vivons est limité par un commencement et une fin ».241. On parle de commencement pour dire le premier instant d’un phénomène inscrit dans la durée. Or la durée est une série continue d’instants et, pour cette raison, la détermination du commencement ne se fait jamais de manière nette.
« Cela se fonde sur le fait qu’aucun événement n’est jamais séparé de ce qui le précède et qui le cause, ni de ses effets et implications subséquentes ; il se place dans une genèse continue ».242 Cette constatation permet de comprendre la difficulté devant laquelle se trouve la recherche scientifique du commencement. « Pour déterminer qu’un événement a été un commencement, il faut que l’esprit compare le passé et le présent ».243 Cela veut dire que lorsque l’état des connaissances change, l’esprit doit modifier son jugement sur le commencement. Pour cette raison, les connaissances biologiques et paléontologiques concernant le vivant ont modifié la notion de commencement de la vie remettant ainsi en cause les récits de création.
L’origine
La notion d’origine renvoie au « plan ontologique ou métaphysique ».244 L’esprit ne cherche pas à comprendre un instant donné, mais la totalité du phénomène étudié.
« L’origine nomme la condition constitutive de tout ce qui apparait dans le cours des
évènements et qui pour cette raison n’est réductible à aucun ».245 Ici l’esprit est en quête d’un ordre de causalité qui ne se réduit pas aux mécanismes adaptatifs, biologiques, génétiques et écologiques mais qui relève de l’explication philosophico-métaphysique.
Dire origine, « c’est reconnaitre un acte qui n’est pas limité à un moment du temps »246. L’auteur affirme que l’origine n’est pas un évènement parmi d’autres, mais la condition constitutive de tout instant pris dans le cours des événements de la cosmogénèse247 et de l’histoire de la vie. L’origine ne peut donc être dite par une théorie scientifique.
Ainsi un rapprochement entre le point zéro du modèle cosmologique, dit Big- Bang248 avec le fiat lux de la Genèse serait une confusion concordiste249. Etant donné que l’origine ne relevé pas de la méthode scientifique, dans la plupart des cultures, elle se dit de manière symbolique ou mythologique. « Cela vaut aussi pour les récits bibliques, qui, pour dire l’origine empruntent le langage du mythe et du symbole »250.
Ce n’est pas une
245 Ibidem.
246 Ibidem.
247 La cosmogénèse est une vision évolutive chère à Telhard de Chardin qui, au lieu d’être une vision en cosmos, c’est-à-dire statique ou cyclique, est une vision en univers évolutif et convergent, où Dieu se révèle d’abord comme l’avenir absolu, à travers un seuil d’extase. Il s’agit de formation du cosmos en évolution du cosmos. Consulté sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/pierre-teilhard-de-chardin le 28 avril 2018.
248 Le Big Bang (Grand Boum) est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l’origine et l’évolution de l’Univers. De façon générale, le terme « Big-Bang » est associé à toutes les théories qui décrivent notre Univers comme issu d’une dilatation rapide. Par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu’a connue l’Univers il y a 13,8 milliards d’années, sans que cela préjuge de l’existence d’un « instant initial » ou d’un commencement à son histoire.
La comparaison avec une explosion, souvent employée, est elle aussi abusive. Le terme a été initialement proposé en 1927 par l’astrophysicien belge Georges Lemaître, qui décrivait dans les grandes lignes l’expansion de l’Univers, avant que celle-ci soit mise en évidence par l’astronome américain Edwin Hubble en 1929. Le concept général du Big-Bang, à savoir que l’Univers est en expansion et a été plus dense et plus chaud par le passé, doit sans doute être attribué au Russe Alexandre Friedmann, qui l’avait proposé en 1922, cinq
ans avant Lemaître. Son assise ne fut cependant établie qu’en 1965 avec la découverte du fond diffus cosmologique, l’« éclat disparu de la formation des mondes », selon les termes de Georges Lemaître, qui attesta de façon définitive la réalité de l’époque dense et chaude de l’Univers primordial. Albert Einstein, en mettant au point la relativité générale, aurait pu déduire l’expansion de l’Univers, mais a préféré modifier ses équations en y ajoutant sa constante cosmologique, car il était persuadé que l’Univers devait être statique.
Consulté sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang le 28 avril 2019.
249 Sur ce point voir la réaction de l’inventeur du modèle d’univers en expansion, Georges Lemaître, en réaction à l’apologétique concordiste d’Edmund Whittaker identifiant le fiat lux de la Genèse avec la singularité initiale du Big-Bang, confusion reprise imprudemment par le Pape Pie XII. Ce dernier affirme,
« qu’il semble, en vérité, que la science d’aujourd’hui, remontant d’un trait des millions de siècles, ait réussi à se faire le témoin de ce fiat lux initial, de cet instant où surgit du néant, avec la matière, un océan de lumière et radiations, tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s’assemblaient en millions de galaxies.
Cf. Pie XII, Discours à l’académie des sciences, le 22 novembre 1951. Consulté sur http://lesmaterialistes.com/pie-xii-discours-academie-sciences-1951 le 30 avril 2019. G. LEMAITRE est en cela fidèle à la doctrine thomiste. En effet Thomas d’Aquin a montré que l’affirmation du commencement du monde ne peut être fondée ni en philosophie ni en science : « La foi seule établi que le monde n’a pas toujours été, et l’on n’en peut donner une preuve démonstrative » Cf.
Somme de Théologie, Ia, qu. 46, a.2.
250 J-M.MALDAME, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, p.189.
faiblesse, mais bien le moyen convenable pour dire la réalité de l’origine perçue dans une cosmologie où toutes les choses ont un commencement.
Une conséquence importante
Pour l’auteur, la distinction entre le commencement et l’origine permet de faire une clarification entre l’évolution et la création. La théorie de l’évolution se rapporte au commencement ; elle retrace une histoire de la vie dans un cadre d’explication homogène au cours du temps. Elle relève divers commencements puisque dans l’histoire universelle qu’elle retrace.
La théologie de la création quant à elle, répond à la question de l’origine. Elle n’est pas figée sur un seul instant – fut-ce le premier. Cette distinction permet donc de ne pas opposer théorie de l’évolution et théologie de la création. La première est une quête du commencement ; la seconde est une quête de l’origine.
Les deux sont invités à se rencontrer et à s’enrichir mutuellement.
________________________
236 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
239 JEAN PAUL II, L’Eglise devant les recherches sur les origines de la vie et son évolution, Message à l’Académie Pontificale de Science (22 octobre 1996), dans La Documentation Catholique, n° 2148, le 17 novembre 1996, p. 952. ↑
240 La théorie synthétique de l’évolution remet en cause plusieurs éléments de l’enseignement traditionnel de l’Eglise, affirmés par le Catéchisme de l’Eglise Catholique, tels que. ↑
241 J-M.MALDAME, Création par Evolution science, philosophie et théologie, p.184 ↑
247 La cosmogénèse est une vision évolutive chère à Telhard de Chardin qui, au lieu d’être une vision en cosmos, c’est-à-dire statique ou cyclique, est une vision en univers évolutif et convergent, où Dieu se révèle d’abord comme l’avenir absolu, à travers un seuil d’extase. Il s’agit de formation du cosmos en évolution du cosmos. Consulté sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/pierre-teilhard-de-chardin le 28 avril 2018. ↑
248 Le Big Bang (Grand Boum) est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l’origine et l’évolution de l’Univers. De façon générale, le terme « Big-Bang » est associé à toutes les théories qui décrivent notre Univers comme issu d’une dilatation rapide. Par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu’a connue l’Univers il y a 13,8 milliards d’années, sans que cela préjuge de l’existence d’un « instant initial » ou d’un commencement à son histoire. ↑
249 Sur ce point voir la réaction de l’inventeur du modèle d’univers en expansion, Georges Lemaître, en réaction à l’apologétique concordiste d’Edmund Whittaker identifiant le fiat lux de la Genèse avec la singularité initiale du Big-Bang, confusion reprise imprudemment par le Pape Pie XII. Ce dernier affirme, ↑
250 J-M.MALDAME, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, p.189. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la position de l’Eglise Catholique sur la théorie de l’évolution?
Dans sa lettre encyclique Humani Generis, le Pape Pie XII a affirmé qu’il n’y avait pas d’opposition entre l’évolution et la doctrine de la foi sur l’homme et sa vocation.
Comment le Pape Jean Paul II a-t-il influencé la perception de la théorie de l’évolution?
Le Pape Jean Paul II a reconnu la valeur de la théorie de l’évolution et a affirmé qu’il convenait de parler des théories de l’évolution, soulignant la pluralité des explications proposées.
Quelles critiques le Pape Pie XII a-t-il formulées concernant le polygénisme?
Le Pape Pie XII a condamné la théorie du polygénisme, affirmant qu’elle ne s’accorde pas avec les sources de la vérité révélée et les enseignements de l’Eglise sur le péché originel.