Les perspectives futures en théologie révèlent une nécessité urgente de repenser notre rapport à la création face à la crise écologique. En s’inspirant de Saint François d’Assise, cette recherche propose des approches novatrices pour rétablir l’harmonie entre l’homme, la nature et le Créateur.
140 Laudato Si, n° 59.
141 Ibidem.
142 Ibidem.
143 S.FOUCART, Climato-scepticisme, dans D. BOURG, & A. PAPAUX, (Dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2015, p. 167 ;
144 Ibidem.
Les causes de la crise écologique actuelle
De ce qui précède, il se dégage que la crise écologique et ses conséquences néfastes sur l’environnement humain sont plus que jamais évidentes. Il en ressort que lorsque la préoccupation pour le progrès économique et technologique n’est pas accompagnée d’une attention égale pour l’équilibre de l’écosystème, notre terre est inévitablement exposée à de sérieuses nuisances et autres conséquences dommageables pour le bien des êtres humains.
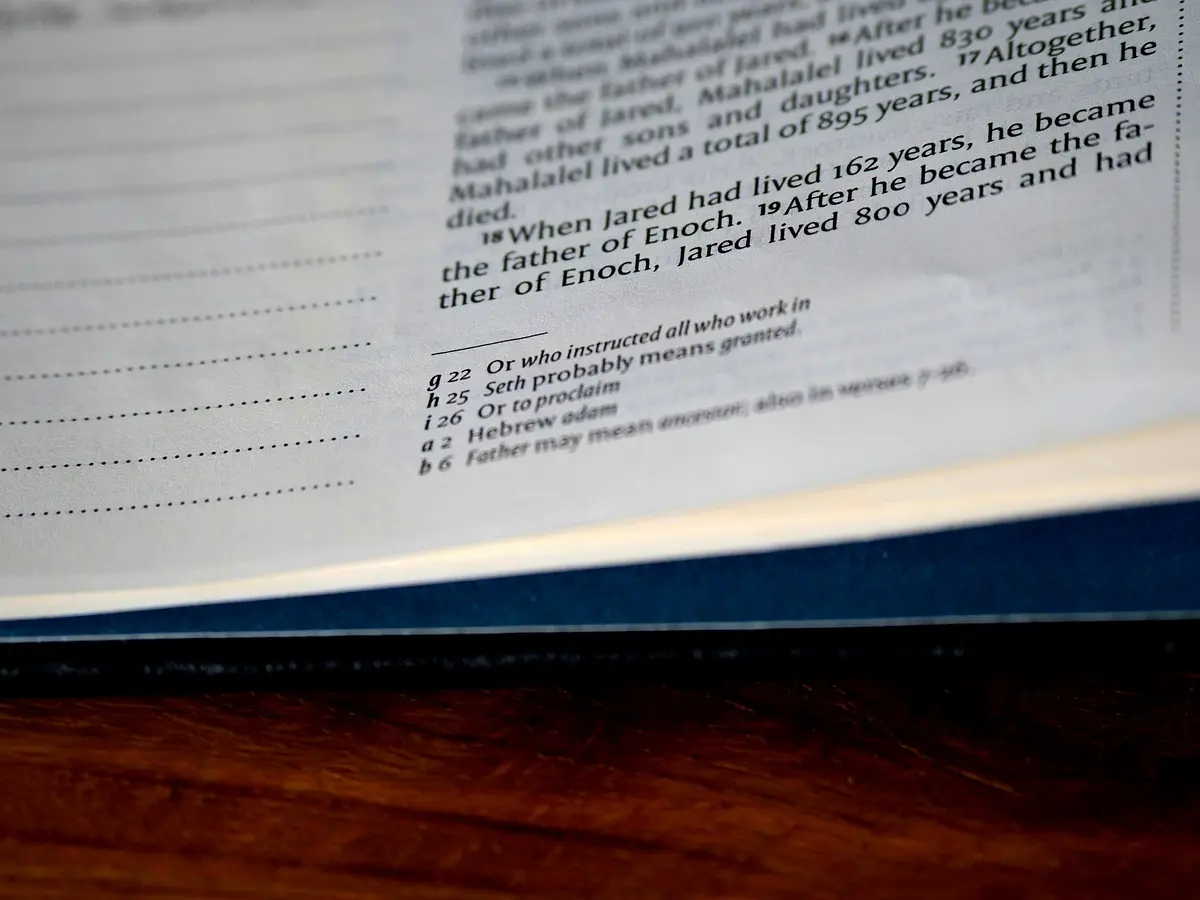
Nous explorons maintenant quelques causes possibles de cette crise.
La crise « moderniste »
Faisant le procès de la crise écologique actuelle, Jean-Michel Maldamé a placé la crise « moderniste » en tête des causes principales de la crise. Sans équivoque, il affirme
« qu’au temps où la pensée était dominée par la théologie, le regard sur le monde était plutôt théocentrique »145 : Dieu était reconnu comme le centre du monde, le principe et la fin ; il conduisait toute chose à son achèvement. A présent, « ce qu’il est convenu d’appeler ‘modernité’ a opéré un changement de centre dans la vision philosophique : le centre est devenu l’homme lui-même »146.
Devenu maître du monde, l’homme se croit capable de manipuler la nature comme il veut pour ses fins propres. Parmi les causes multiplies de ce déplacement, Maldamé fustige la naissance de la rationalité moderne, liée à l’essor des sciences exactes. Dès la Renaissance jusqu’au XVIIè siècle s’est développée une vision scientifique qui tend à rompre avec la physique antique d’Aristote tout en adoptant des nouveaux principes scientifiques comme ceux d’Isaac Newton147.
Suite à ces déplacements, la création a cessé d’être pensée comme l’action présente de Dieu. Elle est réduite à l’action initiale, le reste étant de l’ordre de la conservation. Autrement dit, l’acte du créateur est réduit au commencement, de sorte qu’ensuite l’univers suit un cours déterminé par les lois de la nature. Cette vision est à la base de deux conséquences ci-après :
Il y a d’abord le dualisme de type cartésien ou platonicien, qui s’accorde au spiritualisme, et qui tente d’opérer une séparation radicale entre l’ordre de la création et l’ordre du salut. Ici le monde des corps ne connaît pas de liberté car celle-ci est le propre de l’esprit strictement séparé de la matière. D’où la distinction cartésienne entre res extensa et res cogitans148, qui a son fondement dans un dualisme ontologique. Il y a donc
145J-M. MALDAME, Création et providence : bible, science et philosophie, Paris, Cerf, 2010, p. 152
146 Ibidem, p. 152.
147 Il s’agit en premier lieu du principe d’inertie solidaire, des principes de conservation de l’énergie et de conservation de la quantité de mouvement. Après l’acte premier de Dieu les mouvements qui s’ensuivent s’expliquent selon les lois de la mécanique et se déroulent infailliblement. Cf. Ibidem, p.152
148 Dans le cadre des philosophies idéalistes allemandes postérieures au cartésianisme (KANT et FICHTE), ce dualisme, hérité de la tradition néoplatonicienne, consistera à voir la nature comme ce qui est essentiellement non-moi (Nicht-Ich). Également en relation avec cette tradition, il faut mentionner l’influence
scission entre l’esprit et la matière, entre l’anthropologie et la cosmologie, entre la sotériologie et la théologie de la création »149. Par la voie de conséquence, Dieu est absent du cours ordinaire des choses même s’il garde le droit d’intervenir grâce à sa toute-puissance à travers les miracles. Cela explique une caractéristique essentielle de la théologie classique, à savoir : son ancrage dans la vie spirituelle et son insistance sur l’autonomie de la nature. Et parce qu’il est autonome, l’être humain est maître de son destin par le biais des sciences de la nature.
Il y a eu ensuite l’absolutisation de la raison dans la philosophie représentée par Baruch Spinoza, avec la fameuse formule : Deus sive Natura (Dieu ou la nature)150. Cette identification de la raison avec Dieu et avec la nature conduit à une forme de panthéisme151 spiritualiste. Dans cette perspective, la notion classique de la création est rejetée, car la nature est comprise comme autocréatrice. Elle est pour ainsi dire autosuffisante pour produire ses effets et se reproduire. « Elle n’est plus reconnue comme reposant sur la reconnaissance d’une altérité absolue et d’une liberté première »152.
L’humanisme athée
Selon Jean-Michel Maldamé, le procès de la crise écologique actuelle doit viser aussi l’humanisme athée153 qui a cautionné le pessimisme cosmique et le matérialisme scientifique154. Ce courant philosophique qui se fonde sur le rationalisme prône une conception de la nature qui ignore la profondeur des êtres. « Ce rejet de la profondeur de la réalité et l’enfermement dans le rationalisme ont comme conséquence la domination de la pensée positiviste »155. Selon ce courant, n’est réel que ce qui est saisi par la raison et par le calcul. Toute considération sur la finalité ou sur la dimension symbolique des êtres doit être
de la philosophie patristique qui a établi un lien étroit entre péché et nature. Cf. Gérard SIEGWALT, Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne, Tome III, Vol. 1, Genève, Paris, Labor et Fides, 1986-2000, p.145.
149 C.DOWNS, Mythe cosmogonique et dialogue scientifico-religieux, dans Théologiques, Vol. 9, n° 1, (2001), p. 99.
150 Ibidem.
151 Panthéisme : (du grec pan = toute chose et théos = Dieu) croyance que tout est Dieu, ou parfois aussi que tout est en Dieu. Chaque élément de l’univers est divin, et la divinité est également présente en toute chose. Cette vision ne laisse pas de place à Dieu comme personne distincte, tel que le conçoit le théisme classique. Il se distingue de panenthéisme qui affirme que Dieu est en tout.
152 J-M. MALDAME, Création et providence: bible, science et philosophie, p.154
153L’humanisme athée est à considérer en diverse formes telles que le marxisme, le nihilisme, l’existentialisme, libéralisme, scientisme, matérialisme etc.
154 Le matérialisme scientifique soutenu par les scientifiques comme Francis Crick et Jean-Pierre Changeux, stipule que seule la matière aveugle, inerte et non intelligente est auteur et substance du réel. Autrement dit, l’univers n’a aucune signification car le terme du processus cosmique c’est le néant.
155 J-M.MALDAME, Création et providence: bible, science et philosophie, p. 155.
tenue à distance dans un souci d’objectivité. Aussi, les considérations se rapportant à la métaphysique ou à la religion, domaines invérifiables, ne sont que des opinions n’ayant désormais aucun droit de cité. La vie religieuse est considérée comme stade enfantin du savoir, et la foi est réduite à une simple croyance subjective relevant de la naïveté. « La référence à l’action de Dieu est considérée comme une régression infantile qui exclut la valeur de la raison »156. De même, « la notion de création est comprise comme un préalable qui doit être écartée pour la conduite des travaux scientifiques, elle est considérée comme relevant des mythes des sociétés dites primitives »157.
Dans l’avis de John Haut, cette conception philosophique marquée par le ‘scepticisme cosmique’158 qui ronge le monde scientifique contemporain a des conséquences néfastes sur la compréhension du cosmos. Elle le définit selon une vision nouvelle soutenue par la science qui stipule que « nous vivons dans un univers absurde ou celui qui n’a pas de but ultime »159.
C’est la conception d’un « monde qui n’a pas d’origine transcendante, ni de destin divinement conçu »160. Selon l’auteur, ce pessimisme voit l’univers, la terre, la vie, la conscience humaine comme étant les produits du hasard, dans un processus non intelligible des événements émanant du processus impersonnel appelé sélection naturelle161.
Ainsi, étant donné qu’a priori il n’y a pas de sens et de but ultime dans le cosmos antérieur à l’émergence des espèces, il revient à l’homme de donner le sens aux choses. Pour les partisans de cette vision, l’homme doit se réjouir d’avoir découvert ce statut de créateur de sens qui a été antérieurement obscurci par les mythes religieux.
On le voit, ces sceptiques cosmiques, comme d’ailleurs les partisans du matérialisme scientifique, considèrent comme fausses toutes les visions et croyances religieuses. Par conséquent, la notion d’un Dieu créateur de toutes choses doit être évacuée du discours, afin de laisser le cosmos à la souveraineté humaine. Pour eux la téléologie cosmique est un mythe absurde.
156 Ibidem.
157 Ibidem.
158 Les grands partisans de cette vision sont surtout les scientifiques américains; Carl Sagan, E.O. Wilson and Stephen Jay Gould. Ils considèrent que toute vision de finalité dans l’univers est archaïque et illusoire.
159 J-F. HAUGHT, op.cit., p. 17.
160 Ibidem.
161 Ibidem.
________________________
145 J-M. MALDAME, Création et providence : bible, science et philosophie, Paris, Cerf, 2010, p. 152. ↑
147 Il s’agit en premier lieu du principe d’inertie solidaire, des principes de conservation de l’énergie et de conservation de la quantité de mouvement. Après l’acte premier de Dieu les mouvements qui s’ensuivent s’expliquent selon les lois de la mécanique et se déroulent infailliblement. Cf. Ibidem, p.152. ↑
148 Dans le cadre des philosophies idéalistes allemandes postérieures au cartésianisme (KANT et FICHTE), ce dualisme, hérité de la tradition néoplatonicienne, consistera à voir la nature comme ce qui est essentiellement non-moi (Nicht-Ich). Également en relation avec cette tradition, il faut mentionner l’influence ↑
149 C.DOWNS, Mythe cosmogonique et dialogue scientifico-religieux, dans Théologiques, Vol. 9, n° 1, (2001), p. 99. ↑
151 Panthéisme : (du grec pan = toute chose et théos = Dieu) croyance que tout est Dieu, ou parfois aussi que tout est en Dieu. Chaque élément de l’univers est divin, et la divinité est également présente en toute chose. Cette vision ne laisse pas de place à Dieu comme personne distincte, tel que le conçoit le théisme classique. Il se distingue de panenthéisme qui affirme que Dieu est en tout. ↑
152 J-M. MALDAME, Création et providence: bible, science et philosophie, p.154. ↑
153L’humanisme athée est à considérer en diverse formes telles que le marxisme, le nihilisme, l’existentialisme, libéralisme, scientisme, matérialisme etc. ↑
154 Le matérialisme scientifique soutenu par les scientifiques comme Francis Crick et Jean-Pierre Changeux, stipule que seule la matière aveugle, inerte et non intelligente est auteur et substance du réel. Autrement dit, l’univers n’a aucune signification car le terme du processus cosmique c’est le néant. ↑
155 J-M.MALDAME, Création et providence: bible, science et philosophie, p. 155. ↑
158 Les grands partisans de cette vision sont surtout les scientifiques américains; Carl Sagan, E.O. Wilson and Stephen Jay Gould. Ils considèrent que toute vision de finalité dans l’univers est archaïque et illusoire. ↑
159 J-F. HAUGHT, op.cit., p. 17. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les causes de la crise écologique actuelle selon l’article?
L’article mentionne que la crise écologique actuelle est principalement causée par la crise ‘moderniste’, où l’homme est devenu le centre de la vision philosophique, remplaçant Dieu.
Comment la pensée moderne a-t-elle affecté la théologie de la création?
La pensée moderne a opéré un changement de centre dans la vision philosophique, faisant de l’homme le maître du monde et réduisant l’acte créateur à l’action initiale, laissant l’univers suivre un cours déterminé par les lois de la nature.
Quel modèle est proposé pour une écologie intégrale dans la théologie de la création?
L’article propose Saint François d’Assise comme modèle d’écologie intégrale, inspirant une transformation théologique nécessaire face à la crise écologique.