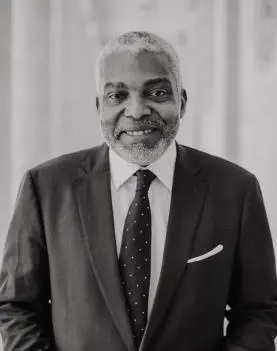Les applications pratiques des normes QSE révèlent des défis inattendus dans la gestion des conflits culturels en milieu professionnel. En examinant l’impact de la pandémie sur l’interaction humaine, cet article propose des solutions innovantes pour adapter les outils QSE aux réalités interculturelles, essentielles pour une coexistence harmonieuse.
Charte des droits fondamentaux de 2000 de l’UE, garante de l’interculturalité
Le conseil de l’Europe estime que, le respect et la promotion de la diversité culturelle, sur la base des valeurs qui sont le creuset de l’organisation, sont des conditions essentielles du développement de sociétés fondées sur la solidarité.
« Pour les besoins du livre blanc, le dialogue interculturel fait état d’un processus d’échange de vues ouvert et respectueux entre des personnes et des groupes de différentes origines et traditions ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, dans un esprit de compréhension et de respect mutuels. La liberté et la capacité de s’exprimer, mais aussi la volonté et la faculté d’écouter ce que les autres ont à dire, en sont les éléments indispensables »
- déploiement du dialogue interculturel intégré au champ d’application des normes QSE
Il s’agit ici de tous les informations nécessaires, à l’appréhension et la compréhension de l’enjeu multiculturel en milieu professionnel, ainsi que de son intégration au champ d’application des normes.
Le champ d’application de la norme est très souvent réduit à un périmètre circonscrit, et à un domaine d’exigence bien formalisé. Il peut aussi concerner très exceptionnellement toute l’organisation. Le système de management qualité consacre l’idée selon laquelle, la satisfaction du client doit être prise en compte, tout en respectant l’environnement et en protégeant les salariés.
Le capital humain, est donc présent à toutes les étapes fondatrices, organisationnelles et fonctionnelles de toute organisation. Par conséquent, davantage d’intérêt doit être porté à cette ressource inestimable au sein de l’organisation.
L’idée est d’améliorer les interactions entre les différents membres, aux appartenances culturelles plurielles constituant ce capital. Nous savons au demeurant que la culture ne se réduit pas seulement à l’appartenance ethnique, linguistique, religieuse…mais s’étend à l’appartenance à tout type de groupe. Ceci sans doute explique-t-il la complexité et la particularité de la culture européenne.

Dans sa communication « Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’UE » 26 /09/2012, la commission européenne reconnait que la culture est au cœur du tissu social ».
L’article E de la Charte sociale européenne, concernant tous les travailleurs, précise que leurs droits doivent être garantis sans discrimination. « La jouissance des droits reconnus dans la présente charte, doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur la race, la langue, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation ».
C’est ce schéma d’action qu’a adopté la France, dans le cadre de l’égalité entre les hommes et femmes, où un texte de loi du 27 janvier 201114, dite Copé-Zimmermann. Elle est relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.
Elle fixe un quota de 40% du sexe sous représenté dans les conseils d’administration au 1er janvier 2017, dans les entreprises cotées en bourse et dans les sociétés comptant plus de 500 salariés permanents et un chiffre d’affaires supérieur à 50M€. Là-dessus, la France est l’état européen le plus promouvant avec un taux d’environ 12%, l’Allemagne n’étant qu’a environ 6%.
Il demeure que, le salaire des femmes reste inférieur de 24% par rapport à celui des hommes. Les retraites 26% plus faibles que celles des hommes. Le taux de chômage des femmes est inférieur d’un point à celui des hommes, parce que huit fois plus de mères travaillent en temps partiels.
(voir en annexe, les différentes évolutions de la parité sociologique en Europe).
14 La loi ordinaire n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite loi Copé- Zimmermann ; NOR : MTSX1001906L ↑
Le protocole social15, annexe du traité de Maastricht contient des dispositions relatives à l’emploi, au dialogue social, à l’égalité entre les hommes et les femmes. Seul le Royaume-Uni sur les 12 Etats, s’est tenu en dehors du protocole. Plus tard, la Pologne et la République Tchèque ont eu des dérogations.
Cela étant posé, cette sous-partie aide à aller dans le détail de la compréhension du salarié, de ses attentes et frustrations, car avoir en permanence une vision globale de la situation peut cacher les problèmes, ainsi que leur impact sur les performances du salarié et de l’entreprise.
- Fondement anthropologique : La cognition sociale16
Cette extrapolation suggestive, constitue également l’une des données d’entrée dans l’analyse du multiculturalisme. La cognition sociale individuelle ou collective, renvoie à l’étude des processus par lesquels les gens donnent du sens à eux-mêmes, aux autres, au monde qui les entoure, ainsi qu’aux conséquences de ces pensées sur le comportement social.
La perception du monde varie en fonction des facteurs culturels : langue, valeurs, religion, croyance et codes culturels.
Il s’agit d’une combinaison de l’objectif et du subjectif. Très souvent l’émotionnel prend le dessus et rend les choses plus difficiles qu’elles ne le sont au fond. Il ne s’agit pas de nier ces particularités, plutôt de mieux les comprendre et les assumer.
C’est d’abord un travail individuel non pas de contrainte, mais de compréhension, de ce que l’on est fondamentalement, avec ses particularités, ses signes distinctifs, en vue de les apprivoiser. Dès lors que l’on se connait et s’assume comme tel, on comprend mieux les autres, et l’on devient également tolérant face aux imperfections, fêlures, limites des autres.
Les organisations devraient soumettre chaque salarié à une sorte de « Personal Branding » ou marketing personnel ou marketing de soi-même, afin de faire émerger une identité psychologique et professionnelle. L’individu doit être reconnu et identifié pour ces mérites, par l’entourage professionnel et surtout par les interlocuteurs (clients, prospects, recruteurs, employeurs).
Il s’agit d’évaluer les points de fragilité et de faiblesse, aussi bien que les compétences interculturelles : demander à chaque salarié d’expliquer les valeurs fondamentales de sa culture, ses possibilités d’ouverture et de créativité et s’auto-analyser dans ses tâches.
15 Protocole social, annexe du traité de Maastricht signé en 1992, par 11 Etats sur les 12 ↑
16 Article : Bless, Fielder et Strack, 2004 ; Fiske et Taylor, 2008 ↑
L’idée sous-jacente étant de mieux se connaître, mieux se faire connaître, mieux se faire reconnaître.
- Avantage compétitif du milieu professionnel diversement culturel
Seule une entreprise dont la valeur cardinale est la cohésion culturelle, peut réaliser tout son potentiel économique. Par conséquent, l’entreprise doit contribuer à la promotion de la diversité culturelle. Elle doit s’inspirer des bonnes pratiques en matière de compétences interculturelles, résultant de la réalisation d’un benchmarking.
Questions Fréquemment Posées
Comment les normes QSE peuvent-elles aider à résoudre les conflits culturels en milieu professionnel?
Les applications pratiques des normes QSE visent à améliorer les interactions entre les membres de différentes appartenances culturelles, en intégrant le respect de la diversité culturelle dans le champ d’application des normes.
Pourquoi la norme ISO 26000 est-elle limitée face aux tensions interculturelles?
La norme ISO 26000 présente des limites dans son approche impersonnelle des relations humaines, ce qui peut ne pas suffire à gérer les tensions interculturelles.
Quel impact la pandémie COVID-19 a-t-elle eu sur les relations humaines au travail?
La pandémie COVID-19 a accéléré la dépréciation du contact humain, soulignant la nécessité d’adapter les outils QSE aux risques interculturels.