Les stratégies d’implémentation RSE révèlent des écarts significatifs dans l’application de la norme ISO 26000 au sein de la briqueterie IZERKHAF. Cette étude met en lumière des pratiques innovantes et des défis cruciaux, offrant des solutions essentielles pour pérenniser la responsabilité sociale des entreprises dans un environnement économique instable.
D-Le rapport d’audit : L’auditeur souligne les écarts des résultats par rapport au référentiel du donneur d’ordre, ainsi que les points forts et les points faibles de la politique, des procédures, des moyens de l’entreprise. Il répertorie également les causes de non-conformité et les plans d’action mis en place pour les corriger59.
L’auditeur établie les moyens en particulier si l’entreprise a affecté les moyens nécessaires pour que la procédure permettant le respect du code de conduite en place soit efficace.
- Les caractéristiques du rapport d’audit :
Pertinence et matérialité : Les informations reprises dans un rapport doivent traiter des questions et indicateurs susceptibles d’influer sensiblement sur les décisions des parties utilisatrices du rapport. La pertinence et la matérialité sont des concepts qui contribuent à définir le contenu d’un rapport. Une organisation est confrontée à un large éventail de questions pouvant être abordées dans un rapport. Les questions et indicateurs pertinents sont ceux qui peuvent être raisonnablement jugés importants en ce qu’ils influencent les décisions de l’organisation et des parties utilisatrices du rapport et méritent dès lors l’inclusion potentielle dans un rapport.
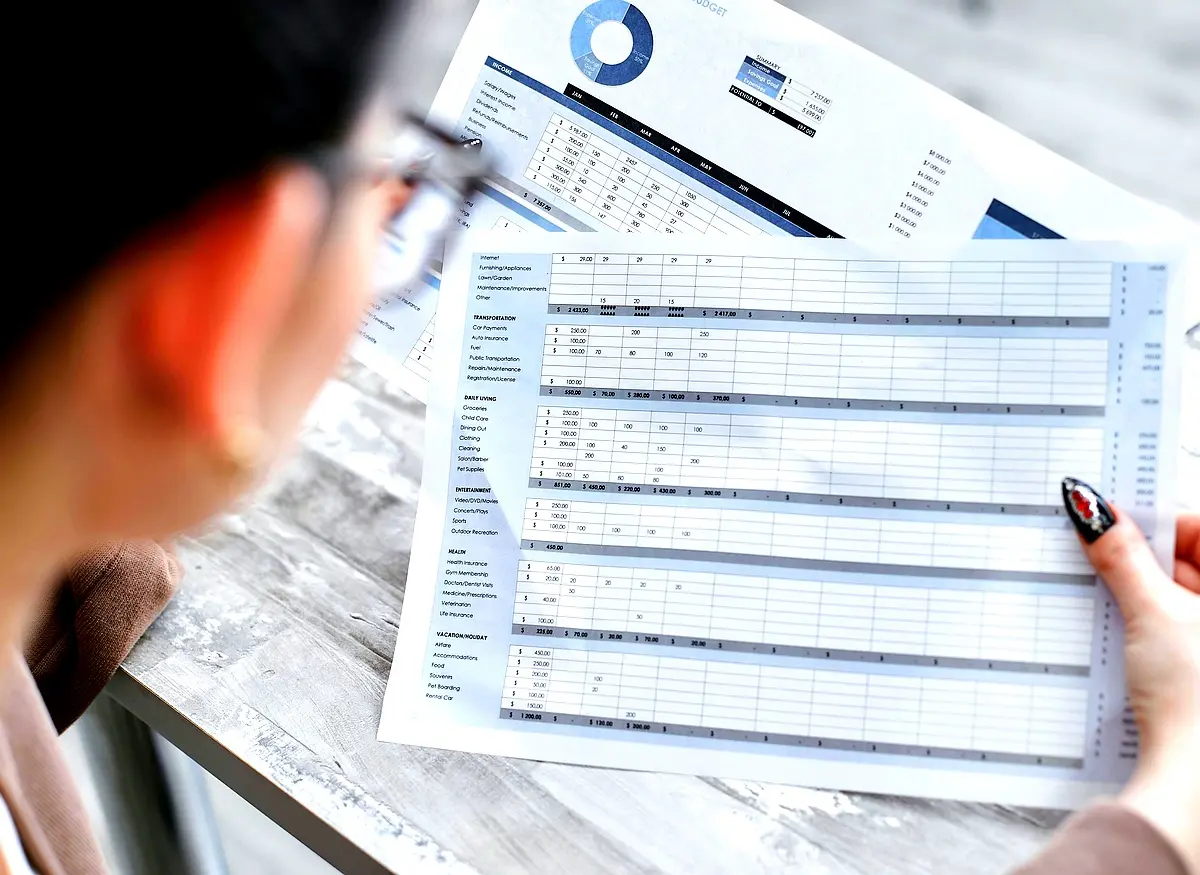
Contexte de durabilité : L’organisation doit présenter ses performances dans le contexte de durabilité pour autant que ce contexte présente une valeur d’interprétation significative.
Les informations relatives aux performances doivent être mises en contexte. La question qui sous-tend l’élaboration de rapports sur la durabilité est de savoir dans quelle mesure une
59 Combemale Martine, Igalens Jacques, op, cit, page 107.
organisation contribue à l’amélioration ou à la détérioration du cadre économique, environnemental et social au niveau local, régional ou mondial.
L’organisation qui se contente de rendre compte de l’évolution des performances individuelles (ou de son efficacité) ne parviendra pas à répondre à cette question. Dès lors, les organisations doivent rechercher le moyen d’exprimer leurs performances individuelles par rapport à la durabilité environnementale et sociale, dans un sens plus large.
Exhaustivité : L’exhaustivité renvoie à la fois aux pratiques de collecte d’informations et à l’évaluation du caractère fondé et approprié de la présentation des informations. L’exhaustivité intègre essentiellement les notions de portée, de limites et de temps. La portée fait référence à l’éventail des questions de durabilité abordées dans un rapport et supposées répondre aux attentes du principe de pertinence et de matérialité.
L’ensemble des questions et indicateurs traités devrait être suffisants pour permettre aux parties utilisatrices supposées du rapport d’évaluer les performances de l’organisation. Pour déterminer si cette information est suffisante pour les parties, il convient de se baser à la fois sur les procédures d’implication des parties et sur les grandes préoccupations sociales qui pourraient n’avoir pas été mises au jour dans le cadre de ces procédures.
Équilibre : Le rapport doit proposer une présentation équilibrée et raisonnable des performances de l’organisation. La présentation globale du contenu du rapport et des informations afférentes à des questions spécifiques doit offrir une image fidèle des performances de l’organisation et éviter toute sélection, omission ou format de présentation susceptible d’exercer une influence indue ou inadéquate sur les décisions et jugements du lecteur du rapport. Le rapport doit inclure les résultats favorables et défavorables et traiter toute question importante susceptible d’influencer les décisions des parties en fonction de leur matérialité. Il doit opérer une distinction claire entre la présentation des faits et l’interprétation des informations par l’organisation.
Comparabilité : L’information rapportée doit demeurer cohérente et être compilée et présentée d’une manière qui permette aux parties utilisatrices du rapport d’analyser l’évolution des performances de l’organisation au fil du temps et par rapport à d’autres organisations. La comparabilité est à la base de l’interprétation des performances. Les parties utilisatrices du rapport doivent être en mesure de comparer les informations relatives aux performances économiques, environnementales et sociales à l’aune des performances
antérieures et des objectifs de l’organisation, mais aussi des performances d’autres organisations.
La cohérence du calcul des données et de la présentation du rapport d’une année sur l’autre, ainsi que l’explication des méthodes et des hypothèses exploitées dans le cadre de la préparation de l’information, sont autant d’éléments qui facilitent la comparabilité. La cohérence permet aux parties internes et externes d’étalonner les performances et d’évaluer les progrès accomplis en vue d’estimer les activités, les décisions d’investissement, les programmes de soutien, etc.
Exactitude : L’information rapportée doit être exacte et suffisamment détaillée pour que les parties utilisatrices du rapport puissent prendre des décisions avec un degré de fiabilité élevé. Les réponses portant sur les questions et indicateurs économiques, environnementaux et sociaux peuvent revêtir différentes formes et aller des réponses qualitatives à des évaluations quantitatives détaillées.
Les caractéristiques permettant d’en définir l’exactitude varient selon la nature de l’information et l’utilisateur de celle-ci. Ainsi, l’exactitude des informations qualitatives est définie, dans une large mesure, par le degré de clarté et de détail et par l’équilibre de la présentation effectuée, dans le cadre des limites appropriées. L’exactitude des informations quantitatives peut en revanche dépendre des méthodes utilisées pour collecter, compiler et analyser les données.
Le seuil d’exactitude spécifique qui s’avérera nécessaire dépendra en partie de l’utilisation envisagée de l’information. Certaines décisions exigeront un niveau d’exactitude plus élevé de l’information rapportée.
Opportunité : L’information est présentée en temps opportun et sur une base régulière, afin que les parties utilisatrices du rapport puissent prendre des décisions fondées. L’utilité des informations dépend étroitement d’une mise à disposition opportune pour les parties prenantes. L’opportunité garantit l’utilité de l’information et permet aux utilisateurs d’intégrer effectivement cette dernière dans les décisions qu’ils prennent. S’il est souhaitable de disposer d’un flux d’informations régulier pour répondre à certains besoins, les organisations devraient s’engager à fournir à date précise un compte rendu consolidé de leurs performances économiques, environnementales et sociales. Cela exige d’être cohérent en matière de fréquence de publication, laquelle est nécessaire pour garantir la comparabilité au fil du temps et l’accessibilité du rapport pour les parties.
Clarté : L’information doit être proposée de manière compréhensible et accessible pour les parties utilisatrices du rapport. L’organisation doit examiner la manière de répondre aux
besoins des parties en matière de communication sans omettre d’informations importantes, mais en évitant les détails excessifs ou superflus. Pour ce qui est de l’information rapportée, la clarté exige que l’information soit présentée d’une manière qui permette aux parties de retrouver aisément les données désirées et qui soit compréhensible. L’utilisation de graphiques et de tableaux de données consolidées peut rendre l’information contenue dans le rapport intelligible.
Assurabilité : L’information et les procédures utilisées dans le cadre de la préparation d’un rapport doivent être consignées, analysées et présentées de telle sorte qu’elles puissent être examinées et soumises à assurance. Le concept fondamental qui sous-tend le principe d’assurabilité est que les parties doivent avoir la garantie de pouvoir s’assurer de la fiabilité du contenu et de l’application des principes d’élaboration.
Les processus décisionnels ayant présidé à l’élaboration du rapport doivent être documentés de manière à permettre l’évaluation du fondement des principales décisions (procédure d’implication des parties et procédures de définition du contenu et des limites du rapport). Les informations et données incluses dans le rapport doivent être accompagnées d’une documentation interne consultable par d’autres parties que les auteurs du rapport.
________________________
59 Combemale Martine, Igalens Jacques, op, cit, page 107. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les caractéristiques d’un rapport d’audit en RSE ?
Les caractéristiques d’un rapport d’audit incluent la pertinence et la matérialité, le contexte de durabilité, l’exhaustivité, l’équilibre et la comparabilité.
Pourquoi est-il important de présenter les performances dans un contexte de durabilité ?
Il est important de présenter les performances dans un contexte de durabilité pour évaluer dans quelle mesure une organisation contribue à l’amélioration ou à la détérioration du cadre économique, environnemental et social.
Comment un rapport d’audit peut-il garantir l’équilibre des informations ?
Un rapport d’audit doit proposer une présentation équilibrée et raisonnable des performances de l’organisation, incluant les résultats favorables et défavorables et évitant toute sélection ou omission qui pourrait influencer indûment les décisions des parties.