La classification des emprunts linguistiques révèle des dynamiques fascinantes entre le français moderne et l’arabe. En explorant les arabismes dans le discours médiatique, cette étude met en lumière leur impact socioculturel et leur rôle crucial dans la formation du vocabulaire contemporain, transformant ainsi notre compréhension de la langue.
La typologie des emprunts dans les travaux des linguistes contemporains
La linguistique générale est toujours à la recherche d’une classification générale valable de l’emprunt ou de l’interférence linguistique, c’est-à-dire de l’échange de matériel linguistique entre deux variétés de discours, principalement deux langues.
Dès le début des études interlinguistiques, certains auteurs ont tenté d’esquisser une classification des emprunts et des interférences. Cependant, cette tentative a toujours été semée d’embûches.
Premièrement, plusieurs façons de classer les contacts linguistiques peuvent être imaginées, et ces façons sont considérées comme complémentaires mais non réciproquement comparables.
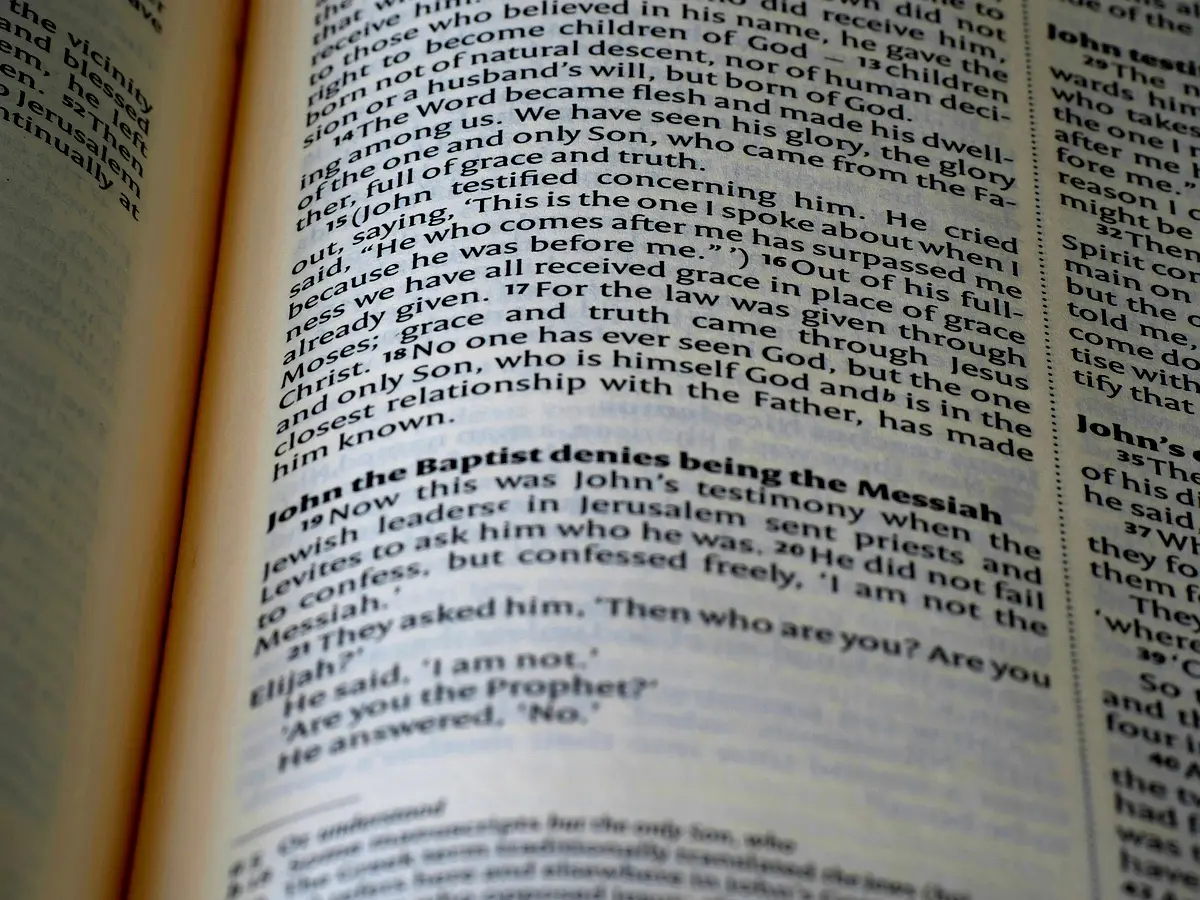
De plus, les classifications sont ressenties comme artificielles et sans pleine validité, les philologues proposant des catégories discrètes qui ne peuvent pas englober tous les facteurs impliqués dans une situation sociolinguistique donnée.
Beaucoup de linguistes, par exemple, André Martinet, Bernard Pottier, Pierre Guiraud, Jean-Claude Corbeil, trouvent trois grandes catégories d’emprunts linguistiques : emprunt lexical, emprunt syntaxique et emprunt phonétique.
Les emprunts lexicaux, aussi intégraux ou partiels, renvoient principalement au mot dans son rapport sens-forme. Ce trait le distingue des autres catégories, notamment des emprunts syntaxiques et des emprunts phonétiques.
Christiane Loubier affirme qu’il existe quatre types d’emprunts lexicaux 17 :
- L’emprunt intégral, aussi emprunt direct, est le résultat du transfert complet de la forme et du sens d’un élément lexical d’une autre langue avec ou sans adaptation. Par exemple: staff, lobby, démotion.
- L’emprunt hybride, dont le sens est complètement emprunté, et la forme – partiellement. Par exemple: dopage.
- Le faux emprunt c’est une unité léxicale dotée de qualités formelles d’une autre langue, mais qui n’existe pas dans cette langue ou a une signification différente. Par exemple: brushing.
- Le calque – la formation d’une nouvelle expression, d’un mot ou d’un nouveau sens d’un mot par la traduction littérale d’un élément de langue étrangère correspondant. Et on distingue:
- le calque morphologique – traduction morphémique d’un mot étranger. Par exemple:
supermarché (supermarket);
- le calque sémantique, c’est un emprunt du sens figuré du mot. Ce sont des mots natifs qui acquièrent un nouveau sens sous l’influence de mots correspondants d’une autre langue. Par exemples: réaliser (du sens de l’anglais realize);
- le calque phraséologique – la traduction littérale d’expressions figurées et de locutions figées. Par exemple: contre la montre (de l’anglais against the watch) 12.
L’emprunt syntaxique est un emprunt d’une structure syntaxique étrangère. Cet emprunt touche la construction des phrases. Par exemple, rencontrer des dépenses, qui peut être considéré comme calque de groupes verbaux 12.
Et finalement, l’emprunt phonétique est un emprunt d’une prononciation étrangère. Par exemples : un anglicisme « gym » 12.
Si on considère la classification des emprunts de point de vue du linguiste allemand E. Haugen, il propose de les diviser en trois types : 1) les mots empruntés proprement dits ; 2) des emprunts hybrides ; 3) traduction des emprunts.
En plus selon la typologie d’E.Haugen, les mots d’origine étrangère sont aussi divisés en : 1) mots sans substitution morphémique (loan-words) ; 2) mots avec substitution morphémique partielle, ou hybrides, semi-emprunts (loan-blends) ; 3) mots avec substitution morphémique complète (semantic loans).
Les emprunts eux-mêmes reproduisent entièrement le modèle de la langue étrangère, tandis que les calques ne reproduisent que les significations. La classification d’E.Haugen des emprunts est basée sur la différenciation structurelle des mots empruntés et procède non pas de ce qui est transféré, mais de ce qui n’est pas transféré, mais remplacé.
La méthode de classification des emprunts selon le degré d’intégration a été proposée par le linguiste allemand Ulrich Amon en 2001. Selon cette typologie, les mots d’emprunt peuvent être divisés en quatre catégories selon le degré d’intégration avec la langue empruntée :
- emprunts intégrés : sont parfaitement intégrés dans la langue empruntée. Ils subissent des adaptations phonologiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques qui les mettent en conformité avec les règles de la langue étrangère. Les mots étrangers intégrés sont souvent confondus avec des mots natifs et donc difficiles à reconnaître. Exemple : « café » ;
- emprunts semi-intégrés : ont été adaptés phonétiquement, morphologiquement et syntaxiquement dans la langue empruntée, mais leur sens reste assez proche de celui de la langue d’origine. Les emprunts semi-intégrés peuvent souvent être identifiés par l’orthographe ou la prononciation. Exemple : « sushi » ;
- emprunts non-intégrés : empruntés à la langue d’origine sans adaptation phonétique, lexicale, syntaxique ou sémantique. L’emprunt non-intégré est souvent utilisé pour désigner des concepts ou des produits qui n’existent pas dans la langue empruntée. Exemple : « karaoké » ;
- emprunts marginals : sont rarement utilisés et le degré d’intégration est difficile à déterminer. Il peut s’agir de mots d’emprunt récents ou de mots d’emprunt qui ne correspondent pas à la langue empruntée. Exemple : « saxophone ».
D’après A. Meillet on peut charactériser les emprunts selon leur chronologie. Il y a donc les emprunts anciens, qui ont été empruntés il y a longtemps, et les emprunts récents, qui ont été empruntés dans une période plus récente, souvent dans un contexte historique et social précis.
W. von Wartburg nous propose de classer les mots d’origine étrangère d’après les domaines auxquels ils correspondent :
- emprunts techniques : concernent le vocabulaire spécialisé d’un domaine scientifique, technique ou professionnel ;
- emprunts culturels : touchent des éléments de la culture d’un peuple, tels que des noms de plats, de fêtes, de vêtements, etc ;
- emprunts littéraires : se rapportent aux des œuvres littéraires ou des styles d’écriture
11.
Le rôle des emprunts dans les médias français
Avant d’apparaître dans les dictionnaires, les emprunts peuvent courir les rues pendant assez longtemps. Mais c’est surtout grâce aux médias (la presse, la radio, la télévision, Internet) que nous en prenons les premières notions.
Les processus dynamiques du vocabulaire de la langue française se reflètent le plus activement dans les textes des médias de masse.
Après tout, à l’étape moderne, le langage des médias de masse enregistre les changements qui se produisent dans toutes les sphères de la vie sociale, dont la réflexion nécessite l’utilisation de nouveaux lexèmes qui ne sont pas toujours disponibles dans la langue maternelle.
La reproduction d’unités d’une langue étrangère se trouve le plus souvent dans des histoires sur la vie d’un autre peuple, les coutumes, la morale et la culture d’un pays étranger.
Le reflet de faits inhabituels pour les locuteurs d’une langue d’identité nationale étrangère donnée dans le mode de vie, la culture, les traditions, etc., sont appelés réalités.
Les raisons de recourir aux emprunts peuvent être différentes : des considérations de prestige linguistique (un mot étranger augmente le prestige social du locuteur aux yeux des autres) et de snobisme linguistique (un mot étranger semble plus à la mode ou moderne) à des considérations d’ordre pragmatique.
L’emprunt peut dissimuler le sens social réel d’un terme politique, il a cette expressivité qui peut promouvoir la publicité d’un produit particulier, etc.
Par ailleurs, Habib Ben Salha a bien dit: « Je crois qu’il y a des moments où les médias aussi peuvent créer ou inventer » 19. С’est-à-dire que les médias peuvent non seulement utiliser les emprunts existants, mais aussi être un créateur direct de nouveaux lexèmes pour le dictionnaire français.
En général, la presse de masse peut être considérée comme l’un des principaux activateurs des processus de néologisation et d’emprunt.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les types d’emprunts linguistiques identifiés par les linguistes?
Les linguistes identifient trois grandes catégories d’emprunts linguistiques : emprunt lexical, emprunt syntaxique et emprunt phonétique.
Qu’est-ce qu’un emprunt intégral?
L’emprunt intégral, aussi appelé emprunt direct, est le résultat du transfert complet de la forme et du sens d’un élément lexical d’une autre langue avec ou sans adaptation.
Comment se distingue un calque d’un emprunt lexical?
Le calque est la formation d’une nouvelle expression par la traduction littérale d’un élément de langue étrangère, tandis que les emprunts lexicaux peuvent être intégraux ou partiels et renvoient principalement au mot dans son rapport sens-forme.