Les applications pratiques des emprunts arabes révèlent une dynamique fascinante dans le discours médiatique français moderne. En explorant leur impact socioculturel, cette étude met en lumière comment ces arabismes transforment notre compréhension de l’information, suscitant un intérêt croissant pour leur rôle dans la langue contemporaine.
L’aspect historique des relations franco-arabes
Commençons par le fait que les pays arabes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi que les pays qui font partie de la Ligue des États arabes et ont l’arabe comme langue officielle, sont généralement appelés le monde arabe. Le monde arabe se compose de 22 pays et compte environ 360 millions de personnes.
Comme nous l’avons constaté avant, les emprunts linguistiques témoignent des relations entre les peuples. C’est pourquoi il est nécessaire de savoir quels événements historiques ont provoqué les contacts entre les Arabes et les Français.
Les relations franco-arabes s’enracinent dans des siècles d’histoire commune, de troubles et d’échanges culturels.
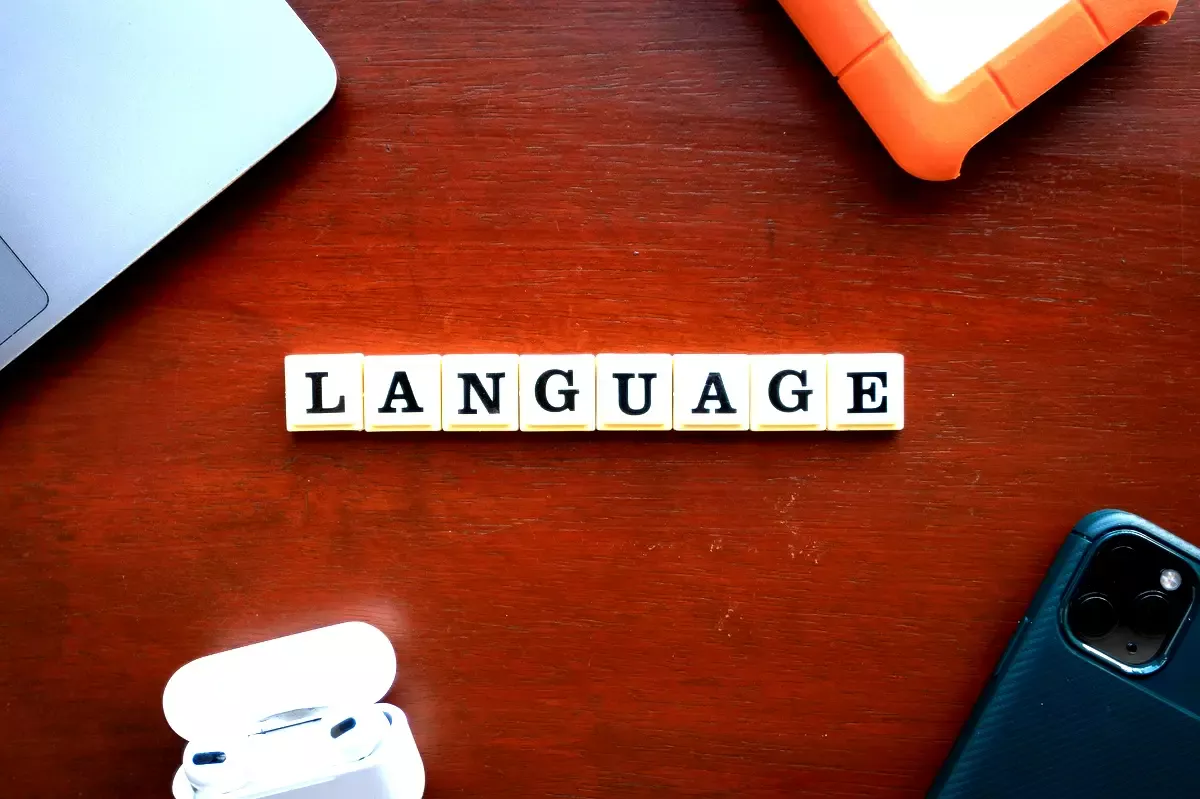
En 719, les conquérants arabes ont envahi la Gaule, prenant Narbonne et pillant la vallée du Rhône jusqu’à Lyon. Toutefois, ils ont été confrontés à la résistance du duc d’Aquitaine Eudes qui les a vaincus. Entre le Xe et le XIe siècle, des guerres ont éclaté entre les Arabes et les Occidentaux.
Les croisades ont été organisées pour conquérir la Terre- Sainte et, en Occident, la papauté a mené des guerres contre les Arabes d’Espagne pour imposer la religion chrétienne à la place de l’islam. Et lors de ces croisades, des colonies françaises se sont établies en Palestine, au Liban et en Syrie.
Les Français ont ainsi été exposés à la richesse de la civilisation arabe et ont constaté que dans certains domaines, elle était supérieure à la civilisation européenne. En effet, à l’époque, le monde arabe avait des réalisations remarquables en sciences telles que la médecine, les mathématiques, la géographie et la philosophie.
L’agriculture et l’artisanat y étaient également très développés. Les mariages mixtes et les relations amicales entre les Français et les Arabes ont contribué à une meilleure compréhension mutuelle, maintenant des contacts même après la libération de Jérusalem.
Tout au long du Moyen Âge, des relations commerciales mutuellement bénéfiques ont été maintenues entre les villes des pays arabes et la France. De nombreux étudiants et universitaires arabes ont fréquenté les universités françaises, et les rois de France ont signé des accords amicaux avec les souverains arabes [8].
Le XVIe siècle a été un tournant important pour l’Empire arabe. L’Espagne a été reconquise par les Chrétiens et les Ottomans ont dominé les Arabes en possédant plusieurs territoires. Au XIXe siècle, l’Europe a mené des interventions militaires en Afrique du Nord.
Après l’expédition d’Égypte, la France a conquis l’Algérie en 1830 et a imposé son protectorat sur la Tunisie en 1881.
Au début du XXe siècle, la France a étendu son influence au Maroc (1912) et a reçu le mandat de s’installer en Syrie et au Liban en 1920. Ces deux pays sont restés des protectorats français jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Dès le XIXe siècle, les Français se sont installés au Maghreb et cette colonisation a apporté de nombreux arabismes au français, provenant de l’arabe dialectal maghrébin [8].
Et enfin il ne faut pas oublier l’immigration, qui possède un rôle important dans l’aspect historique et influence vraiment beaucoup de choses. Donc après l’indépendance, de nombreux Maghrébins ont quitté leur pays pour la France.
Il est à noter que la population maghrébine en France était composée d’étudiants et d’ouvriers travaillant dans des conditions difficiles. Les Arabes établis en France ont conservé leurs coutumes, leurs traditions et leur langue. L’arabe fait partie de la vie quotidienne des Français.
La France, en tant que pays occidental et chrétien, a toujours montré un grand intérêt pour la civilisation arabo-musulmane, d’autant plus que près de 2,5 millions de Français ont des origines arabes et pratiquent la religion musulmane. Les liens culturels entre la France et les pays arabes sont extrêmement vastes et divers.
De plus, la France a mis en place un programme culturel et universitaire important en coopération avec de nombreux pays arabes, et l’enseignement de l’arabe est désormais proposé dans de nombreuses institutions éducatives en France.
Il est à noter que plusieurs pays arabes sont membres de la Francophonie, tels que la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, le Liban, Djibouti et les Comores, et que la majorité de la population algérienne parle également français en plus de l’arabe.
Après des siècles de conflits, de luttes et de guerres, les relations entre la France et les pays arabes ont finalement évolué vers une relation d’intérêts mutuels à ce début du XXIe siècle. Cette relation est débarrassée des images embellies ou idéalisées que certaines élites de chaque camp ont tenté de maintenir.
Le siècle précédent a été difficile pour les relations franco-arabes, marqué par des hauts et des bas, des conflits sanglants et des antagonismes profonds.
Dans son livre « Les mondes de François Mitterrand. À l’Élysée, 1981-1995 », Hubert Védrine soutient que la France doit naviguer à travers les mythes, les héritages, les passions et les réalités de la région du Proche-Orient [1]. De chaque côté, des mythes, des fausses idées, des préjugés et des clichés déforment souvent la réalité locale.
Conclusion du Chapitre 1
L’étude du système d’emprunt a une longue histoire en linguistique. La complexité du matériel est déterminée par la variété des points de vue et des approches, qui se reflète dans les nombreuses classifications d’unités empruntées proposées par différents auteurs. L’emprunt est un processus typologiquement universel.
Il est présent dans toutes les langues. L’emprunt de mots étrangers reflète non seulement des processus historiques, mais aussi la position géographique, la place socioculturelle du pays dans le monde.
Le processus d’emprunt est très diversifié. Ce processus a ses causes, ses stades de développement et ses résultats. Les raisons de l’emprunt sont dues aux causes internes de la langue et à l’impact externe sur le système linguistique.
La nécessité de maîtriser les mots empruntés s’explique par l’imprécision du nom de l’élément ou son absence, du fait que le phénomène ou l’objet désigné est nouveau pour la culture qui parle cette langue. À la suite d’emprunts, le dictionnaire français est constamment mis à jour.
La langue s’adapte aux réalités de chaque nouvelle ère, vit et se développe avec la communauté culturelle des gens. Dans ce chapitre nous avons constaté et expliqué la typologie des emprunts.
Plus précisément, les emprunts lexicaux, qui font principalement référence à la relation sens- forme des mots, les syntaxiques, dont le but est de garder la structure syntaxique du mot étranger, et les phonétiques, qui mantiennent la prononciation d’une nautre langue.
En ce qui concerne la sphère médiatique, on peut conclure que les emprunts occupent une place importante dans les textes des journalistes, ce qui est causé par divers facteurs. Les journalistes dans leurs propres travaux, en tenant compte du vocabulaire de leurs lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, se rapprochent d’eux.
De plus, à l’aide de mots étrangers, les auteurs cherchent à colorer de manière expressive leurs œuvres.
Cependant, il est également important de se rappeler que les médias influencent leur public, et il est donc important que les journalistes le traitent avec respect, car de tels emprunts peuvent déplacer considérablement des homologues spécifiques dans les langues dans lesquelles ils se produisent, soulevant des questions sur leur richesse, la diversité et peut-être même la survie.
Et finalement, nous avons également retracé l’aspect historique de l’influence de la culture arabe sur la France. Nous avons réussi à découvrir que l’introduction de la langue française dans le système de communication était le résultat des relations constantes.
Cela est dû à la colonisation des pays africains par les Européens.
La transition des États européens des relations féodales aux relations capitalistes, manifestée par la croissance de la production industrielle, le développement de la science, l’expansion du commerce, l’augmentation de la demande de main-d’œuvre, a joué un rôle particulièrement important dans la coexistance de la France et des pays arabes.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les impacts des emprunts arabes sur le discours médiatique français ?
L’analyse présente une classification thématique des arabismes et étudie leur influence sur la perception de l’information dans la société française.
Comment l’histoire a-t-elle influencé les emprunts arabes dans la langue française ?
Les relations franco-arabes s’enracinent dans des siècles d’histoire commune, de troubles et d’échanges culturels, avec des événements historiques ayant provoqué des contacts entre les Arabes et les Français.
Quel rôle joue l’immigration dans l’intégration des arabismes en français ?
Après l’indépendance, de nombreux Maghrébins ont quitté leur pays pour la France, conservant leurs coutumes, leurs traditions et leur langue, ce qui a contribué à l’apport d’arabismes au français.