La théologie de la création évolutive révèle une perspective audacieuse sur la relation entre foi et science. En confrontant l’anthropocentrisme chrétien, cette recherche promet des solutions novatrices pour une crise écologique pressante, inspirées par l’exemple de Saint François d’Assise.
Création par évolution chez Jean Michel Maldamé
L’approche la plus en vue dans la conception de la théologie de la création chez Jean Michel Maldamé206 s’inscrit dans la recherche de l’unité entre la création et l’évolution. En rapprochant la création à la théorie de l’évolution Maldamé propose une théologie renouvelée de l’action de Dieu à l’œuvre dans le cours de la vie et dans l’histoire de l’univers.
A ses yeux, « la question du rapport entre la foi en Dieu créateur et la théorie de l’évolution s’enracine dans la délicate articulation entre la foi et la raison »207. Ainsi, dans son approche évolutive de la création, l’auteur s’appesantit sur la recherche de l’harmonie entre la foi et la science, sur la théorie de l’évolution et ses options fondatrices, sur la critique des courants adverses tels que le concordisme, le fondamentalisme et le créationnisme, sur le retour à la lecture avisée de la
bible, sur l’action de Dieu dans l’évolution et sur la spécificité humaine dans la création.
205 F. EUVE, op.cit., p.42.
206 Note biographique: Né à Alger le 31 aout 1939, Jean Michel Maldamé est entré chez les Dominicains pour la Province de Toulouse. Il a une formation universitaire aussi bien philosophique que scientifique surtout en mathématiques et philosophie des sciences. Après ses études de philosophie et de théologie, il a d’abord été orienté vers un apostolat auprès des scientifiques.
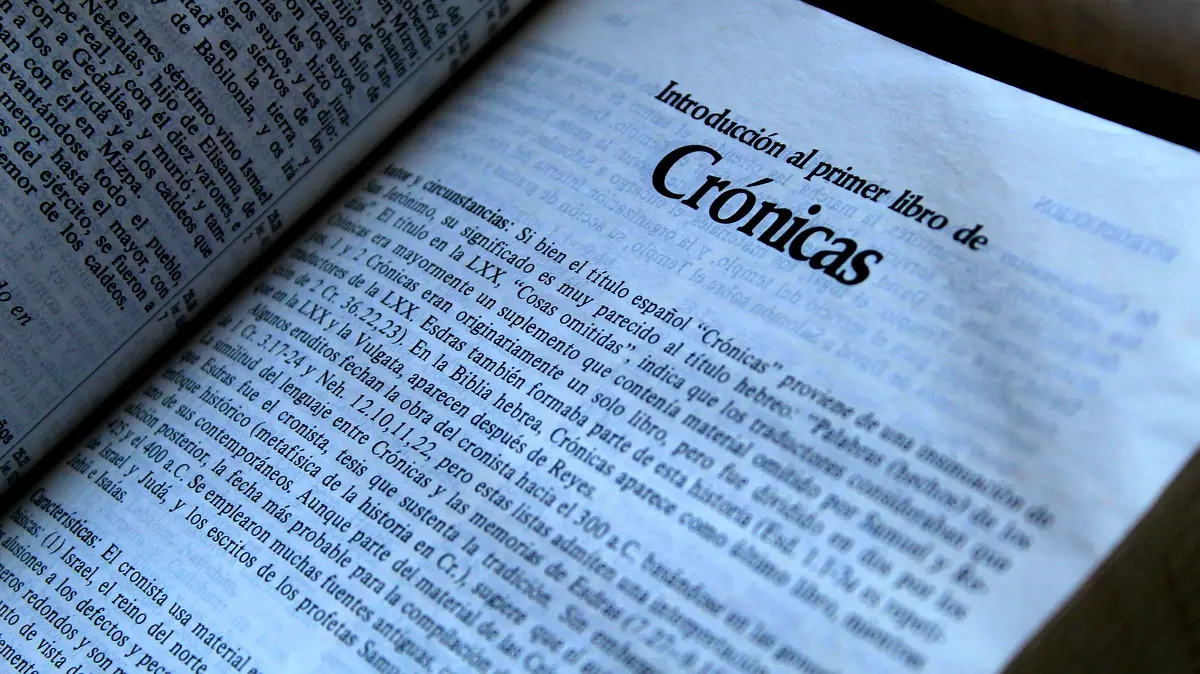
Il a enseigné la théologie à la Institut catholique de Toulouse où il a été désigné doyen de la Faculté de Théologie en 1984, poste qu’il a occupé jusqu’en 2000. Il y a fondé aussi un centre d’études sur les relations entre science et foi. Collaborateur de la Revue thomiste, il y est chargé de l’analyse des publications scientifiques internationales.
Il collabore également à la revue Esprit et Vie. Le 29 janvier 1997, il est nommé par le Pape Jean Paul II comme membre de l’Académie pontificale des sciences. Depuis 2008 il est membre de l’Académie internationale de sciences religieuses. Il travaille surtout sur le rapport entre science et religion en lien avec des scientifiques, enseignant et chercheurs mais aussi avec de groupes soucieux d’être présents à la culture contemporaine.
Cf. Résume biographique dans J-M.MALDAME, Création par évolution, Paris, Cerf, 2011 & Création et créationnisme, Paris et Namur, Edition des Jésuites, 2014.
207 J-M. MALDAME, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, Paris, Cerf, 2011, p. 12.
Deux pièges à écarter
Pour mener à bien son investigation, l’auteur identifie deux pièges tendus par ceux qui mettent en opposition la théorie scientifique de l’évolution et la foi en la création. Le premier est soutenu par les promoteurs de l’athéisme qui affirment que « l’on ne peut pas prétendre croire en la création sans être créationniste »208.
Le second trouve son appui dans le courant fondamentaliste qui affirme que « la théorie de l’évolution est si réductrice que reconnaitre sa valeur serait un aveu de matérialisme et par conséquent un rejet des propositions fondamentales de la foi en Dieu créateur »209. Dans son œuvre, Maldamé se positionne à l’encontre de ces positions très médiatisées et il démontre que « la théorie de l’évolution n’en est en rien opposée à la foi en Dieu créateur continument actif dans le processus de la vie
»210. Cela constitue la grande affirmation de sa théologie de la création.
Recherche de l’harmonie entre la foi et la science
L’auteur soutient qu’une théologie de la création crédible dans un contexte de l’évolution exige la circularité fécondante entre la foi et la science. Au cours de l’histoire, plusieurs penseurs ont insisté sur leur divorce. Dans sa démarche, Maldamé insiste sur l’unité du savoir humain dans sa quête de vérité. Pour lui, « la juxtaposition des termes
« évolution » et « création » est liée à la nature même des relations entre foi et raison, entre vérité révélée et vérité acquise par la raison naturelle »211. La tentative de séparation de ces deux domaines du savoir serait donc antinaturelle étant donné que l’esprit humain est en perpétuelle quête d’unité.
Pour étayer sa pensée, l’auteur évoque un texte du livre de la Sagesse : « Tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids (Sg 11,20). A ses yeux, « ce texte fonde la relation entre sciences de la nature et théologie monothéiste dans la tradition chrétienne ».212 Les trois termes évoqués dans le verset biblique ci-haut font référence aux trois grands systèmes de pensée qui unissait alors philosophie et science.
On le voit, « contrairement aux idées vulgarisées à notre époque, la tradition monothéiste se nourrit depuis toujours de sa rencontre avec la science ».213 Maldamé
208 Ibidem, p. 12.
209 Ibidem
210 Ibidem
211 J-M, MALADAME, Science et foi en quête de l’unité, Paris, Cerf, 2005, p. 10.
212 IDEM, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, p. 12.
213 Ibidem p. 12-13.
s’inscrit ainsi dans une perspective dialectique où deux savoirs autonomes, ayant chacun son dynamisme propre, doivent coopérer dans la quête de la vérité. Dans son encyclique, le Pape Francois s’inscrit dans la même conviction en affirmant que « la science et la religion, qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux ».214
En plus, Maldamé écarte les idées des tenants d’une interprétation littérale de la Bible. Pour lui « il n’y a pas, d’une part, des vérités contingentes – celles des sciences – et, d’autre part, des vérités absolues qui constitueraient une doctrine fondamentale et inamovible – celles de la théologie »215. Bien au contraire, la provocation transformatrice venue de la science renforce la théologie.
Les énoncés de la foi doivent être pris dans une perspective où ils se précisent en purifiant. Bien plus, étant donné que tout discours scientifique n’est jamais définitif, « la théologie doit rester disponible à une nouvelle lecture, en raison de l’immensité de son objet ».216 Elle doit s’approprier le discours de la science pour ensuite s’exprimer dans un langage renouvelé.
C’est dans cette perspective que création et évolution s’enrichissent mutuellement sans se confondre.
________________________
206 Note biographique: Né à Alger le 31 aout 1939, Jean Michel Maldamé est entré chez les Dominicains pour la Province de Toulouse. Il a une formation universitaire aussi bien philosophique que scientifique surtout en mathématiques et philosophie des sciences. Après ses études de philosophie et de théologie, il a d’abord été orienté vers un apostolat auprès des scientifiques. Il a enseigné la théologie à la Institut catholique de Toulouse où il a été désigné doyen de la Faculté de Théologie en 1984, poste qu’il a occupé jusqu’en 2000. Il y a fondé aussi un centre d’études sur les relations entre science et foi. Collaborateur de la Revue thomiste, il y est chargé de l’analyse des publications scientifiques internationales. Il collabore également à la revue Esprit et Vie. Le 29 janvier 1997, il est nommé par le Pape Jean Paul II comme membre de l’Académie pontificale des sciences. Depuis 2008 il est membre de l’Académie internationale de sciences religieuses. Il travaille surtout sur le rapport entre science et religion en lien avec des scientifiques, enseignant et chercheurs mais aussi avec de groupes soucieux d’être présents à la culture contemporaine. Cf. Résume biographique dans J-M.MALDAME, Création par évolution, Paris, Cerf, 2011 & Création et créationnisme, Paris et Namur, Edition des Jésuites, 2014. ↑
207 J-M. MALDAME, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, Paris, Cerf, 2011, p. 12. ↑
211 J-M, MALADAME, Science et foi en quête de l’unité, Paris, Cerf, 2005, p. 10. ↑
212 IDEM, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, p. 12. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la théologie de la création évolutive selon Jean Michel Maldamé?
L’approche de la théologie de la création chez Jean Michel Maldamé s’inscrit dans la recherche de l’unité entre la création et l’évolution, proposant une théologie renouvelée de l’action de Dieu à l’œuvre dans le cours de la vie et dans l’histoire de l’univers.
Quels sont les principaux pièges à éviter dans le débat entre création et évolution?
Maldamé identifie deux pièges : le premier est soutenu par les promoteurs de l’athéisme qui affirment que l’on ne peut pas croire en la création sans être créationniste, et le second est le courant fondamentaliste qui considère que reconnaître la valeur de la théorie de l’évolution serait un rejet de la foi en Dieu créateur.
Comment Jean Michel Maldamé propose-t-il de réconcilier foi et science?
Maldamé soutient qu’une théologie de la création crédible dans un contexte de l’évolution exige la circularité fécondante entre la foi et la science, et insiste sur l’unité du savoir humain dans sa quête de vérité.