La théologie chrétienne de la création révèle des liens surprenants entre l’anthropocentrisme et la crise écologique actuelle. En s’inspirant de Saint François d’Assise, cette recherche propose des approches novatrices pour rétablir l’harmonie entre l’homme, la nature et le Créateur, avec des implications cruciales pour notre avenir.
Hypothèse du travail
Il nous semble important à ce stade, après avoir élaboré la problématique de notre travail scientifique de proposer l’hypothèse qui a pour vocation de fournir les idées directrices de tout travail de recherche. A coup sûr, pour se faire entendre dans le monde contemporain, la théologie doit s’intéresser à ce qui anime ce monde, ses attentes, ses interrogations et ses tentatives d’y répondre.
Aujourd’hui il est incontestable que « le rapport à la nature, au cosmos, à son origine et à son avenir, la place de l’homme dans l’immensité cosmique et son rôle dans gestion de la terre et la relation aux autres vivants sont parmi les questions actuelles qu’une théologie de la création se doit de prendre en compte »26.
Dans cette perspective, nous proposons comme hypothèse de notre recherche la possibilité d’élaborer une théologie chrétienne de la création qui prend
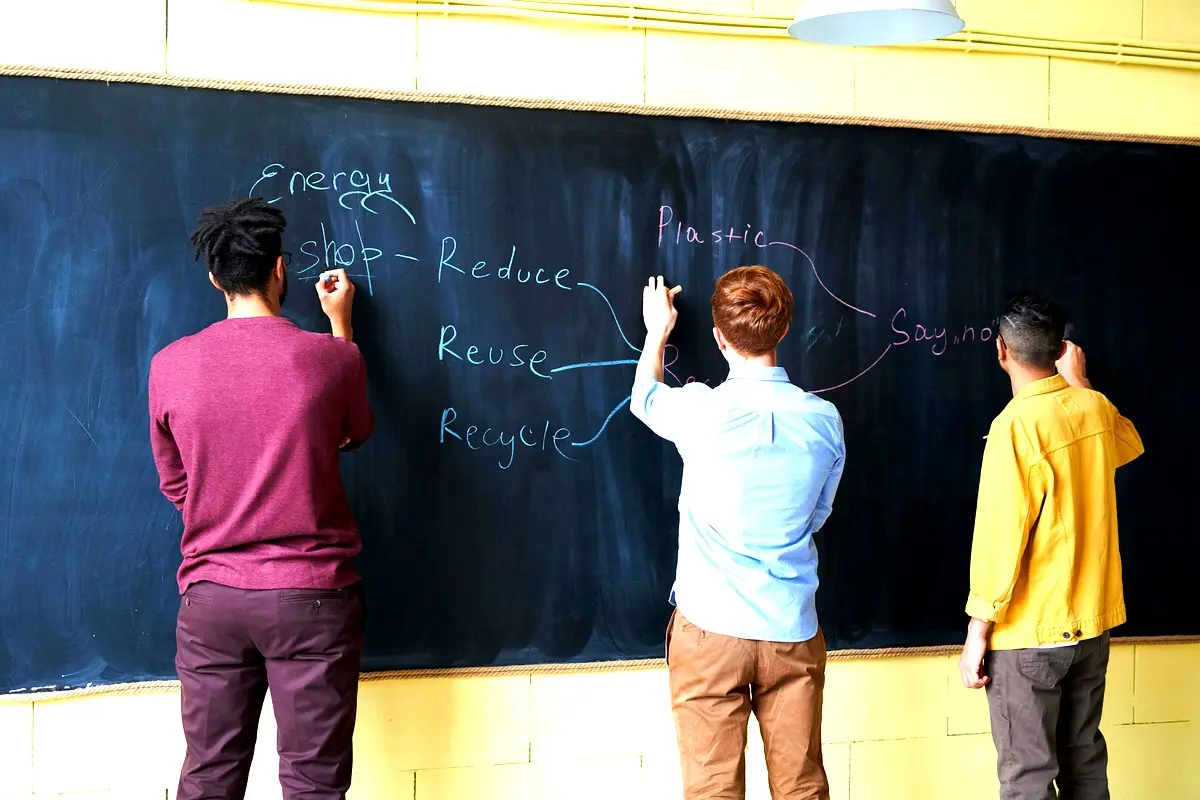
26 F.EUVE, Penser la théologie comme un jeu, Paris, Cerf, 2000, p. 21.
en compte la situation actuelle de la crise écologique. Précisément, la situation de crise écologique est dans ce sens appréhendée comme un locus théologique27.
Selon Jürgen Moltmann, une théologie chrétienne de la création doit s’inscrire dans
« le temps messianique qui commence avec Jésus et qui tends vers la libération des hommes, la pacification de la nature et la délivrance de l’environnement à l’égard des puissances du négatif et de la mort ».28 Comme l’indique bien le texte de Saint Paul aux Romains ; toute créature est tendue vers l’accomplissement en Dieu. « La création en attente aspire à la révélation du fils de Dieu ; […] Nous le savons en effet, toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail d’enfantement (Rm 8,19-23)
Dans cette perspective messianique Jean Michel Maldamé formule une théologie renouvelée de l’action de Dieu à l’œuvre dans le cours la vie. L’évidence de la providence divine et l’évolution créatrice seraient pour lui des manifestations de l’action de Dieu dans la nature. A ses yeux « qu’il s’agisse de la vie, de la place de l’humanité dans le monde des vivants ou de l’ultime pourquoi de l’existence c’est la question existentielle de l’origine et de la fin »29 qui se pose en filigrane.
François Euvé quant à lui, dans sa recherche des nouveaux paradigmes, « proposera l’adoption du modele du jeu pour penser théologiquement la création »30. Selon lui une approche ludique rendrait justice à la notion biblique de la création tout en enrichissant la tradition théologique animée par les Saintes Ecritures. Plus que la description d’un commencement ou de l’achèvement d’un processus initial, la théologie de la création serait la proposition d’un salut qui concerne toutes les composantes du créé.
Pour le théologien américain John Haught « la crise écologique actuelle peut être considérée comme une chance pour une véritable réflexion théologique enrichissante, en vue du renouveau »31. Selon lui un regard sur l’histoire du christianisme montre que ce sont souvent les moments de crise qui ont donné lieu à des transformations majeures dans les traditions religieuses. Ainsi, il est possible que « la crise écologique actuelle, au lieu de conduire à l’incrimination de la théologie chrétienne comme le fait Lynn White, « peut et doit être une opportunité et une invitation à réinterpréter ses thèmes centraux d’une
27 A.KIM MI-JEUNG, L’impact de la crise écologique et du dialogue interreligieux sur la théologie chrétienne, dans Recherches de Science Religieuse, tome 100, n° 1, (2012), p. 85.
28 J. MOLTMANN, op. cit. p. 33.
29 J-M, MALDAME, Création par Evolution, science, philosophie et théologie, Paris, Cerf, 2011, (Tiré du résumé du livre sur la couverture).
30 F. EUVE, op.cit. p. 11.
31 J-F. HAUGHT, The Promise of Nature, Ecology and Cosmic Purpose, Eugene, Wipf et Stock Publishers, 2004, p. 35. ( Traduit par nous de l’anglais).
manière radicalement renouvelée »32. L’actuelle situation environnementale critique est une occasion pour la théologie de devenir un stimulus incontestable pour le renouveau. C’est dans cet esprit d’ouverture à la possibilité de la transformation créatrice que nous saurons nous embarquer dans l’investigation scientifique féconde et fécondante des questions éco-théologiques.
Le Catéchisme de l’Église catholique déclare que « la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l’homme ».33 Ainsi l’homme n’est pas à part du cosmos, Dieu l’a inscrit dans la Création. Mais l’homme a un rôle particulier, puisque « les animaux, comme les plantes et les êtres inanimés, sont naturellement destinés au bien commun de l’humanité passée, présente et future ».34 .
Intérêt et Actualité du sujet
Avant toute chose, il n’est un secret pour personne que de nos jours les questions écologiques préoccupent les esprits humains tant religieux que profanes. Activistes environnementaux, scientifiques, politiciens, hommes d’état, hommes de l’Eglise, philosophes, évangélistes, tous élèvent leur voix pour appeler l’humanité à une implication renouvelée en faveur de la sauvegarde de notre maison commune. Dans ce contexte, l’Eglise et la réflexion théologique n’ont plus le droit de se tenir à l’écart. Elles sont invitées à jouer un rôle d’éveil des consciences pour favoriser des relations cosmo- théandriques harmonieuses.
Ceci explique le regain d’intérêt actuel pour la thématique de la nature en tant telle. Selon François Euvé, nous vivons aujourd’hui dans une époque de grande mutation, une époque qualifiée de « transition énergétique » ou encore de « transition écologique »35. L’humanité cherche à inventer un nouveau rapport à la nature que l’on peut qualifier de
«nouvelle alliance »36. De plus en plus, la logique de production sans limite et le modèle de la technoscience de l’ère industrielle se trouvent contestés. Personne ne peut rester indifférent à ces mutations qui ne cessent d’inviter les hommes et les femmes d’aujourd’hui, de toutes les disciplines scientifiques, à une remise en question et à une prise de décision parfois difficiles. « Tandis que l’époque précédente était davantage
32 Ibidem.
33 Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC), n° 1043.
34 Ibidem, n° 2415.
35 F.EUVE, op.cit. p. 25.
36 Ibidem.
préoccupée par les relatons interpersonnelles, les questions politiques ou sociales, la nôtre intègre dans son souci, le monde matériel, le devenir de l’environnement et du cosmos »37. Cela va de pair avec une critique de la volonté de mainmise de l’homme moderne sur le monde qui découle du désir de retrouver un rapport avec la nature qui ne soit plus de domination mais de solidarité.
Notre choix a aussi une motivation théologique et anthropologique. On le sait,
« l’écologie, comme d’ailleurs, le dialogue interreligieux, sont les thèmes relativement récents dans l’histoire du christianisme qui sont devenus des lieux incontournables pour la réflexion théologique aujourd’hui »38. La crise écologique oblige à reconsidérer notre rapport à la nature et la manière de percevoir l’existence humaine. Il s’agit d’un phénomène, quelque peu effrayant, inconnu jadis dans l’écosystème, et occasionné par un agir humain dépourvu de modération.
Etant donné ce phénomène n’est plus une simple hypothèse mais une réalité, « comment peut-on encore parler de salut sans prendre en considération cette crise écologique, ainsi que la modernité et son rapport avec le christianisme »?39 Cet intérêt théologique va de pair avec l’intérêt œcuménique, étant donné que écologie et la théologie de création sont les préoccupations des toutes les religions du monde.
Notre recherche est aussi motivée par l’interdisciplinarité qu’exige la rencontre entre la science écologique et la théologie. Ce moment herméneutique est un véritable lieu de rencontre et de dialogue entre la foi et la science. Dans son encyclique le pape François affirme que « la science et la religion, qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux »40. Un dialogue fructueux entre la théologie et la science joue un rôle fondamental dans l’élaboration d’une
théologie de la création à l’époque contemporaine. « Science et théologie ont à faire avec un seul et même monde. C’est le monde, « le ciel et la terre » qui est créé par Dieu et est l’objet de l’investigation de la science »41.
37 Ibidem. p.24.
38 A. KIM MI-JEUNG, op.cit. p. 85.
39 Ibidem. p. 85.
40 Laudato si, n° 62.
41 F.EUVE, op.cit., p. 14
Méthode et division du travail
Notre souci dans cette étude est de contribuer, à la suite de bien des auteurs signalés ci-dessus à l’élaboration d’une théologie de la création prenant compte de la situation actuelle de crise écologique, qui affecte tous les continents. Pour y parvenir, nous avons opté pour la méthode herméneutique42 chère à notre Ecole théologique de Kinshasa, avec son triple schéma (contextualisation – décontextualisation et recontextualisation) qui dicte à notre étude une structure tripartite.
Dans un premier moment, nous analysons la crise écologique actuelle, il s’agit de préciser sa nature, ses manifestations multiformes, et ses possibles racines profondes. Dans un deuxième moment, notre réflexion se focalise sur quatre approches contemporaines de la théologie de la création, dans le but de dégager une nouvelle vision théologique ou du moins des convictions susceptibles de construire une nouvelle sagesse d’habiter la terre notre maison commune. Enfin dans le dernier moment, nous proposerons quelques perspectives capables d’aider l’Afrique à faire face aux aspects de la crise écologique auxquels elle est confrontée. Une conclusion générale récapitulera les principaux résultants de notre recherche principalement basée sur l’enquête documentaire.
42 Cf. R. DEKELAYI Maweja, L’herméneutique théologique africaine : Analyse des quelques courants, Kinshasa, Presse de l’UCC, 2019, p.13, Selon lui lorsqu’on parle de l’herméneutique comme science de l’interprétation trois questions sont susceptibles d’être posées, qu’est-ce qu’interpréter ? Pourquoi interpréter ? Comment interpréter ? P.RICOEUR affirme que ce mot n’est pas nouveau, il est connu depuis l’antiquité grecque, chez Platon, en rapport à des significations obscures ou cachées des textes prophétiques.
Dans la période alexandrine, il désigne diverses choses : traduction de textes étrangers ou explication de textes passés. Cf. P.RICOEUR, Herméneutique. Cours à l’institut Supérieur de Philosophie, Louvain-la- Neuve, 1971-1972, p.2, cité par R. DEKELAYI Maweja, op.cit. p.13. Aussi l’herméneutique a pour l’objet la relation entre deux univers, l’univers du texte ou de l’œuvre d’art et l’univers de ceux qui cherchent à comprendre.
Il est donc question de rendre compréhensible un langage qui soit étranger soit obscur ou difficile par le moyen de reformulations ou de transposition. Son but est de vaincre sans abolir la distance qui sépare les deux pôles de toute entreprise d’interprétation et qui permet à celle-ci de fonctionner c’est-à-dire de rendre proche ce qui est lointain ou propre ce qui est étranger.
Il s’agit donc de la compréhension moyennant l’interprétation. Cf. P.RICOEUR, op.cit., p.2. Gadamer, quant à lui, l’explicitera en disant, « Par le seul fait de comprendre on comprend autrement ou encore « interpréter est une nouvelle création de la compréhension ». Cf. H. GADAMER, Vérité et Méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris Seul, 1976, p.131 & 328.
Questions Fréquemment Posées
Comment la théologie chrétienne de la création peut-elle aider à résoudre la crise écologique ?
La théologie chrétienne de la création doit s’intéresser à la crise écologique comme un locus théologique, en prenant en compte la situation actuelle et en proposant des approches nouvelles pour remédier à cette crise civilisationnelle.
Quelle est l’hypothèse principale de l’article sur la théologie de la création ?
L’hypothèse de la recherche est d’élaborer une théologie chrétienne de la création qui prend en compte la crise écologique actuelle et qui répond aux questions contemporaines sur le rapport à la nature et à l’origine de l’homme.
Quel modèle est proposé par François Euvé pour penser théologiquement la création ?
François Euvé propose l’adoption du modèle du jeu pour penser théologiquement la création, ce qui rendrait justice à la notion biblique de la création tout en enrichissant la tradition théologique.