Les stratégies d’implémentation théologique révèlent une approche ludique innovante de la création, défiant les paradigmes traditionnels. Cette recherche promet de transformer notre compréhension de la relation entre l’homme, la nature et le Créateur, avec des implications cruciales pour la crise écologique actuelle.
Le conception ludique de la création chez François Euvé
Du paradigme causal au paradigme ludique
François Euvé274 propose une approche renouvelée de la théologie de la création dans un contexte de la crise écologique. Pour lui, il faut nécessairement sortir de la culture de jadis « où la création était volontiers pensée sur le modèle d’une production achevée, d’un produit fini »275. Dans sa démarche, François Euvé adopte l’approche ludique pour penser théologiquement la création et remplacer le paradigme causal qui a pendant longtemps dominé la pensée occidentale. Ainsi, comme l’avait déjà suggéré Adolph Gesché, « associer jeu et création, c’est accueillir les requêtes actuelles qui aspirent à retrouver entre le monde et Dieu une relation plus gratuite, placée moins sous le signe d’une domination et d’une soumission que sous celui de l’enchantement et de
272 JEAN PAUL II (Pape), op.cit., p. 953.
273 Cf. J-M, MALDAME, art.cit., p. 572.
274 Note Biographique : François Euvé s.j., né le 9 août 1954, est un théologien et écrivain français. Il est scientifique de formation. Il est ancien élève de l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique l’ENSET et agrégé de physique (1976). Il est également titulaire d’un doctorat en théologie(2000). Après un troisième cycle en physique des plasmas (Paris XI) et quelques années d’enseignement au lycée, il entre dans la Compagnie de Jésus en 1983 et est ordonné prêtre en 1989. Il est le premier représentant officiel des jésuites à Moscou depuis le XVIIIe siècle : entre 1992 et 1995, il enseigne la théologie à l’Institut de philosophie, de théologie et d’histoire Saint-Thomas de Moscou.
Professeur au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris), il a été doyen de la faculté de théologie et titulaire de la chaire Teilhard de Chardin. Il a également enseigné en 2012 comme professeur visiteur à l’université de Georgetown à Washington sur Science et religion. Il est depuis janvier 2013 rédacteur en chef de la revue Études, à laquelle il collaborait depuis une dizaine d’années. Son axe de recherche s’inspire surtout de la rencontre entre la foi et la science. Consulté sur https://fr.wikipedia.org/wiki/François le 10 avril 2019.
275 F.EUVE, op.cit., p. 11.
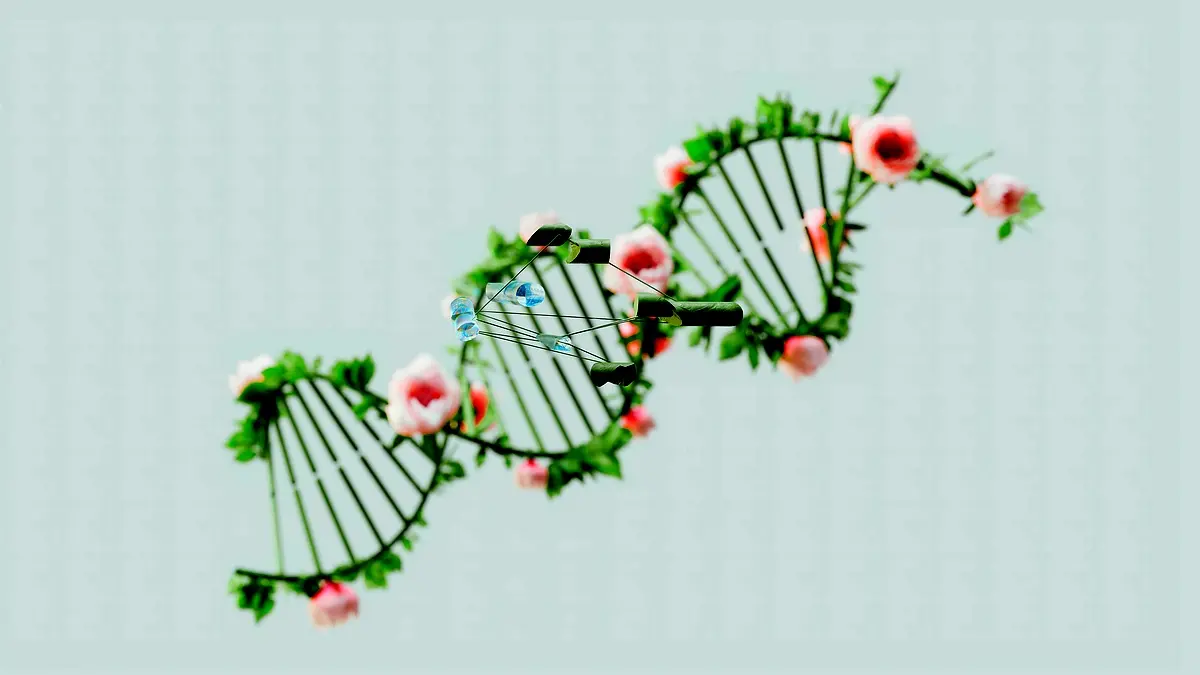
l’émerveillement »276. Tel est l’enjeu de l’œuvre de notre auteur sur la théologie de la création.
La notion du jeu et son actualité
Dans son usage quotidien, le jeu s’oppose au travail, compris sous son aspect technique d’activité productrice. « Comme en soit le jeu ne produit rien, il n’a donc pas d’autre finalité que lui-même ». 277 Précisément, « le jeu peut se définir comme une action qui engage des partenaires dans une démarche qui conjoint de manière féconde une légalité et une liberté ». 278 Johann Huizinga définit le jeu comme « une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle
librement consentie mais complètement impérieuse, accompagné d’un sentiment de tension et de joie et d’une conscience d’être autrement que la vie courante » 279. Il qualifie l’être humain de l’homo ludens 280. Le jeu n’est donc ni totalement liberté sans contrainte, ni soumission absolue à une règle. Elle possède la joie et le plaisir, mais aussi la tension et même la souffrance.
« Le jeu est une bonne image du changement de paradigme » 281 qui s’opère sous nos yeux : « plutôt que dominer le monde, plutôt que de vouloir le transforme ou le changer à tous prix, on s’en prend à s’unir à lui par la contemplation » 282.
276 A. GESCHE, Dieu pour penser, IV. Le Cosmos, Paris, Cerf, 1994, p. 138.
277 F. EUVE, op.cit., p.11.
278 Ibidem.
279 J. HUIZINGA, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, trad. C. SERESIA, Paris, Gallimard, 1951, p. 35.
280 Homo ludens est une expression utilisée pour la première fois par Johan Huizinga dans son ouvrage cité ci-haut. L’être humain a d’abord été qualifié par Carl von Linné d’Homo sapiens (homme qui sait), puis d’Homo faber (homme qui fabrique). L’expression Homo ludens insiste sur l’importance de l’acte de jouer. En effet, la thèse principale de Huizinga est que le jeu est consubstantiel à la culture.
Si le nom d’Homo sapiens ne convient pas très bien à notre espèce parce que nous ne sommes pas tellement raisonnables, si celui d’homo faber nous définit encore moins bien, car faber peut qualifier maint animal, ne pourrait-on pas ajouter à ces termes celui d’homo ludens, «homme qui joue»? C’est ce que propose donc Johan Huizinga (1872-1945), historien néerlandais ayant acquis une stature internationale, grâce à l’ouverture de sa discipline à la vision anthropologique.
Dans son essai, il montre que le jeu est un facteur fondamental de tout ce qui se produit au monde. Le jeu comme une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d’absorber totalement le joueur – une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité, qui s’accomplit en un temps et dans un espace expressément circonscrits, se déroule avec ordre selon des règles données, dans une ambiance de ravissement et d’enthousiasme, et suscite, dans la
vie, des relations de groupes s’entourant volontiers de mystère en accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel. Consulté sur http://www.gallimard.fr/Catalogue le 10 avril 2019.
281 M. MAFFESOLI, L’orgie comme jeu éthique du monde, dans Le Jeu et ses Enjeux Ethiques – Cahiers des recherches éthiques, n° 19, 1996, p. 75.
282 Ibidem.
La proposition du jeu : Pourquoi parler du jeu en théologie
Pour François Euvé, la notion du jeu est une source inspiratrice dans l’élaboration d’une théologie de la création aujourd’hui. La théologie qui prend en compte la notion du jeu prend également au sérieux « l’aspiration de l’homme d’aujourd’hui d’acquérir un nouveau rapport avec la nature, qui ne soit plus de maîtrise et d’exploitation mais de respect et d’écoute ». 283 Pour y arriver, le théologien doit intégrer le cosmos, non plus comme le cadre neutre de déroulement de l’action humaine mais comme catégorie authentiquement théologique.
Pour ne pas tomber dans le naturalisme, cette prise en compte du cosmos doit renoncer à la perspective analytique qui est celle de la science classique « afin d’intégrer un rapport de l’homme au monde fait d’enchantement ». 284 Une telle théologie aidera l’homme « à renouveler son regard sur le cosmos, sa manière de le penser et de se rapporter à lui à partir d’une méditation authentiquement théologique du Dieu Créateur ». 285
Dans son déploiement « la catégorie du jeu met en cause le primat de la nécessité » 286 qui s’imposait dans la vision classique. Mais il est vrai aussi que refuser la nécessité n’est pas se livrer au pur hasard. « Le premier impact du jeu fait retrouver la dimension de joie et de plaisir, d’enchantement qui s’attache à la création » 287.
De même que le joueur se laisse emporter par son jeu, celui qui aborde la création à travers cette notion peut retrouver l’émerveillement qui est celui-là même du Créateur. Cependant, le jeu n’est pas seulement joie et plaisir, il possède aussi ses propres contraintes, ses règles et une part d’imprévisibilité et de risque.
Ainsi « adopter cette perspective pour parler de la création est aussi accepter l’incertitude et la présence des partenaires dont la liberté de décision empêche d’avoir maîtrise totale sur le déroulement de choses » 288.
Se servir du jeu comme catégorie pour aborder la théologie de la création amène aussi un déplacement dans l’image de Dieu. L’action créatrice n’est plus comprise sous le seul signe d’une toute puissance dominatrice. Bien au contraire, « le créateur accepte aussi
283 F.EUVE, op.cit., p. 48.
284 Ibidem, p. 49.
285 Ibidem, p. 49.
286 Le non nécessité du jeu est un thème constant chez tous les auteurs qui s’y sont intéressés. Parmi eux nous pouvons mentionner H. RAHNER qui affirme que le jeu est sensé mais non nécessaire.
287 F. EUVE, op.cit, p. 50.
288 Ibidem.
de s’engager dans le jeu de sa création ».289 La catégorie du jeu refuse de morceler l’économie du salut, de séparer création et rédemption, et ainsi l’image du Dieu créateur devient celui d’un Dieu qui entre par Jésus-Christ dans l’histoire du monde. Dans ce sens,
« le jeu de la création est une « kénose de Dieu : celle d’accepter de n’être pas seul maître, seul tout-puissant » 290.
Le jeu à travers l’histoire.
Selon l’auteur, la notion du jeu est bien présente dans la pensée théologique judéo-chrétienne depuis le livre de Proverbes. Dans son étude du jeu dans la théologie biblique, l’auteur fait une longue analyse du texte des Proverbes (8, 22-31). Le déroulement de ce récit ponctué par les conjonctions temporelles, « avant que … » et « quand … », laisse émerger la figure de la Sagesse, présente auprès de Dieu dès avant le commencement.
L’activité de Dieu s’aperçoit dans le processus de mise en ordre du monde en même temps que son retrait. Le texte l’exprime ce double aspect par l’idée de « jeu » 291, (… jouant devant lui en tout temps, jouant dans le monde de sa terre… » (Pr 8,30c-31a).
A travers l’histoire, l’auteur retrouve la notion du jeu dans sa splendeur dans les commentaires patristiques et mystiques de Grégoire de Nysse, Clément d’Alexandrie, Maxime le Confesseur, Maître Eckhart, Alphonse Rodriguez et bien d’autres. Ils ont proposé une lecture de la création contrastant avec l’image de la fabrication héritée de la pensée grecque. « Celle-ci dans le sillage d’Heraclite et Aristote, favorisait nettement l’opératoire qui a été revalorisé par la science moderne avec les représentations newtoniennes » 292.
L’auteur constate ensuite que la théologie scolastique a marqué « la disparition de la notion du jeu en concomitance avec le développement d’une théologie le plus en plus rationnelle » 293. Ni les grands auteurs, ni les dictionnaires théologiques ou bibliques 294 n’y font plus allusion. François Euvé évoque des raisons de cette disparition : « la distance croissante entre création et salut occasionnée par l’émergence d’une théologie de
289 Ibidem.
290 Ibidem, p. 51.
291 Ibidem, p. 153.
292 Ibidem.
293 Ibidem, p. 243.
294 Ici il faut faire une exception significative pour le Dictionnaire de spiritualité qui consacre un long article, au thème du jeu, par Guy PETTITDEMANGE tome VIII, Paris, Beauchesne, 1974, p.1150-1164. L’auteur propose une longue analyse des composantes anthropologiques et philosophiques de la notion et montre la proximité de l’activité ludique avec l’expérience mystique : fluidité du cœur, co-extensivité de l’homme au tout du monde.
rédemption, l’autonomie du plus en plus grande de l’univers vis-à-vis de l’homme et de Dieu et enfin la séparation entre théologies dogmatique et spirituelle » 295.
C’est dans la pensée contemporaine post-moderne qu’on retrouve le regain d’intérêt pour la notion de jeu. La découverte contemporaine du jeu est surtout due au regain d’intérêt de ce thème dans la réflexion anthropologique 296 et philosophique 297 au cours du XXe siècle, qui a exercé une influence plus directe sur la théologie.
Signalons aussi la réhabilitation de la fête, de la fantaisie, qui trouve de multiples expressions dans l’après-guerre surtout à la fin des années 1960. L’intérêt pour le jeu a aussi été favorisé « par la réaction contre une société de plus en plus technicisée et le découverte du sens de la gratuite ou de la fête » 298.
C’est au cours de la deuxième moitié du XXe siècle que le thème du jeu a retrouvé une certaine place dans la réflexion théologique 299, en particulier à propos de la création du monde.
________________________
272 JEAN PAUL II (Pape), op.cit., p. 953. ↑
273 Cf. J-M, MALDAME, art.cit., p. 572. ↑
274 Note Biographique : François Euvé s.j., né le 9 août 1954, est un théologien et écrivain français. Il est scientifique de formation. Il est ancien élève de l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique l’ENSET et agrégé de physique (1976). Il est également titulaire d’un doctorat en théologie(2000). Après un troisième cycle en physique des plasmas (Paris XI) et quelques années d’enseignement au lycée, il entre dans la Compagnie de Jésus en 1983 et est ordonné prêtre en 1989. Il est le premier représentant officiel des jésuites à Moscou depuis le XVIIIe siècle : entre 1992 et 1995, il enseigne la théologie à l’Institut de philosophie, de théologie et d’histoire Saint-Thomas de Moscou. ↑
276 A. GESCHE, Dieu pour penser, IV. Le Cosmos, Paris, Cerf, 1994, p. 138. ↑
279 J. HUIZINGA, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, trad. C. SERESIA, Paris, Gallimard, 1951, p. 35. ↑
280 Homo ludens est une expression utilisée pour la première fois par Johan Huizinga dans son ouvrage cité ci-haut. L’être humain a d’abord été qualifié par Carl von Linné d’Homo sapiens (homme qui sait), puis d’Homo faber (homme qui fabrique). L’expression Homo ludens insiste sur l’importance de l’acte de jouer. En effet, la thèse principale de Huizinga est que le jeu est consubstantiel à la culture. ↑
281 M. MAFFESOLI, L’orgie comme jeu éthique du monde, dans Le Jeu et ses Enjeux Ethiques – Cahiers des recherches éthiques, n° 19, 1996, p. 75. ↑
286 Le non nécessité du jeu est un thème constant chez tous les auteurs qui s’y sont intéressés. Parmi eux nous pouvons mentionner H. RAHNER qui affirme que le jeu est sensé mais non nécessaire. ↑
294 Ici il faut faire une exception significative pour le Dictionnaire de spiritualité qui consacre un long article, au thème du jeu, par Guy PETTITDEMANGE tome VIII, Paris, Beauchesne, 1974, p.1150-1164. L’auteur propose une longue analyse des composantes anthropologiques et philosophiques de la notion et montre la proximité de l’activité ludique avec l’expérience mystique : fluidité du cœur, co-extensivité de l’homme au tout du monde. ↑
295 rédempteur, l’autonomie du plus en plus grande de l’univers vis-à-vis de l’homme et de Dieu et enfin la séparation entre théologies dogmatique et spirituelle. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les approches nouvelles de la théologie de la création selon François Euvé ?
François Euvé propose une approche renouvelée de la théologie de la création en adoptant une conception ludique, remplaçant le paradigme causal qui a longtemps dominé la pensée occidentale.
Comment le jeu est-il lié à la théologie de la création ?
Le jeu est présenté comme une bonne image du changement de paradigme, où plutôt que de dominer le monde, il s’agit de s’unir à lui par la contemplation.
Quelle est la thèse de Lynn White Jr. concernant la crise écologique ?
Lynn White Jr. attribue les racines historiques de la crise écologique à l’anthropocentrisme du christianisme occidental.