Les stratégies d’implémentation des MTI révèlent des applications révolutionnaires dans la sphère oro-faciale, mais quels défis se cachent derrière cette innovation ? Cette recherche met en lumière des solutions prometteuses pour traiter des pathologies complexes, transformant ainsi notre compréhension des thérapies avancées.
Médicaments ou produits issus de l’ingénierie cellulaire et tissulaire (PIT) :
Définition légale :
Tout produit biologique consiste à une ingénierie tissulaire ou cellulaire s’il présente des propriétés qui permettent de réparer, remplacer où régénérer un tissu humain.
C’est une approche multidisciplinaire au carrefour des sciences des vivants et sciences de l’ingénierie.
Un tissu issu de l’ingénierie tissulaire peut contenir des cellules ou tissu humain, animal ou les deux, celles-ci peuvent être viables ou non viables, mais peut aussi contenir des substances additionnelles telles que les biomatériaux, les produits cellulaires, les biomolécules, des substances chimiques, matrices ou échafaudage.
Tout produit contenant exclusivement des cellules ou tissus humains ou animaux non viables dont le but n’est pas pharmaceutique, immunologique ou d’actions métaboliques doivent être exclus de cette définition.
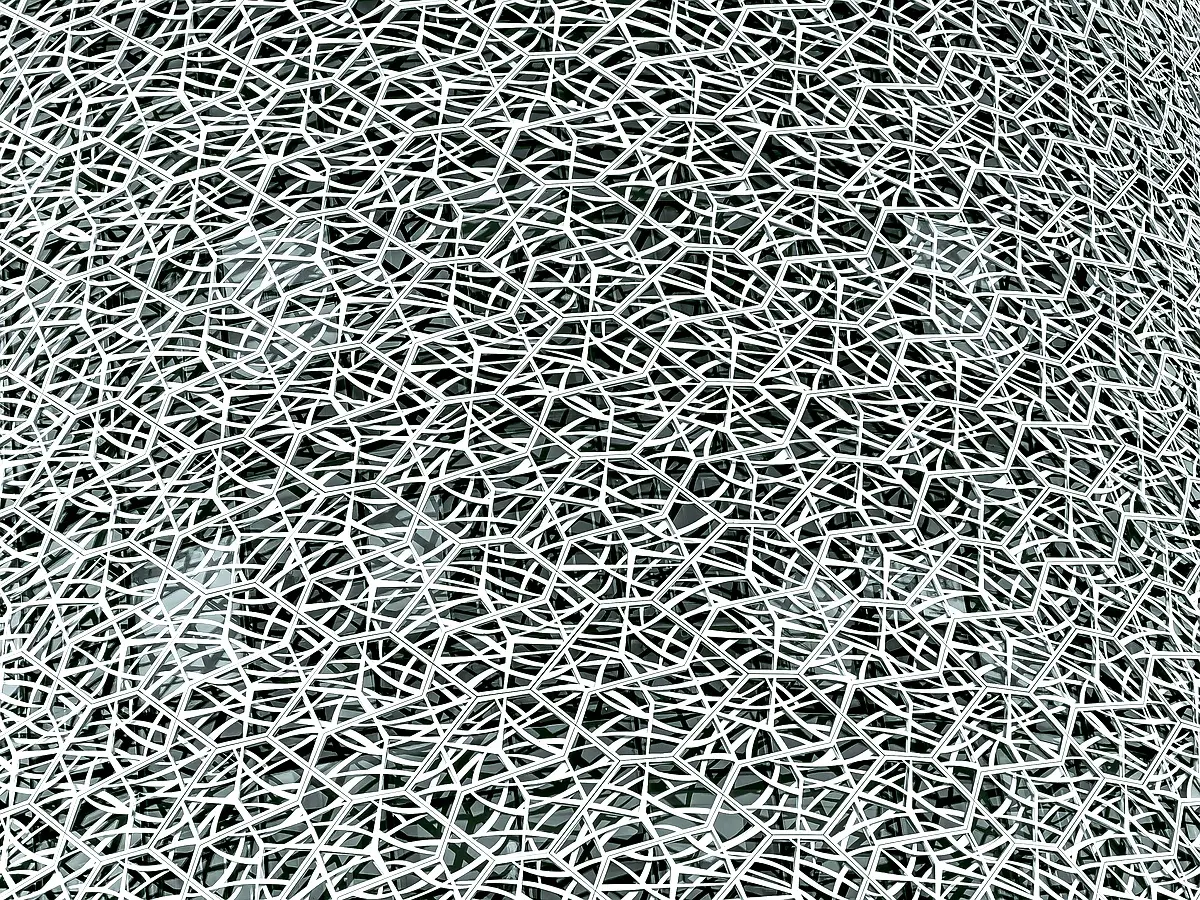
À fin d’avoir une régénération où réparation où remplacement par ingénierie tissulaire, les cellules prises du corps seront donc combinées à un échafaudage et des biomatériaux qui donc joueront le rôle du modèle qui va guider la régénération tissulaire in vitro (migration et adhésion), en présence des signaux issus des facteurs de croissance et bioréacteurs.[11,18,23]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_105]
Source: URL
Figure 17 : Schéma simplifié de l’ingénierie tissulaire.[32]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_106]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_107]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_108]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_109]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_110]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_111]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_112]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_113]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_114]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_115]
Figure 18 : Schéma illustrant le concept actuel de l’ingénierie tissulaire.[23]
c
n
L’échafaudage :
Plusieurs types d’échafaudages ont été produits à partir d’une variété de biomatériaux puis manufacturés en utilisant plusieurs techniques de fabrication et sont utilisés pour assurer une régénération guidée des tissus et organes dans le corps humain.
Peu importe le type de tissu, des conditions importantes sont nécessaires afin de maintenir la stabilité de l’échafaudage :
Biocompatibilité :
Le critère le plus important de tout échafaudage est qu’il soit biocompatible, les cellules peuvent adhérer, migrer, se multiplier sans obstacle.
Après implantation il doit en aucun cas générer une réaction immunitaire susceptible de retarder la cicatrisation où provoquer un rejet du greffe.
Biodégradation :
L’échafaudage n’est pas permanent, l’objectif des PIT est de provoquer une régénération des tissus humains, il doit donc être biodégradable pour laisser les nouvelles cellules assurer leurs propres matrices.
Propriété mécanique suffisante :
Selon les types de tissu et leurs localisations anatomiques, garantir un échafaudage rigide et puissant est le challenge le plus important, il doit être résistant pendant la manipulation chirurgicale et la période de cicatrisation (surtout pour la cavité orale et l’utilisation orthopédique et cardiaque), néanmoins, plusieurs types d’échafaudages trop rigides ont échoué in vitro à cause d’absence de vascularisation.
L’obtention d’une architecture poreuse en gardant une résistance mécanique et à la fois une architecture rigide tout en permettant la vascularisation est la clé du succès de l’échafaudage.
L’architecture de l’échafaudage :
C’est une condition critique en ingénierie tissulaire, l’échafaudage doit avoir une structure poreuse interconnectée afin d’assurer une diffusion adéquate des nutriments pour les cellules et la diffusion des produits de dégradations d’échafaudage après la construction sans interférences avec les organes et tissus voisins.
L’idée de dégradation d’échafaudage par manque de vascularisation et diffusion des débris à travers les porosités est aussi une clé de succès de l’ingénierie tissulaire, le volume des porosités dépend donc des types de cellules et tissus à régénérer.
Techniques de fabrication :
Concerne toutes les techniques qui aboutissent enfin à la formation d’un échafaudage cliniquement et commercialement viable apte à être utilisé, elle doit être efficace et permettre l’obtention d’un petit clôt d’échafaudage.
Le type de délivrance et de fabrication va aussi déterminer le type de stockage d’échafaudage.
Les cliniciens préfèrent la disponibilité en étagères pour éviter des procédures chirurgicales supplémentaires mais cela ne peut pas être possible pour tous les types de tissus.
Les biomatériaux :
Le critère décisif dans la fabrication d’échafaudage est le choix des biomatériaux avec lesquels cet échafaudage sera construit, tous les critères présentés dépendent de ce dernier.
Par définition et selon la première conférence de la société européenne des biomatériaux ESB en 1976, un biomatériau est défini comme un matériel non viable utilisé dans un dispositif médical destiné à interagir avec un système biologique.
La définition actuelle :
C’est un matériel destiné à assurer une interaction avec un système biologique dans le but de traiter, augmenter ou remplacer un tissu, un organe ou une fonction dans le corps.
Le changement de la définition indique la grande évolution des biomatériaux d’une simple interaction avec le corps jusqu’à la régénération tissulaire.
Il existe trois groupes de biomatériaux, les céramiques, les polymères synthétiques et les polymères naturels, ils sont utilisés dans la fabrication d’échafaudage dans le domaine d’ingénierie tissulaire, chacun de ces biomatériaux présente des avantages et des inconvénients, l’utilisation d’un échafaudage composé de plusieurs phases est le plus commun.
Avantages et limites des types de biomatériaux utilisés pour la fabrication d’échafaudages :
Même s’il n’est pas toujours utilisé pour la régénération des tissus mous, l’échafaudage à base de céramique a été généralisé comme l’hydroxyapatite (HA) et le tri calcium-phosphate (TCP).
Pour l’application en régénération osseuse, l’échafaudage à base de céramiques est typiquement caractérisé par sa grande rigidité mécanique (Module de Young), sa très basse élasticité et par une surface dure et cassante, il présente alors des propriétés chimiques et structurales similaires à celle de la phase minérale de l’os natif.
L’interaction des cellules ostéogéniques avec la céramique est très importante vu que les céramiques sont connues par leurs stimulations aux ostéoblastes à proliférer et à se différencier.
Plusieurs types de céramiques ont été utilisés en chirurgie dentaire et orthopédique dans le but de combler les défauts osseux et pour couvrir les surfaces métalliques des implants afin d’assurer l’intégration de l’implant avec l’os, mais leurs utilisations cliniques dans l’ingénierie tissulaire étaient limitées à cause de leurs fragilités, difficultés de la mise en forme pour l’implantation et car le nouvel os formé dans une structure d’hydroxyapatite poreuse ne peut pas soutenir le chargement mécanique nécessaire pour le remodelage, un autre problème est lié à la structure de l’hydroxyapatite qui est comparable à celle de l’os, il est difficile de contrôler sa dégradation.
Plusieurs types de polymères synthétiques ont été utilisés dans le but de produire un échafaudage y compris polystyrène, poly lactique acide PLLA, poly glycolique acide PGA, et poly dl-lactique-Co-glycolique acide PLGA.
Alors que ces matériaux ont montré un succès impressionnant tant que leurs fabrications assurent une structure adaptée et une dégradation contrôlée, ils ont pour désavantages un risque de rejet dû à une bio-activité diminuée mais aussi un risque de nécrose tissulaire dû à la dégradation par hydrolyse des PGA et PLLA qui produit le dioxyde de carbone et abaisse le PH local et donc aboutit à une nécrose.
La troisième approche est l’utilisation de matériels biologiques comme biomatériaux d’échafaudage tels que le collagène, les protéoglycanes.
Des substrats à base d’alginate et des chitosanes (polyside) ont été utilisés dans la production d’échafaudage pour l’ingénierie tissulaire.
En différence de l’échafaudage à base de polymère synthétique, l’échafaudage à base de polymères naturels sont biologiquement actifs et permettent une excellente adhésion et croissance cellulaires, ils sont biodégradables et permettent à l’hôte de former sa propre matrice après dégradation d’échafaudage, par contre la fabrication d’un échafaudage à base de matériel biologique avec une structure homogène et reproductible est un vrai challenge vu leurs propriétés mécaniques faibles limitant ainsi leur utilisation comme dans le cas d’applications orthopédiques.
Pour résoudre ce problème les chercheurs ont utilisé des échafaudages composites combinant plusieurs phases, par exemple un groupe a ajouté des céramiques à des échafaudages à base de polymères, d’autres ont utilisé des échafaudages à base de collagène surtout dans le cas de régénération osseuse mais aussi cartilagineuse et cardiovasculaires.[37]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_116]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_117]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_118]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_119]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_120]
[7_strategies-implementation-des-mti-en-therapie-oro-faciale_121]
Figure 19 : Micrographie confocale montrant des ostéoblastes (verts) attachés à un échafaudage extrêmement poreux à base de collagène glycosaminoglycane(GAG) (rouge).[37]
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la thérapie innovante dans la sphère oro-faciale ?
La thérapie innovante dans la sphère oro-faciale comprend des médicaments de thérapie innovante (MTI) qui peuvent être classés en quatre catégories : thérapie génique, thérapie cellulaire somatique, ingénierie tissulaire et thérapie innovante combinée.
Quels sont les défis d’implémentation des MTI en Algérie ?
L’article aborde les défis d’implémentation des MTI en Algérie, bien que les détails spécifiques ne soient pas fournis dans le contenu extrait.
Comment fonctionne l’ingénierie tissulaire dans les traitements médicaux ?
L’ingénierie tissulaire utilise des échafaudages combinés à des cellules et biomatériaux pour guider la régénération tissulaire in vitro, permettant ainsi de réparer, remplacer ou régénérer un tissu humain.