Les perspectives futures en prévention des inondations révèlent des enjeux cruciaux pour les communautés vulnérables. En intégrant un système d’information géographique, cette recherche propose des solutions innovantes pour anticiper et gérer les risques d’inondation dans le bassin versant du Tongo-Bassa à Douala.
4. Conceptualisation en rapport avec l’objet d’étude.
Le concept de Prévention
La terminologie des Nations Unies pour la prévention des risques et des catastrophes permet ici de distinguer la « prévention du risques» de la « gestion du risque » qui est quant à elle est une procédure managériale qui prend en compte la répartition des responsabilités, la logique des acteurs institutionnelles et politico-administratives, la mise en œuvre des politiques et stratégies sur le plan national et international jusqu’à la phase technique de collecte, d’analyse, d’interprétation, de réglementation, de surveillance, d’alerte, de déploiement de secours et
de sensibilisation. La gestion intègre donc une vaste structure administrative et décisionnelle la prévention se souciant principalement des volets d’analyse et d’action. La prévention tient largement compte des prévisions qui sont des estimations statistiques définies concernant la probabilité d’un événement dangereux à venir ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée.
La SIPCNU (Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes des Nations Unies) décline la prévention ainsi : « la prévention des risques et des catastrophes renvoie à l’ensemble d’activités permettant d’éviter complètement l’impact négatif des aléas, et de minimiser les
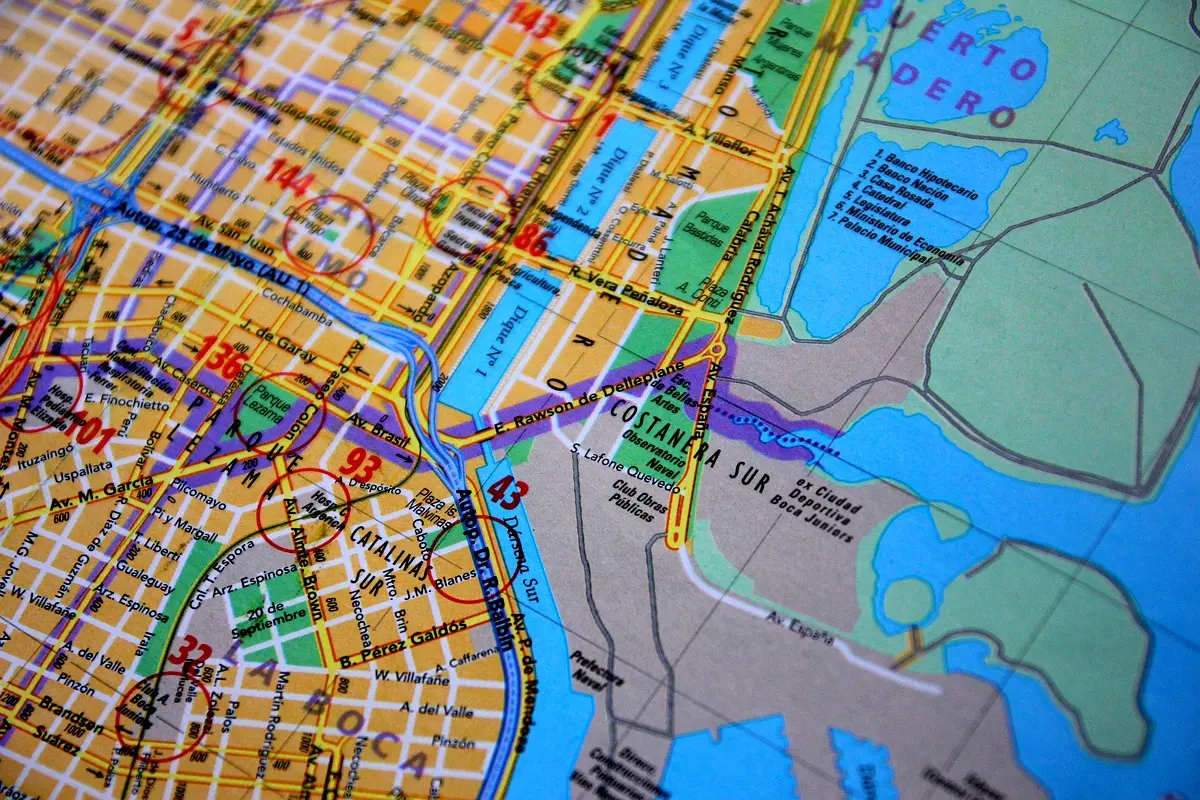
catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées […] Par exemple, les barrages ou les digues, qui éliminent les risques d’inondation, l’utilisation des terres que les règlements ne permettent pas à un règlement dans les zones à risque, les études d’ingénierie sismique qui assurent la survie et la fonction d’un bâtiment en cas de tremblement de terre. » La définition de la SIPCNU reste dans un contexte global. Et pour particulariser, l’approche selon la méthode d’inondabilité nous semble plus acceptable.
Selon la méthode d’inondabilité ou « comment prévenir le risque d’inondation » la prévention du risque d’inondation intègre trois volets obligatoires.
- La culture du risque (La population est concernée par les inondations, la population doit être informée et sensibilisée sur le risque, la culture du risque est nécessaire pour une prévention efficace.)
- L’annonce de la crue (Elle est basée sur des modèles en temps réel des durées des crues, de l’étendue des inondations, et de la vitesse locale des écoulements.)
- Et la gestion du risque (Prise en compte du régime hydrologique, prise en compte des différents aspects de la gestion de l’eau : restructuration, ressource en eau, écosystème aquatique, usage économique.)
La méthode d’inondabilité propose de sensibiliser la population vis-à-vis du risque auquel elle est exposée mais ne prend pas toujours en compte le comportement de la population dans l’analyse de la vulnérabilité. Le risque à ce niveau est évalué par la formule suivante : RISQUE = ALEA X VULNERABILITE L’aléa étant déterminée par le Modèle QDF (débit-durée-fréquence) et la Vulnérabilité étant évaluée par la valeur des enjeux. CAMAGREF
Selon Tacnet J.M. et Burnet R., (2007) La prévention des risques d’inondation est une action d’abord permanente et à long terme qui passe par la collecte et l’affichage des informations sur le risque d’inondation (généralement a partir d’un SIG) la préservation du milieu naturel, l’établissement des mesures structurelles et non structurelles (aménagements réglementés ou adaptés au zones inondables) , la connaissance et la surveillance du risque, les alertes, la sauvegarde (établissement d’une base de donnée dynamique sur le risque d’inondation,) et la préparation des secours. L’analyse du risque d’inondation pouvant être fondée sur un retour d’expérience.
En rapport avec notre objet d’étude, nous avons déployé le concept de prévention de la manière suivante : (voir le schéma conceptuel)
Le concept de SIG
Contrairement à la plupart des technologies géospatiales développées pour des usages militaire, le SIG trouvera d’abord une application civile. La préhistoire académique de la géomatique est à chercher vers 1955 en Suède quand le géographe Hägerstrand code les adresses des ménages du recensement suédois sur les cartes perforées d’une machine mécanographique Hollerith (T.
Joliveau, 2007). Mais on reconnait au chevronné géographe Dr Roger Tomlinson d’avoir tenté pour la première fois en 1960 de produire une base de donnée géographique disponible sous forme numérique. Il voulait répondre aux préoccupations de l’Etat canadien qui était de créer une base de données Géographique pour le cadastre et appliqué à l’aménagement du territoire.
Cette base de données fut appelée Inventaire des Terres du Canada (ITC) ou CLI pour ‘’Canada Land Inventory’’ base de donnée encore utilisée aujourd’hui et dont on peut télécharger des données à l’adresse http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/cli/index.html. (Consulté le 25 Février 2017). Un système d’information était indispensable pour gérer la base de données en question.
Une fois élaboré il fut baptisé Système d’Information Géographique (SIG) ou GIS pour Geographic Information System. (Buckley A., 2014) D’autres auteurs emplois parfois le terme Système d’Information Géospatial pour faire allusion au SIG.
A l’origine, un SIG est donc un programme informatique d’archivage et d’affichage des données géographiques. Puis, viendrons rapidement les fonctions d’analyse et d’abstraction dans les années 1980 avec l’entrée en jeux de la recherche privée propulsée notamment en amont par les commerciaux comme ESRI, Geographic Data Technology, GIMMS, INTERGRAPH, COMPUTERVISION… le SIG évolue alors pour devenir un outil numérique d’aide à la décision privilégié des collectivités territoriales des universitaires et des entreprises.
Même si les années 1980 vont voir l’essor rapide de la télédétection et de ses méthodes de traitements de l’information géographique sur image, ces technologies restent à cette période encore séparées des SIG. J. T. Coppock et D. W. Rhind ; Marc Souris La révolution numérique, la vulgarisation des outils et des systèmes informatisés, la possibilité de prise en charge de grosses données, ainsi que la vulgarisation d’internet dans la fin des années 90 élargissent les fonctions et les barrières du SIG.
L’acquisition ou la collecte des données géographiques est désormais rattachée par certains auteurs aux fonctions d’un SIG. Par la suite les analyses, les suivis, observations et échanges en temps réel deviennent possibles, et enfin les applications de cartographie web «Webmapping » ouverts au grand public non professionnel s’en suivent. Le concept de SIG devient alors polysémique et dès lors, diffère
selon les cas et les contextes. Plusieurs définitions de SIG existent de nos jours, mais on retient communément deux définitions de ce qu’est un SIG. La première est française et la seconde est américaine.
La définition française est reçue de l’économiste Michel Didier (1990), dans une étude réalisée à la demande du CNIG : Cette définition considère qu’un système d’information géographique est un « ensemble de données repérées dans l’espace, structuré de façon à pouvoir en extraire commodément des synthèses utiles à la décision« .
La définition américaine émane du comité fédéral de coordination inter-agences pour la cartographie numérique (FICCDC, 1988) et stipule qu’un système d’information géographique est un « système informatique de matériels, de logiciels, et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l’analyse, la modélisation et l’affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d’aménagement et de gestion ».
La définition américaine nous semble plus adaptée à l’objet de notre étude car elle va au-delà de la structuration des données géographiques (limitée dans un logiciel) pour considérer les accessoires et matériels de collecte d’archivage et de diffusion des données. D’une manière ou d’une autre, un SIG complet doit pouvoir remplir au moins 5 fonctions : l’Acquisition, l’Affichage, l’Analyse, l’Abstraction, et l’Archivage des données.
On parle couramment des
« 5A ».
En guise de synthèse, l’Ingénieur Jean Poulit et ancien directeur général de l’IGN, loin de se limiter à un logiciel, a caricaturé le SIG ainsi : « Le SIG c’est comme un voiture! Le carburant c’est les données, le volant c’est l’utilisateur, le tableau de bord c’est les partenaires et les intégrateurs, et le moteur c’est le logiciel. » Nous avons donc déployé le concept de SIG dans la BVTB de la manière suivante : (Voir figure 6, page 37)
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la prévention des risques d’inondation selon la SIPCNU?
La prévention des risques et des catastrophes renvoie à l’ensemble d’activités permettant d’éviter complètement l’impact négatif des aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées.
Quels sont les trois volets obligatoires de la méthode d’inondabilité?
La méthode d’inondabilité intègre trois volets obligatoires : la culture du risque, l’annonce de la crue et la gestion du risque.
Comment évaluer le risque d’inondation?
Le risque est évalué par la formule suivante : RISQUE = ALEA X VULNERABILITE, où l’aléa est déterminé par le Modèle QDF (débit-durée-fréquence) et la vulnérabilité est évaluée par la valeur des enjeux.
