Les perspectives futures en théologie révèlent des approches novatrices face à la crise écologique actuelle. En s’inspirant de Saint François d’Assise, cette recherche propose une transformation nécessaire des relations entre l’homme, la nature et le Créateur, avec des implications critiques pour notre compréhension de la théologie de la création.
CONCLUSION GENERALE
La théologie de la création : quelques approches contemporaines à l’heure de la crise écologique. Cela a constitué le titre de notre travail de recherche. Au terme de notre investigation théologique, nous sommes à même de proposer notre synthèse enrichie d’un parcourt herméneutique du va-et-vient entre la théologie de la création et la science écologique. Notre préoccupation majeure était de découvrir et d’enrichir la possibilité d’élaboration d’une théologie de la création qui prend en compte le contexte de la crise écologique actuelle. Précisément, il s’agit de penser et de dire Dieu dans un contexte de la crise qui s’offre comme un locus theologicus.
Au terme de notre parcourt, il nous semble plausible d’affirmer que la crise écologique actuelle est un kairos, un moment favorable pour l’approfondissement de la réflexion théologique. Depuis la nuit de temps, les moments de crise ont été souvent une bonne nouvelle pour théologie et pour la foi chrétienne. Il va sans dire qu’au cours de l’histoire de l’Eglise, c’est le temps des crises doctrinales surtout christologique exprimées en terme d’hérésies que l’Eglise a pu clarifier et redéfinir sa doctrine. En l’occurrence, ce sont les hérésies christologiques du 4ème et 5ème siècle qui ont permis à l’Eglise de définir sa doctrine christologique et trinitaire d’une manière définitive.
Dans notre travail, nous avons démontré d’une part, que la crise écologique actuelle constitue un lieu théologique majeur ; et d’autre part, que la théologie chrétienne détient des ressources nécessaires pour contribuer substantiellement à l’harmonie cosmo-théandrique. La théologie n’a pas seulement quelque chose à apporter, mais, concrètement, pour fonder adéquatement des préoccupations écologiques, il est plus que nécessaire de recourir aux sources théologiques. Il est donc incontestable que la survie et l’épanouissement de la nature dépendent de l’épanouissement de la réflexion théologique. En fait, il s’agit d’une circularité faconde et fécondante entre la science et la foi, entre la théologie et l’écologie.
Comme nous l’avons indiqué dans notre introduction, plusieurs scientifiques et activistes écologiques ont formulé le procès contre l’Eglise et sa théologie, les inculpant du manque d’intérêt en matière de la crise écologique et même comme étant à la base de son amplification. Certains penseurs comme l’historien médiéviste américain Lynn White, sont allés même jusqu’à trouver des racines profondes de la crise écologique dans la foi chrétienne et sa tradition théologique et biblique. Certes, leur thèse n’est pas à rejeter sans examen critique. La crise écologique n’a pas été une préoccupation majeures dans l’Eglise et dans la théologie chrétienne jusque très récemment.
Toutefois, il faudra reconnaître que les questions environnementales dans l’ensemble de la société humaine constituent une préoccupation nouvelle. Ainsi, ce procès à l’endroit de l’Eglise et de la théologie pourrait s’adresser également à toutes les autres disciplines scientifiques, telles que la philosophie, la physique naturelle, la biologie et j’en passe. Ce serait alors trop demander à la théologie en tant science herméneutique de répondre anticipativement aux préoccupations ne faisant pas partie des vécus quotidiens de la société humaine.
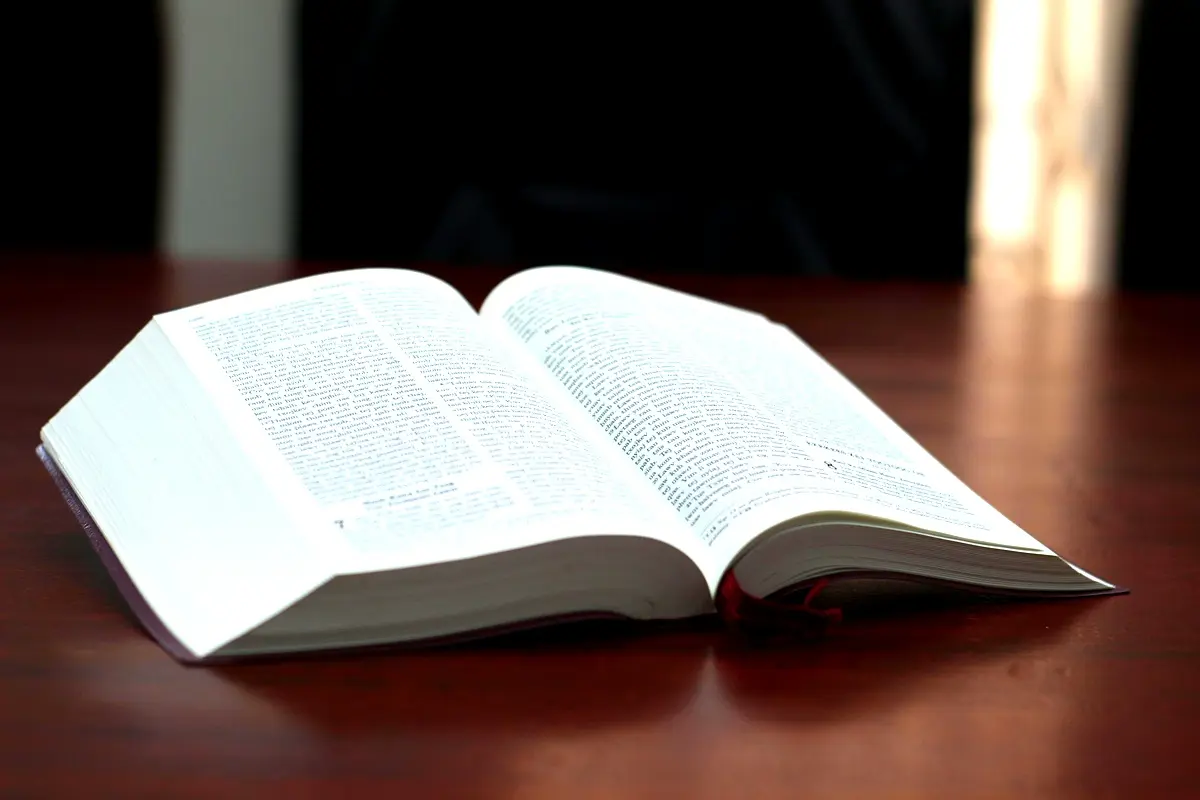
En plus, la crise écologique actuelle ou du moins notre prise de conscience d’elle étant un problème nouveau, la lenteur apparente de la théologie chrétienne à s’y investir ne devrait pas être en soi une source d’embarras. D’ailleurs, l’on a constaté la même réaction plus au mois lente à l’égard d’autres interrogations contemporaines.
Nous pouvons citer à titre d’exemple les nouvelles technologies, les mouvements d’émancipation, le pluralisme religieux, la culture postmoderne, le déclin du communisme et l’émergence de l’ère de l’information. Il est donc évident que la théologie en tant que « intellectus fidei » ne se laisse pas toujours entraîner à répondre hic et nunc aux interrogations nouvelles.
Quoi qu’il en soit, c’est à travers cette confrontation avec les situations nouvelles que la pensée théologique se renouvelle, se précise et se redynamise. Ce qui serait condamnable n’est donc pas sa lenteur de faire face à de nouvelles crises, mais son éventuel refus de se laisser transformer par elles. La crise écologique actuelle est donc une opportunité pour l’Eglise appelée à revisiter et à réinterpréter sa doctrine de la création de manière à favoriser l’harmonie cosmo-théandrique et la paix cosmique.
Notre travail s’est inscrit donc dans cet effort de fonder théologiquement les préoccupations écologiques en partant de la reformulation de la doctrine chrétienne de la création. Pour arriver à affirmer notre hypothèse, nous avons dans un premier temps fait une analyse herméneutique approfondie de l’état des lieux. Il s’agit de la situation de la crise, sa signification, sa manifestation et ses racines profondes multiformes. Cette situation de crise a constitué le contexte de notre recherche car « un texte sans contexte est un prétexte » dit-on. Nous avons proposé ce contexte de crise écologique comme lieu où la théologique de la création peut s’élaborer et se préciser.
Nous avons affirmé surtout avec l’appui de l’encyclique Laudato Si, que l’heure est grave et c’est la survie de l’humanité toute entière et son environnement naturel qui est en jeu. L’encyclique du Pape rejoint l’invocation de Saint François d’Assise dans son Cantique des Créatures, qui rappelle que la terre doit être accueillie à bras ouverts comme membre de notre famille. Nous faisons partie de la terre et notre corps est lui-même constitué des éléments de la planète ; son air, son eau et j’en passe. Mais aujourd’hui, cette terre, notre habitation, maltraitée et saccagée pleure et crie au secours. Personne n’est peut rester indifférent et surtout pas l’Eglise du Christ qui veut qu’advienne sur la terre le Royaume de Dieu.
Les raisons à la base cette crise sont légion mais dans l’ensemble il est triste de constater que la plupart sont anthropiques, c’est-à-dire qu’elles ont leur origine dans l’activité humaine. Il s’agit surtout des conséquences de la crise moderniste liée à l’anthropocentrisme moderne, au relativisme pratique, à l’innovation biologique à partir de la rechercher et j’en passe. Nous avons découvert aussi qu’à la racine de cette crise, il y a la démesure humaine dans la production et l’exploitation liée au pouvoir de la technologie, à la mondialisation et à la globalisation du paradigme technocratique allant de pair avec la stigmatisation des civilisations traditionnelles.
Dans un deuxième temps, nous avons analysé quatre nouvelles approches de la théologie de la création élaborées en tenant compte de cette question fondamentale de l’existence de l’homme. En effet l’interrogation qui a été au cœur de notre débat ne concerne pas seulement l’environnement de manière isolée mais elle nous conduit nécessairement à nous interroger sur le sens même de notre existence dans le monde.
Toutes ces approches que nous avons étudiées invitent l’homme à se tourner envers Dieu, le créateur de tout ce qui existe. Les quatre théologiens s’appuyant sur les données de la Révélation divine et des nouvelles découvertes de science ont fait une tentative de sortir le Dieu Créateur de l’emprise de la théologie classique pour le rendre présent auprès de sa création dans une circularité cosmo-théandrique permanente.
Dans ces nouvelles approches, la création comme acte premier du Créateur en faveur de ses créatures ne peut plus se comprendre sur le modèle d’une production achevée. Elle n’est plus réductible à un discours sur le commencement du monde, identifiant une première cause et comprenant Dieu sur le modèle de l’artisan, de l’ingénieur voire de l’horloger cosmique. Elle ne se comprend plus donc comme un acte du passé. Bien au contraire, les nouveaux paradigmes mettent en exergue plutôt une relation actuelle du Créateur avec toute sa création. Elle est un acte continu dans le sens que Dieu prend au sérieux la temporalité inscrite dans son œuvre.
Dieu crée par évolution par sa bonté et pour sa gloire et il participe au jeu de la création avec toutes les composantes de l’univers. En créant le monde, Dieu entre en même temps en lui et l’habite par son esprit. Il est donc à la fois transcendant et immanent au monde. Comme conséquence ce monde qui lui appartient et qui est créé pour sa gloire est porteur d’un sens ultime en tant que déploiement d’une promesse divine. C’est en définitive cette approche eschatologique de la création qui favorise la complicité de toute les composantes de la création et qui ouvre l’homme à la réconciliation avec son environnement naturel.
Notre travail de recherche resterait incomplet et moins fécond s’il ne nous permettait pas d’intégrer la réflexion théologique africaine sur ce sujet brulant et pertinent. Pour y arriver, notre démarche s’est nourrie, précisément de l’herméneutique des quelques perspectives africaines dans l’articulation de la théologie de la création et la science écologique.
Notre analyse de la théologie africaine sur la création nous a permis de cerner la préoccupation de l’homme africain de rechercher l’harmonie cosmo-théandrique qui semble s’envoler dans le sillage de l’ouverture aux cultures et civilisations modernes. Quelques soient les secousses dues à la problématique de la mondialisation et de la décadence spirituelle, la théologie africaine est riche en ressources nécessaires pour favoriser des relations authentiques entre toutes les composantes de la création.
Nous avons développé ces ressources en trois moments, à savoir ; les Religions traditionnelles et la spiritualité négro-africaine, le redécouverte des sources chrétiennes particulièrement la théologie biblique et patristique et la lecture anthropologique pour la libération intégrale de l’homme. Comme toute théologie, la théologie de la de la création en Afrique s’élabore en tenant compte de la structure cosmo-théandrique, impliquant l’herméneutique de la parole de Dieu, l’herméneutique de l’expérience humaine et l’herméneutique de la nature.
Etant donné que pour l’homme africain c’est la vie qui est au centre, l’atteinte à la nature est inacceptable puisqu’elle occasionnerait des déséquilibres cosmiques et menacerait ainsi l’intégrité de la vie.
En définitive, il nous semble plausible d’adopter et de proposer le modèle intégratif du Pape François comme la synthèse des approches qui ont fait l’objet de notre étude. Le nouveau paradigme de l’écologie intégrale533 serait donc pour nous une approche fondamentale de la sauvegarde de notre maison commune. En effet, il est inconcevable de considérer la nature comme séparée de l’homme, car tout dans l’univers est intimement lié.
Il faudra désormais incorporer la place spécifique de l’être humain dans le monde et sa relation avec Dieu et avec le cosmos. La crise écologique elle-même est à considérer dans son intégralité. En fait, comme le dit le Pape, « il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale »534.
Il faut donc considérer d’une manière intégrative l’écologie environnementale, l’écologie économique et sociale, l’écologie culturelle et l’écologie de la vie quotidienne. Les approches que nous avons étudiés et les perspectives théologiques africaines concourent toutes à l’unité cosmique s’inscrivant ainsi dans la dynamique papale du l’écologie intégrale.
De même, en intégrant la perception anthropologique avec la compréhension cosmologique dans une perspective holistique, la vie éternelle devient une réalité intégrale qui concerne toute la société humaine ainsi que toute la création divine. La dimension eschatologique de la création devient ainsi le point culminant de tout ce qui existe. C’est pour cela que l’Apocalypse affirme qu’au terme de la vie présente, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre (Ap 21,1) où les être humain ensemble avec toute la création vivront une vie béatifique en présence de Dieu.
Terminons en disant que la crise écologique actuelle, tout en étant alarmante n’est pas une fatalité. La théologie à tout niveau doit, face à cette crise, et devant la tentation du désespoir, chercher toujours à porter un message de résurrection et d’espérance. Les théologiens chrétiens doivent faire preuve d’une responsabilité d’avant-garde jouant leur rôle prophétique dans l’ensemble de la société. Il faudra surtout adopter une démarche intégrative, inclusive, fondamentale, œcuménique, herméneutiquement compréhensible et bibliquement fondée et applicable. Cela restera la problématique à la fois dialectique et dialogale entre la théologie et la science écologique dans laquelle notre travail de recherche n’a été qu’une sonnette d’alarme avec l’espoir qu’elle pourra susciter l’intérêt d’approfondissement dans les recherches ultérieures.
534 Ibidem, n° 139.
________________________
533 Cf. Laudato Si, n° 137 -162 ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les racines de la crise écologique selon Lynn White Jr.?
Lynn White Jr. attribue les racines historiques de la crise écologique à l’anthropocentrisme du christianisme occidental.
Comment la théologie chrétienne peut-elle contribuer à l’harmonie cosmo-théandrique?
La théologie chrétienne détient des ressources nécessaires pour contribuer substantiellement à l’harmonie cosmo-théandrique.
Pourquoi la crise écologique actuelle est-elle considérée comme un moment favorable pour la réflexion théologique?
La crise écologique actuelle est un kairos, un moment favorable pour l’approfondissement de la réflexion théologique, car les moments de crise ont souvent été une bonne nouvelle pour la théologie et la foi chrétienne.