Les perspectives futures des MTI révèlent des enjeux cruciaux pour la santé oro-faciale. Alors que les applications innovantes promettent des solutions aux pathologies complexes, les risques associés soulèvent des questions essentielles sur leur mise en œuvre en Algérie, transformant notre compréhension des traitements disponibles.
Risques, précautions et limites liées aux médicaments de la thérapie innovante :
Risques liés aux MTI :
Les risques liés aux MTI sont encore mal connus, malgré la forte volonté politique et juridique de favoriser l’accès à ces médicaments innovants, on manque encore de recul concernant les résultats étant donné leurs variétés et la complexité des processus techniques et innovants auxquels ils sont soumis.
Le « risque » est défini comme un « effet défavorable potentiel qui peut être attribué à l’utilisation clinique du MTI et préoccupant le patient ou d’autres populations (p. ex les soignants). La détection des risques doit se poursuivre tout au long du développement des MTI afin de prévenir et/ou de minimiser le risque dans la mesure du possible.
Un organigramme de haut niveau allant de la manufacture jusqu’à l’administration de la thérapie doit inclure la récolte des cellules, le transport, le contrôle, la manipulation, le conditionnement et le suivi clinique post thérapeutique. Les risques situés ci-dessous sont réalisés selon l’ordre chronologique de la fabrication, le dépôt, l’application et le suivi clinique.
Risques pour le patient liés à la qualité des caractéristiques, le stockage et la distribution des produits :
- Risque de transmission des maladies : selon l’origine des cellules et tissus (allo-génique, auto-génique) on peut avoir un risque potentiel de transmission des maladies infectieuses virales, bactériennes ou parasitaires) où d’infestations.
- Risque de tumorigénicité : selon les caractéristiques des produits : cultures extensives pour prolifération cellulaire (exemple de la cellule mésenchymateuse), le potentiel de différenciation peut être affecté en ayant des mutations et aboutissant à un risque élevé de tumorigénicité (surtout dans le cas de modification génique).
Risques liés au stockage, transport et distribution du produit : lors de la conservation, congélation et dégel, il y a des risques de rupture de la chaîne de froid ou d’un autre type de conditions de température. Cela pourrait avoir un impact sur l’activité biologique des MTI menant potentiellement à l’échec de traitement.
Risques liés au patient ayant des pathologies ou conditions défavorables, par rapport aux traitements concomitants et aux interactions médicamenteuses :
- risques liés aux modifications génétiques prévues ou non prévues du malade (apoptose, malignité, changement de la fonction, altération de la croissance/différenciation) ;
- risques liés aux conditions des patients (exemple cas de CD34 cellules modifiées génétiquement positivement, en oncologie dans le cas des cellules CAR-T) ;
- une immunogénicité indésirable et ses conséquences : (maladie de greffon contre l’hôte GVHD, choc anaphylactique, rejet du greffon, inflammation, déficit immunitaire, syndrome de libération des cytokines, réaction d’hypersensibilité, neutralisation des anticorps) ;
- les conséquences précoces et tardives liés à la différenciation, migration et prolifération des cellules greffées, on cite le risque d’infection, de saignement et d’anémie ;
- risques liés à l’infection par le vecteur utilisé dans la thérapie innovante génique : type de vecteur, les cellules cibles, persistance, potentiel de latence et réactivation, une expression prolongée du gène transporté et modification de l’expression des gènes de l’hôte ;
- risque lié au suivi clinique (exemple : immunosuppression associée à la Co-médication nécessaire au traitement des complications).
- Risques pour le patient liés aux procédures de reconstitution : Erreurs de dosage ou mauvaise administration.
Risques pour les patients liés aux procédures d’administration et ré-administration :
- risques associés à des interventions médicales ou chirurgicales ou à l’administration des produits (perfusion, transfusion, implantation, etc.) ;
- risques liés à des interventions chirurgicales ou administrations répétées (exemple : administration dans le cerveau via des perforations réalisées sur le crâne) ;
- risques liés aux dispositifs médicaux (techniques ou aspects mécaniques) aboutissant aux erreurs de médication ou à une mauvaise administration.
Risques liés à la persistance des produits chez le patient :
- complications tardives, en particulier les malignités et l’auto-immunité ;
- risques d’intégration non spécifiques avec d’autres cellules en ayant le pouvoir de malignité ;
- des considérations sur l’impact potentiel des thérapies antérieures, concomitantes ou prospectives sur le produit ou vice-versa et l’impact du produit sur ces autres thérapies (p. ex. un traitement à l’immunoglobuline plus tard dans la vie pourrait avoir un impact sur l’expression du gène introduit par interaction anticorps) ;
- le risque d’intégration du germe utilisé comme transgène ou apparition des mutations génétiques du germe.
Risques pour les professionnels de la santé, les soignants, les enfants et autres contacts étroits et les risques pour l’environnement :
Si un risque pour les professionnels de la santé, les soignants, les enfants, les patients et d’autres contacts étroits avec le produit ou sa composante est identifié, ce risque devrait également être pris en compte dans la spécification de sécurité (ceci est basé sur l’évaluation des risques environnementaux).
La réplication du virus / vecteur peut persister chez le patient pendant de longues périodes et peut augmenter en quantité. Par conséquent, le potentiel d’excrétion peut être plus élevé avec la réplication du virus / vecteur et pourrait donc entraîner une plus grande probabilité de transmission. Pour la réplication du virus / vecteur, l’analyse des variantes moléculaires sera également importante et pourrait avoir un impact sur le virus / transmission vectorielle, elle fait référence aux principes généraux de l’ICH pour lutter contre l’excrétion de virus et de vecteurs. (EMEA/CHMP/ICH/449035/2009).
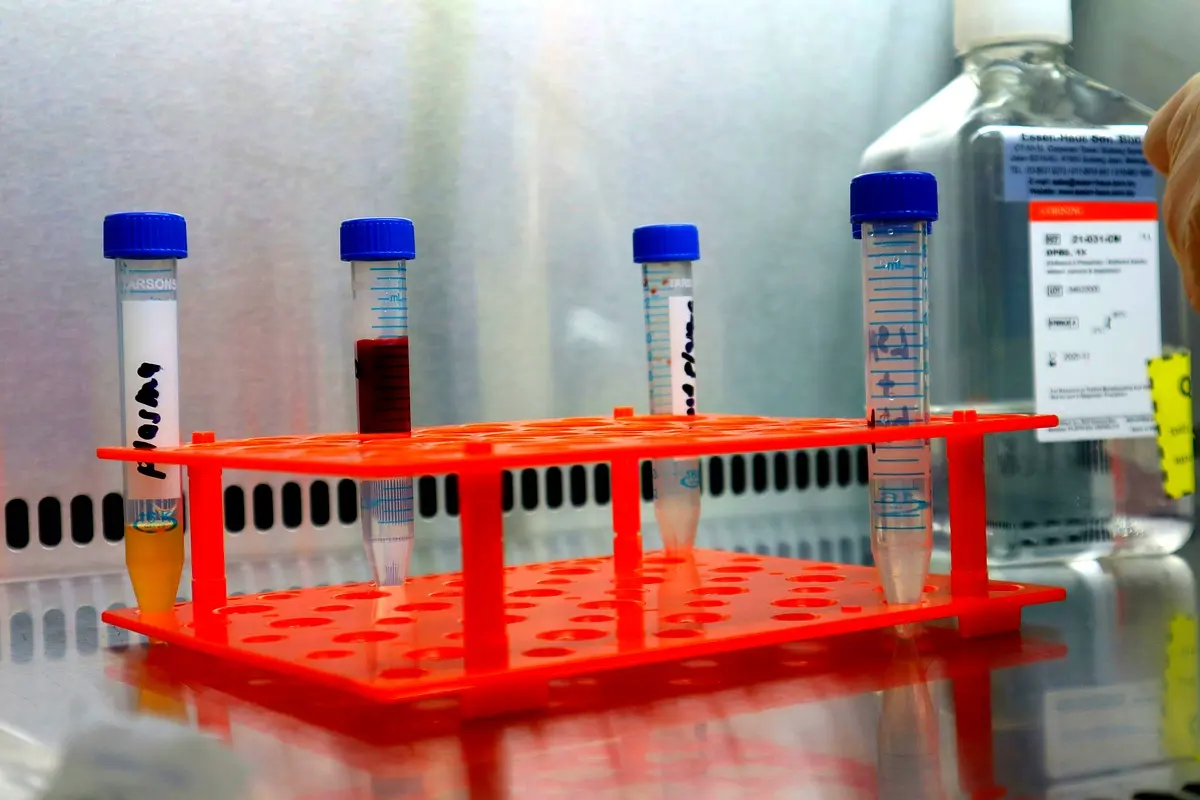
Un médicament de thérapie génique contenant ou composé d’un organisme génétiquement modifié (OGM) capable d’assurer une réplication ou diffusion peut présenter un risque de transmission dans l’environnement ; les effets indésirables peuvent être liés à des gènes insérés et à leurs produits, mais aussi à un changement imprévu de la gamme hôte ou du tropisme tissulaire, de l’infectiosité, de la virulence ou de la latence de l’OGM généré. Tous ces effets doivent être pris en compte, soit en faisant des hypothèses théoriques basées sur des données scientifiques connues, soit en évaluant expérimentalement les prérequis sur le suivi de l’innocuité et de l’efficacité et la gestion des risques des médicaments de thérapie innovante.
Les risques spécifiques parent-enfant, par exemple, la transmission fœtale (vecteurs, substances biologiquement actives, cellules, agents infectieux, etc.), l’exposition trans-mammaire des enfants aux femmes allaitantes (vecteurs, substances biologiquement actives, cellules, agents infectieux, etc).
- Précautions liées aux MTI :
Il n’y a pas de mention concernant le principe de précaution dans les textes de droit dérivés applicables aux MTI ni apparition dans les textes généraux applicables aux médicaments, tels la directive 2001/83/CE ou le règlement (CE) n°726/2004, ni dans le règlement (CE) n°1384/2007 concernant les MTI.
De plus, la Commission européenne ne refuse et ne retire pas une AMM concernant un MTI en application du principe de précaution, aucun retrait d’AMM n’a été fait à la demande de la commission et celle-ci a toujours suivi les avis scientifiques de l’EMA pour les MTI.
Par ailleurs, il n’y a aucune invocation du principe de précaution par les états membres pour la justification d’une entrave à la libre circulation des MTI. Il n’y a pas de contrôle juridictionnel des mesures de précaution applicables aux MTI.
On peut dire qu’à ce jour, il n’y a pas assez de recul concernant l’application du principe de précaution dans le domaine des MTI dans la mesure où il n’existe pas de situations où celui-ci a été explicitement revendiqué pour les MTI.
Contre-indications de la thérapie innovante :
Contre-indications absolues :
- patient avec cancer métastatique et dont le pronostic est défavorable ;
- patient avec troubles psychologiques sévères non stabilisés ;
- une maladie infectieuse non contrôlée ;
- rapport coût/ bénéfices et rapport coût/espérance de vie défavorable ;
- l’impossibilité de déroulement des procédures dans des conditions de travail favorables.
Contre-indications relatives :
- une maladie cardiovasculaire ou respiratoire sévère rendant difficile ou impossible le déroulement d’une anesthésie générale ;
- une obésité majeure avec un IMC supérieur à 50kg/m2 ;
- un patient polymédiqué dont les médicaments peuvent créer une interaction avec le produit ou ses effets ;
- un patient âgé avec plusieurs maladies chroniques pouvant altérer le pronostic du traitement ;
- un patient susceptible de produire une réaction immunologique et une hypersensibilité majeure.
Inconvénients :
- le coût élevé de la thérapie médicale innovante ;
- les procédures multiples compliquées jusqu’à l’administration du produit nécessitant une manipulation précise et rigoureuse dans des conditions strictes ;
- la faible disponibilité des médicaments de la thérapie innovante en dehors de l’Union Européenne et des Etats Unis ;
- l’efficacité du traitement n’est pas toujours stable ;
- la nouveauté des médicaments de thérapie innovante d’où l’appellation innovante implique un manque d’études sur les effets secondaires possibles en post-thérapeutique ;
- difficulté de la procédure en raison du manque d’expérience du personnel médical.
Limites :
La thérapie génique utilise un gène qu’elle introduit dans les cellules du malade, selon la nature des cellules touchées, on distingue deux méthodes :
La thérapie génique germinale ou thérapie génique sexuelle consisterait à appliquer la thérapie génique à un embryon au stade où celui-ci est formé d’un amas de cellules, ou aux cellules germinales (ovules, spermatozoïdes) d’un adulte. Le gène introduit serait alors transmis à toutes les cellules filles des premières cellules embryonnaires, c’est-à-dire à toutes les cellules du futur individu : il y aurait donc modification du patrimoine génétique de l’espèce humaine.
De plus, les cellules germinales du futur individu étant touchées comme les autres, le nouveau patrimoine serait transmis héréditairement à toute sa descendance. Une telle approche thérapeutique viole le principe de ne jamais toucher au patrimoine héréditaire d’un individu et est donc formellement interdite, de peur qu’elle ne soit progressivement utilisée pour des indications non justifiées (par exemple pour corriger des défauts non invalidants mais simplement disgracieux), puis à des fins d’eugénisme. La thérapie génique germinale semble n’avoir dans l’état actuel de nos connaissances, ni indication, ni légitimité.
La thérapie génique somatique consiste à introduire les gènes exclusivement dans des cellules somatiques (non sexuelles). C’est à cette technique que se limite actuellement le champ d’activité et de recherche en thérapie génique.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les risques liés aux médicaments de thérapie innovante ?
Les risques liés aux MTI incluent la transmission de maladies, la tumorigénicité, des problèmes de stockage et de transport, ainsi que des risques associés aux conditions des patients.
Comment les risques des MTI sont-ils détectés ?
La détection des risques doit se poursuivre tout au long du développement des MTI afin de prévenir et/ou de minimiser le risque dans la mesure du possible.
Quels sont les risques pour le patient lors de l’administration des MTI ?
Les risques incluent des erreurs de dosage, des interventions médicales ou chirurgicales, ainsi que des complications liées à l’immunogénicité et aux infections.
Quels sont les défis d’implémentation des MTI en Algérie ?
L’article aborde les défis d’implémentation en Algérie, bien qu’il ne détaille pas spécifiquement ces défis, il souligne la complexité des processus techniques et innovants.