La méthodologie SIG pour inondations révèle des enjeux cruciaux dans la gestion des risques au Tongo-Bassa, où l’occupation non réglementée des lits de cours d’eau exacerbe les inondations. Cette étude innovante offre des solutions pratiques pour alerter et sensibiliser les populations vulnérables, transformant ainsi la prévention des catastrophes.
Les données d’intermédiaire de traitement ou données de sortie
Les points côtés
Une de nos principales données d’intermédiaire de traitement sur lesquelles nous avons reposé notre étude a été les points cotés. Sans les données altimétriques de haute résolution, une spatialisation détaillée et concrète du risque d’inondation dans le BVTB n’aurait été possible. La pertinence des points cotés ont permis une reconstitution avancée du relief par les méthodes dites « Anudem » pour les analyses hydrologiques et du « Krigeage simple » pour les paramètres topographiques.
Les résultats n’auraient pas été pareils si nous avions fait usage des imageries obtenues par télédétection satellitale (LANDSAT, SRTM, DEM ASTER…). Compte tenu du fait que les 15000 points côtés de la cartographie de Douala utilisés pour l’interpolation de la zone d’étude étaient des points obtenus par photogrammétrie et par relevées topographiques au sol, nous pensons qu’à l’absence d’une nouvelle campagne de photogrammétrie ou d’imagerie LIDAR, ces points côtés restent les plus conseillés en matière de reconstitution du relief dans le BVTB et voir même
au-delà.
Tableau 15 : Tableau des principales données d’intermédiaire de traitement.
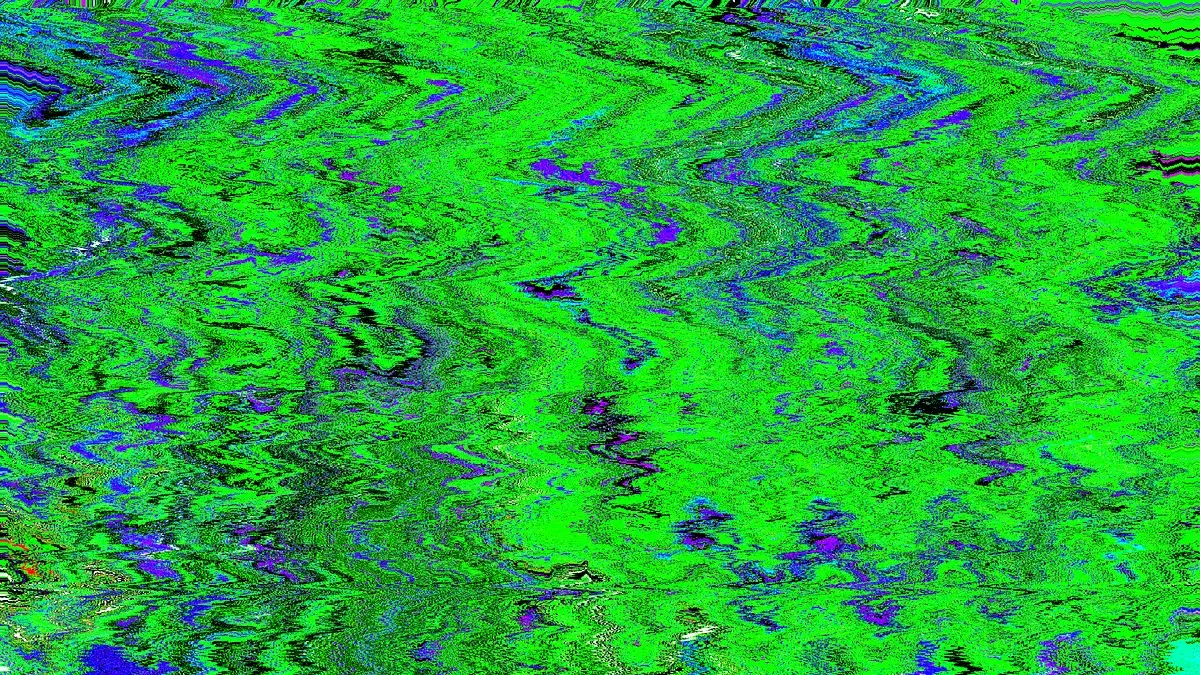
| Tableau des principales données d’intermédiaire de traitement. | |
|---|---|
| Paramètre/Critères | Description/Valeur |
| Points côtés | 15000 points obtenus par photogrammétrie et relevés topographiques au sol. |
120
Le bassin versant de la zone d’étude
Pour obtenir le bassin versant de notre zone d’étude, nous avons procédé par une méthode standard propre aux SIG. Après obtention du MNT par la méthode Anudem, nous avons appliqué un algorithme de correction des cuvettes et des dépressions pour prévenir les erreurs de reconstitution des sens d’écoulement des flux. Par la suite, nous avons exécuté un algorithme de détection et de restitution des sens d’écoulement des flux, et enfin, nous avons lancé un algorithme de délimitation des principaux bassins versants. Par ce procédé, les SIG sont en mesure de délimiter un bassin versant avec une précision relative au Modèle numérique de terrain.
Conversion en couche vectorielle
Détection de la ligne de partage des eaux
Calcul du sens d’écoulement des flux
Correction des cuvettes et des dépressions
Reconstitution du relief (MNT Anudem)
Points côtés
Source : Tchameni Franck 2017
Figure 31 : Approche de délimitation du bassin versant du Tongo-Bassa
Les principaux sous bassins versants de la zone d’étude
Le cas de la délimitation des sous bassins versant peut parfois diverger et des résultats peuvent varier selon les paramètres de configuration qu’on entre dans les SIG. Certains résultats peuvent paraitre trop fragmentés en fonction des objectifs visés. D’une manière générale, il est plutôt conseillé de définir manuellement l’exutoire ou le point de confluence des principaux
affluents afin que le SIG reconstitue la ligne de partage des eaux à l’échelle de ce sous bassin sans trop fragmenter les aires de drainage. Le processus suivant a été déployé :
Détection de la ligne de partage des eaux
Conversion en couche vectorielle
Définition de l’exutoire ou du point de confluence
Calcul du sens d’écoulement des flux
Correction des cuvettes et des dépressions
Reconstitution du relief (MNT Anudem)
Points côtés
Source : Tchameni Franck 2017
Figure 32 : Approche de délimitation des sous bassins versants du bassin du Tongo-Bassa
Le réseau hydrographique
La couche de réseau hydrographique qui a accompagné nos travaux a été éditée par nous. Les fichiers fournis par la CUD ne répondaient pas à nos attentes dans la mesure où les calculs des différents indices de réseaux devaient largement s’appuyer sur les paramètres géométriques des rivières. Outre, divers paramètres ont par la suite exigé une bonne précision géométrique des profils des rivières. A cet effet, les fichiers de la CUD étaient moins précis.
Il est possible dans un SIG de reconstituer un réseau hydrographique, voir même un réseau de drainage partant tout simplement du MNT. Dans une certaine mesure, les résultats peuvent être validés. Mais il ne s’agit en réalité que d’une estimation abstraite. Les ordres des rivières que nous avons utilisés pour estimer les puissances de rivières sont calculés dans les SIG selon un procédé similaire, ce qui nous a obligé à faire une réadaptation manuelle pour les rivières digitalisées. Lorsqu’un travail demande une bonne précision dans le profil
géométrique linéaire des cours d’eau, il est plutôt souhaitable de procéder par une digitalisation manuelle à partir d’une vue aérienne si le tracé ne peut être fait sur le terrain par GPS. Les plans d’eau tels que les lacs et les emprises des fleuves peuvent dans une certaine mesure être reconstitués par classifications supervisées. Mais en raison de leurs colorations différentes, nous les avons reconstitués manuellement.
L’occupation du sol
L’occupation du sol désigne à ce niveau l’ensemble des principales formes de mise en valeurs ou d’appropriation du bassin. Dans nos analyses nous nous sommes réduits à cinq (5) classes fondamentales à savoir : les bâtis et les sols revêtus, les sols nus, les friches, la brousse et les plans d’eau.
Grâce à la résolution spatiale du raster d’échantillonnage mosaïqué (1:4500ème), nous avons pu produire des résultats appréciables. Tout le long de ce travail la classe d’occupation du sol qui a régulièrement été utilisée était la végétation en tant qu’espace mis en valeur sur le plan agricole. Les valeurs des différentes superficies d’espace végétale que nous avons dans ce travail sont les valeurs combinées des « friches » et des « brousses » intersectant la zone à risque d’inondation dans les bas-fonds marécageux.
En SIG et en télédétection, on procède généralement par classification supervisée ou non supervisée pour cartographier et mesurer la végétation et les sols nus. Par contre, il n’est pas très conseillé de se limiter à cette technique pour la cartographie des autres formes d’occupation du sol (Batis, routes, hydrographie…) si non cela limiterait grandement les capacités d’analyse. C’est pour cela que nous avons fait recours aux entités digitalisées pour les analyses des autres paramètres et notamment les enjeux humains localisées (Voirie, centres de santé, écoles, ménages, installations électriques…). Le schéma suivant montre le processus déployé dans le SIG pour cartographier l’occupation du sol et plus précisément pour évaluer les superficies des espaces verts mis en valeurs par des activités agricoles.
Conversion en couche vectorielle
Calcul des classes d’occupation du sol (maximum likelihood)
Création des signatures spectrales
Définition des parcelles d’entrainement
Mosaïque raster (3 bandes RGB)
Source : Tchameni Franck 2017
Figure 33 : Approche de cartographie de l’occupation du sol du bassin versant du Tongo- Bassa.
La zone à risque d’inondation
La zone inondable de la zone d’étude que nous avons reconstituée et simulée est intimement liée au MNT. Nous rappelons que les paramètres tels que les débits des cours d’eau, les hauteurs de précipitations, l’humidité du sol… n’ont pas été entré dans le SIG pour la simulation de cette zone inondable.
Mais on sait au moins une chose, c’est que la propagation des ondes de crue et la configuration des pentes sont extrêmement liées et cela est vérifiable dans toutes les zones inondables. En absence d’une chronologie et des repères historiques des crues, nous avons considéré les hauteurs observées de la crue de 2016 (pluie du probatoire) dans l’ensemble du bassin versant et nous l’avons établi comme une crue décennale (Q10) sachant que la crue de référence d’Août 2000 n’a pas encore été battu.
Bien attendu le rythme de la marée qui influence l’hydrologie du bassin a rendu la simulation plus complexe.
Nous avons constaté que dans la zone de balancement de la marée, la zone à risque d’inondation épouse un profil continu d’une altitude de près de 3,5 mètres par rapport au niveau moyen de la mer calculé par le marégraphe de Pointe noir au Congo. Au-delà de la zone de balancement de la marée, nous avons constaté que les pentes égales ou inférieures à cinq degré (5°), et reliées directement au lit mineur des cours d’eau, épousaient parfaitement les contours
des repères de crues observées dans l’ensemble du bassin versant. Ces différents constats nous ont permis de reconstituer notre zone à risque d’inondation et de valider notre simulation. Le schéma suivant montre le processus déployé dans le SIG :
Points côtés
Reconstitution du relief (MNT Anudem)
Correction des cuvettes et des dépressions
Calcul des isolignes (3.5m)
Calcul des pentes (en dégré)
Extraction de la zone à risque soumise à la marée
Calculatrice Raster (pente <= à 5°)
Calcul des pentes (en dégré)
Détection de pentes reliées au lit mineur (filtre spatial)
Conversion en couche vectorielle
Conversion en couche
vectorielle
Fusion
Source : Tchameni Franck 2017
Zone à risque d’inondation
125
Figure 34: Approche de délimitation de la zone à risque d’inondation du bassin versant du Tongo-
________________________
Questions Fréquemment Posées
Comment la méthodologie SIG est-elle utilisée pour prévenir les inondations à Douala ?
La méthodologie SIG est utilisée pour l’acquisition, l’analyse et l’automatisation des données géographiques afin de modéliser les facteurs de risque d’inondation dans le bassin versant du Tongo-Bassa.
Quels types de données sont nécessaires pour la reconstitution du relief dans le bassin versant du Tongo-Bassa ?
Les données nécessaires incluent 15000 points côtés obtenus par photogrammétrie et relevés topographiques au sol, qui permettent une reconstitution avancée du relief.
Quels algorithmes sont utilisés dans le processus de délimitation du bassin versant ?
Les algorithmes utilisés incluent la correction des cuvettes et des dépressions, la détection et la restitution des sens d’écoulement des flux, et la délimitation des principaux bassins versants.
