La méthodologie des amnisties en droit révèle des enjeux cruciaux pour la justice internationale. En confrontant les prescriptions pénales aux droits humains, cette étude met en lumière des mécanismes de protection essentiels, transformant notre compréhension des institutions de clémence et leur impact sur les victimes.
Université Catholique d’Afrique Centrale
Institut Catholique de Yaoundé
Faculté de Sciences Sociales et de Gestion
Master Droits de l’Homme et Action Humanitaire
Mémoire présenté et soutenu
Par
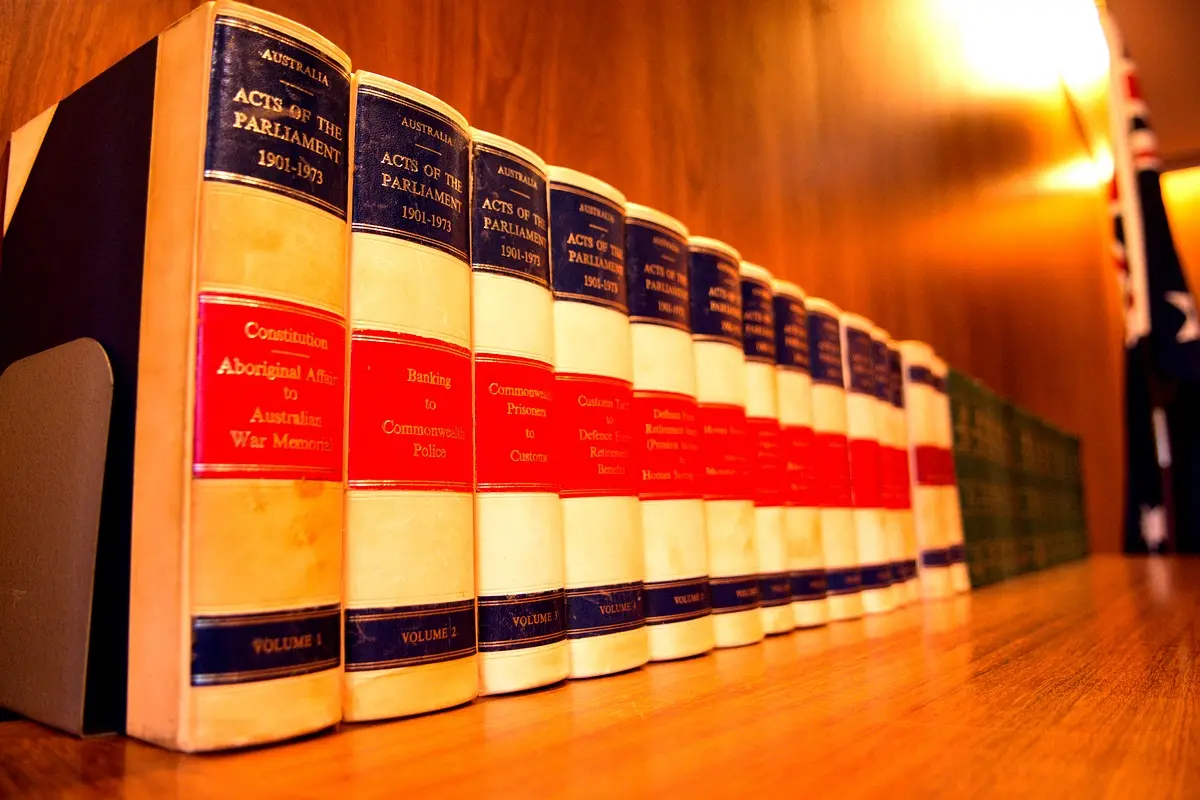
Oumba Bazola Seth Jireh
Sous la direction de :
Docteur Tchibinda Koka Gay Vertu
Chargé de cours à l’Université Catholique d’Afrique Centrale
Sous la supervision de
Professeur Boukongou Jean Didier
Professeur titulaire en droit international à l’Université Catholique d’Afrique Centrale
Année académique :
2020-2021
Résumé
Les amnisties et les prescriptions pénales sont des institutions de clémence qui ont pour origine le droit interne. Fondées sur des principes sociaux, moraux et constitutionnels, leur manifestation ou application dépend du législateur qui, pour une bonne application et un respect des principes démocratiques a besoin du consentement du peuple. Toutefois, ces pratiques sont considérées en DIDH comme des pratiques incitant l’impunité des responsables des violations des droits de l’homme.
C’est dans cette perspective que le DIDH, reconnaissant les amnisties sous certaines conditions, rejette les prescriptions pénales pour promouvoir le principe de l’imprescriptibilité des crimes. En effet, s’agissant des amnisties, la condition de son application en droit interne depuis les conventions de Genève et leurs Protocole (1 et 2) est que les États doivent vérifier que les infractions qui sont amnistiées ne sont pas des crimes internationaux comme le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le génocide.
Un autre crime a également un caractère international depuis la Convention de la Haye, c’est le crime de torture. Dès lors que cette condition est remplie, l’amnistie peut s’appliquer. S’agissant des prescriptions pénales, le DIDH interdit formellement cette pratique et pense qu’aucune autre alternative ne peut être prise pour son application car, favorisant l’imprescriptibilité des peines dont la Convention internationale a été mise en place en 1968.
Toutefois, des fondements et de la reconnaissance des amnisties et des prescriptions, découle des conséquences ou impacts juridiques sur les victimes des droits de l’homme, sur les auteurs mais également sur la société. De tous ces impacts, le DIDH ne retient que ceux relatifs aux violations des droits de l’homme et plus particulièrement des présumés auteurs et des victimes qui, dans un premier temps subissent des affres, mais après ne sont pas réparés.
En effet, les présumés auteurs après le bénéfice de clémence, sont libres et ne sortent aucunement responsables des violations, ce qui n’est pas pour le DIDH normal. Pour les victimes enfin, ces derniers ne reçoivent pas de réparations et voient parfois leurs plaintes rejetées faute de temps, pour les raisons d’oubli de la société.
C’est dans cette perspective que le DIDH a mis en place des mécanismes extra-judiciaires comme la Justice Transitionnelle et les mécanismes juridictionnels comme les Tribunaux pénaux, à l’instar de la CPI.
Mots clés : – Crimes internationaux – Cour pénale internationale – Droit international des droits de l’homme – Reconnaissance – Rejet – Imprescriptibilité – Justice Transitionnelle.
Abstract
Amnesties and penal prescriptions are leniency institutions that originate in domestic law. Founded on social, moral and constitutional principles, their manifestation or application depends on the legislator who, for a good application and respect for democratic principles, needs the consent of the people. However, these practices are considered in IHRL as practices inciting impunity for those responsible for human rights violations.
It is in this perspective that the DIDH, recognizing amnesties under certain conditions, rejects penal prescriptions to promote the principle of the imprescriptibility of crimes. Indeed, with regard to amnesties, the condition for its application in domestic law since the Geneva Conventions and their Protocols (1 and 2) is that States must verify that the offenses which are amnestied are not international crimes such as war crimes, crimes against humanity and genocide.
Another crime also has an international character since the Hague Convention, and that is the crime of torture. As long as this condition is met, the amnesty can apply. With regard to penal prescriptions, the IHRL formally prohibits this practice and believes that no other alternative can be taken for its application because, favoring the imprescriptibility of penalties for which the International Convention was put in place in 1968.
However, some foundations and recognition of amnesties and prescriptions, derives from the consequences or legal impacts on the victims of human rights, on the perpetrators but also on society.
Of all these impacts, the IHRL only retains those relating to human rights violations and more particularly the alleged perpetrators and victims who initially suffer horrors, but are not repaired later. Indeed, the alleged perpetrators after the benefit of leniency, are free and do not take any responsibility for the violations, which is not for the normal IHRL. Finally, for the victims, the latter do not receive reparations and sometimes see their complaints rejected for lack of time, for reasons of oblivion by society. It is in this perspective that the IHRL has set up extra-judicial mechanisms such as Transitional Justice and jurisdictional mechanisms such as Criminal Courts, like the IPC.
Key words :- International Crimes – International Penal Court – International human rights law – Recognition – Rejection – Imprescriptibility – Transitional Justice.
Sommaire
Introduction
Première partie : Fondements et impacts juridiques en droit
International des droits de l’homme
Chapitre I : Fondements juridiques des amnisties et des prescriptions
Pénales
Section I : Les fondements et la manifestation des amnisties et des prescriptions pénales
Section II : La reconnaissance internationale des amnisties et des prescriptions pénales : entre codification (acceptation) et difficultés d’application
Chapitre II : Impacts juridiques des amnisties et des prescriptions
Section I : Les impacts sur les victimes : entre violation et garanti des droits des victimes des violations des DH
Section II : Les impacts sur les présumés auteurs de crimes et la société
Deuxième partie : Les mécanismes de protection des droits des victimes après la mise en œuvre des amnisties et des prescriptions pénales
Chapitre III : Les mécanismes juridictionnels et extra-
juridictionnels
Section I : Les mécanismes juridictionnels
Section II : Les mécanismes extrajudiciaires de protection des droits des victimes : la justice transitionnelle
Chapitre IV : Approche et solutions dans l’administration et la garantie des droits des victimes et des présumés auteurs des crimes
En Afrique
Section I : Solutions relatives à l’administration des amnisties et des prescriptions
Section II : Solutions de garanti des droits des victimes et des présumés auteurs des crimes
Conclusion générale
Bibliographie
Annexes
Table des matières
Introduction
Dans le but de rendre la vie en société plus agréable, les êtres humains ont érigé un certain nombre de règles, regroupées en une discipline appelée « droit ». Ces normes ont pour objectif de règlementer leur vie en délimitant les frontières entre le permis et l’interdit. La violation de ces règles entraîne dans cette perspective des sanctions et ce, en fonction des États, des textes et des infractions commises. Toutefois, le principe de sanctionner les violations des différentes lois peut faire l’objet des dérogations, avec l’application des mesures de clémence comme les amnisties et les prescriptions pénales.
En effet, il est important de préciser que l’amnistie et la prescription pénale qui font l’objet de notre étude, sont des mesures qui s’appliquent originellement au niveau national en vertu d’une loi votée. Ces deux mesures d’atténuation ont pour finalité d’oublier les fautes commises dans le but de faciliter l’instauration de la paix et de favoriser l’unité nationale.
Mais si l’amnistie et la prescription pénale permettent d’oublier les fautes au nom de la recherche de la paix et de la consolidation de l’unité nationale, celles-ci ne remettent-elles pas en cause la question de la lutte contre l’impunité, chère au droit international ? En d’autres termes, l’amnistie et la prescription pénale sont-elles compatibles avec le droit international des droits de l’homme ?
C’est cette idée générale qui gouverne notre travail de recherche, qu’il convient de présenter dans un contexte précis.
Le cadre théorique
A- Contexte de la recherche
La présente réflexion est menée suivant le contexte juridique (1) et politique (2).
Le contexte juridique
Depuis la deuxième guerre mondiale, le monde a été marqué par plusieurs autres conflits armés tant nationaux qu’internationaux, mais ayant tous un caractère international au vu de l’ampleur des crimes commis. Depuis l’humanité s’est engagée dans le respect de la dignité humaine et la lutte contre l’impunité. À cet effet, des mécanismes juridiques ont été mis en place au niveau international.
Parmi ces mécanismes, il y a des textes et des institutions, auxquels s’ajoute la jurisprudence. Relativement aux textes, il peut être cité la Charte des Nations Unies1, la Déclaration universelle des droits de l’homme2, les pactes internationaux de 1966, le Statut de Rome dont la finalité principale est de protéger la dignité humaine et de lutter contre l’impunité mais aussi des textes régionaux.
En effet, la convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre consacre le principe de la prescription lorsqu’elle interdit en son article premier, les États membres de recourir à la prescription3. Cette position marque une évolution du droit pénal international pour qui, la prescription n’est plus un principe, mais plutôt l’imprescriptibilité des crimes internationaux.
L’amnistie pour sa part, a connu peu d’évolution sur le plan du DIP puisque ce dernier fait toujours l’objet de contradictions au niveau international. Depuis le traité d’Osnabrück du 24 octobre 1648 qui prévoit en son article 2 « [q]u’il y ait de part et d’autre un oubli et une amnistie perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles en quelque lieu ou en quelque manière que les hostilités aient été exercées par l’une ou l’autre partie », jusqu’à nos jours, les textes internationaux donnent la possibilité d’appliquer des amnisties, comme c’est le cas avec le Pacte additionnel II à la convention de Genève de 1949.
Quant aux institutions, leur paysage est tout aussi riche. Nous notons des institutions de la Charte de l’ONU et celles relevant des traités qui visent aussi la protection de l’homme. Nous sommes également passés des juridictions pénales ad hoc, telles que le Tribunal Militaire de Nuremberg et de Tokyo, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Tribunal pénal international de l’ex Yougoslavie … à une juridiction permanente appelée Cour pénale internationale4, témoignant de la volonté de la communauté internationale à lutter contre les crimes odieux.
Ce passage des tribunaux ad hoc à un tribunal international a permis de rendre universelle la consécration des amnisties et des prescriptions pénales, tout en interdisant leur application pour des crimes à caractère international. En effet, si le Tribunal de Nuremberg et le TPY ont pour principe l’imprescriptibilité des crimes, la pratique de la prescription et des amnisties continuait à exister sous d’autres cieux, d’où l’importance de la mise en place de la CPI.
En dehors des mécanismes internationaux, les États sont encouragés à développer une culture de protection des droits de l’homme et de lutte contre l’impunité en insérant dans leur législation des dispositions y afférentes. Mais malgré cette multitude de mécanismes juridiques tant internes qu’internationaux, les États arrivent à mettre en place des lois d’amnistie et de prescription pénale afin que certains auteurs des crimes graves soient pardonnés au nom de la paix ou de l’unité nationale. Ce qui aujourd’hui soulève le problème de la pertinence des institutions de clémence dans la protection des droits de l’homme, surtout à l’heure où l’humanité s’engage dans la lutte contre l’impunité.
Contexte socio-politique
Le continent africain fait depuis plusieurs années face à une instabilité politique qui crée des tensions au sein des communautés. Ces tensions communautaires engendrent les maux tels que le terrorisme, les soulèvements au sein des populations et le tribalisme. Ce fut le cas au Rwanda en 1994, et plus récemment en Côte d’Ivoire en 2010, au Mali et en République Centrafricaine en 2012, pour ne citer que ces exemples.
Pendant ces conflits, on dénombre plusieurs crimes de génocides, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerres, conformément aux statuts des juridictions internationales comme la Cour pénale internationale. On note également des actes de viols, de destructions de biens civils et les exécutions sommaires. Ces actes témoignent d’une violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme plus précisément.
Les instabilités politiques qui sont pour la plupart des temps dues à la mauvaise gouvernance et à la durée des présidents au pouvoir, ont une répercussion sur la vie sociale dont les conséquences sont la pauvreté et le manque d’éducation des jeunes, ce qui favorise la montée des violences et des crimes internationaux. Après la commission de ces crimes, il est toutefois important pour les gouvernants de mettre en place des mesures permettant de remettre la paix et la sécurité, comme les amnisties et les prescriptions pénales.
Afin de rendre cette réflexion faisable, il convient de circonscrire l’objet de notre recherche.
________________________
1 Encore appelé Charte de San Francisco, signée à San Francisco le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945. ↑
2 Adoptée à Paris le 10 décembre 1948. ↑
3 Convention européenne de lutte contre l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, art premier : « Tout État contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions… » ↑
4 Créée le 17 Juillet 1998 et ayant son siège à La Haye (Pays-Bas). ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les conditions d’application des amnisties en droit international des droits de l’homme ?
Les États doivent vérifier que les infractions qui sont amnistiées ne sont pas des crimes internationaux comme le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le génocide.
Pourquoi le droit international des droits de l’homme rejette-t-il les prescriptions pénales ?
Le droit international des droits de l’homme rejette les prescriptions pénales pour promouvoir le principe de l’imprescriptibilité des crimes.
Quels sont les impacts juridiques des amnisties sur les victimes des droits de l’homme ?
Les victimes ne reçoivent pas de réparations et voient parfois leurs plaintes rejetées faute de temps, pour les raisons d’oubli de la société.