La méthodologie de l’autofiction révèle des dimensions inattendues dans ‘Les désorientés’ d’Amin Maalouf, où l’hybridité entre autobiographie et fiction remet en question les conventions littéraires. Cette étude critique offre des perspectives nouvelles sur la légitimité de ce genre, essentielle pour comprendre son impact contemporain.
Université-Batna2
Faculté des Lettres et des Langues Étrangères Département de Langue et Littérature Françaises
Diplôme de Master Option : Sciences des Textes Littéraires
Présentation de projet
Périple autofictionnel dans Les désorientés d’Amin Maalouf
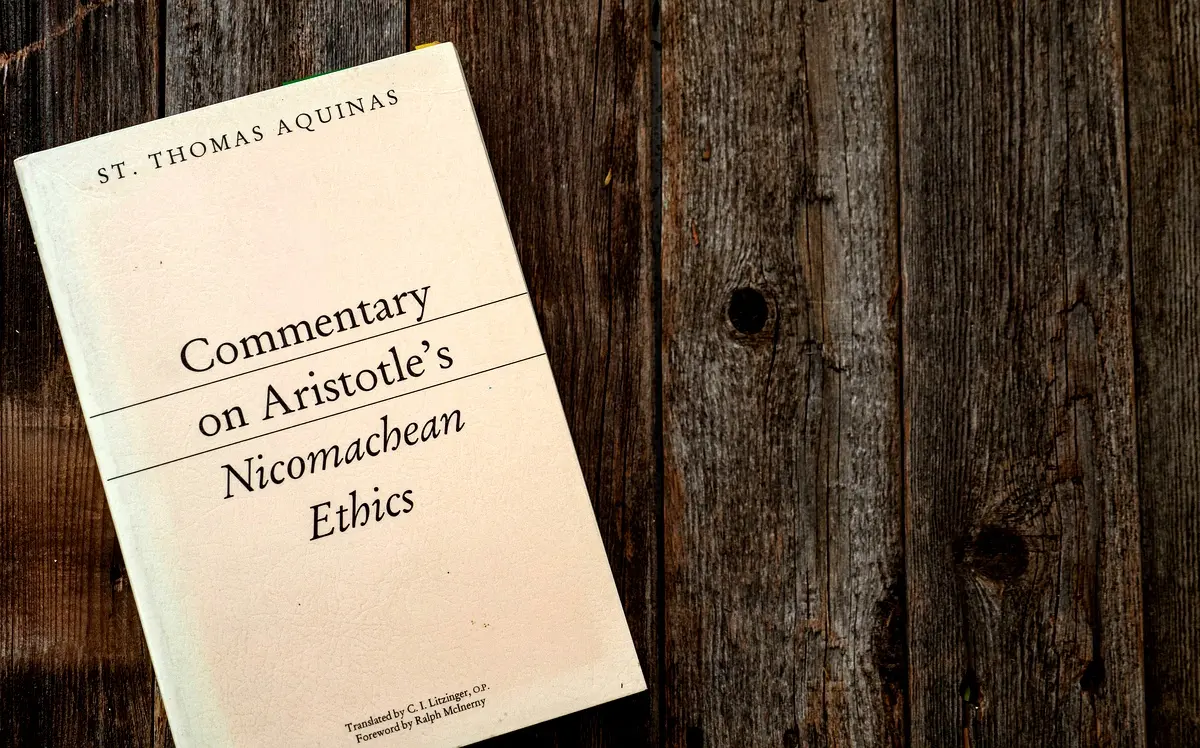
M. Mebarki Houssem Eddine
Supervisé par : Mme. Djebarri Souhila
Année universitaire 2016-2017
Depuis son apparition sous la plume de Serge Doubrovsky, l’autofiction tente par divers moyens de s’incruster et s’imposer au devant la scène littéraire occidentale. Une mission qui s’avère et se révèle délicate, puisque l’autobiographie a acquis une présence critique notable en grande partie grâce aux travaux novateurs de Philippe Lejeune.
Au tout premier instant, l’autofiction endure d’un double problème : elle s’affiche en premier lieu sur le sol américain d’Amérique, éloigné du bouillonnement intellectuel dont jouissait la critique française en ce temps là, ensuite elle se dévoile immédiatement comme une écriture hybride associant simultanément la rédaction « factuelle » (auto) et « fictionnelle » (fiction).
Ces deux composantes vont jouer contre ses intérêts et elle sera longtemps ignorée de la critique française. Malgré cela, Serge Doubrovsky n’arrêtera pas d’assurer la publicité de son néologisme dans sa correspondance avec différents théoriciens et les passionnés de la littérature, dans les conférences et les séminaires auxquels il prendra part, les entretiens qu’il accordera aux critiques littéraires de même qu’aux journalistes, ou même dans les émissions radiophoniques et télévisées où il sera l’invité d’honneur.
Plus qu’une opération de promotion et de marketing, l’écrivain et critique français va tenter d’imposer son concept dans le champ littéraire en espérant le voir un jour approuvé par ses pairs et admis pour le considérer enfin comme genre à part entière. Pour ce faire, il accepte parfois de faire d’importantes concessions théoriques tout en gardant sa ligne directrice : l’autofiction joue sur deux tableaux à la fois, autobiographique et fictionnel. « Les humbles qui n’ont pas droit à l’histoire, ont droit au roman. »1
Souffrant d’une définition concise mais peu claire, l’autofiction, ou du moins sa « théorisation », n’a jamais cessé d’évoluer au fil du temps grâce à de vifs échanges et débats littéraires qui opposeront son créateur aux autres spécialistes de la littérature. Ces échanges, parfois interdisciplinaires, vont jouer un rôle prépondérant dans le devenir de ce néologisme. Ils vont en effet le faire sortir de sa « clandestinité » et le propulser au-devant de la scène littéraire, publique et médiatique. Cependant, grâce à ces débats théoriques, ce nouveau concept va acquérir un statut et une légitimité et devenir un sujet de réflexion pour des romanciers, des critiques littéraires et des poéticiens ainsi qu’à des futurs chercheurs universitaires.
1 Serge Doubrovsky, Autobiographie/Vérité/Psychanalyse, 1980, p. 90.
Philipe Vilain considère l’autofiction comme victime de son succès, il désigne tout et son contraire, sans respect pour la définition inaugurale de Doubrovsky. Le flou qui entourait la définition a conduit des théoriciens du genre à la repréciser, distinguant l’« autofiction référentielle » de l’« autofiction fictive », une « théorisation restreinte » d’une « théorie étendue ».
Considérée comme une variante postmoderne de l’autobiographie, plusieurs appellations et nominations à l’instar, d’écriture exhibitionniste, littérature de caméscope, sous-genre, orgie d’égo et de complaisance, pseudo genre littéraire, genre narcissique, démocratisation de la littérature, cogito littéraire, mythomanie, invention et fabulation de soi, beautés propres, égo-littérature, perspective prometteuse, autobiographie honteuse, mauvais genre, dévoilement de plaisirs littéraires, émergence, d’une logique méconnue et d’émotions inédites.
Les expressions employées pour parler, décrire et critiquer l’autofiction sont nombreuses et vont dans tous les sens. Un genre pour certains, un sous-genre pour d’autres, l’autofiction se trouve au milieu des débats animés et passionnés, une catégorie louange le genre, tandis qu’une autre le dénigre.
Un concept ambigu, l’autofiction pousse à explorer ses traces historiques, ses particularités, ses possibilités et ses limites. Le néologisme se trouve sur la ligne de mire de ses détracteurs refusant catégoriquement de la qualifier de « genre littéraire » à part entière.
Le genre est souvent mal défini, mal compris et mal reçu. L’autofiction ressemble présentement à un immense fourre-tout dans lequel sont inclus la plupart des écrits en prose qui contiennent un minimum d’éléments biographiques de l’auteur, ses bases n’étant pas encore posées et codifiées.
De ces questionnements entourant l’existence de l’autofiction et de cette absence de codification du genre, découle une classification ambiguë de la part des éditeurs et un effet pervers dont les victimes sont les lecteurs. Comment classer ces livres ? L’appellation « autofiction » se retrouve rarement sur le livre même. Les libraires qui consacrent une section complète au genre sont rarissimes, malgré l’éclosion du genre. Il reste donc deux possibilités aux vendeurs : la section « romans » ou la section « biographies », qui incluent habituellement à la fois les biographies et les autobiographies.
Comme les éditeurs choisissent majoritairement l’appellation « roman », qu’ils apposent sur la couverture des livres, les libraires emboîtent le pas et les classent ainsi. Plus souvent qu’autrement, les récits autofictifs sont donc achetés et lus comme des romans. Bien que les auteurs avouent haut et fort que leurs textes sont inspirés en quasi-totalité de leur vie, les autofictions ne se retrouvent pas parmi les autobiographies. Cette réalité s’explique d’abord par le fait que les auteurs admettent aussi qu’il y a une part fictive dans le récit, ce qui va à l’encontre d’une des caractéristiques principales du pacte autobiographique : la fidélité entre la vie du narrateur et celle de l’auteur.
Et cette appellation de « roman » se trouve sur la couverture dans notre corpus étudié « Les désorientés », et l’auteur affirme qu’il y a une part de fictivité donc absence du « pacte autobiographique ».
« Cette tranche de vie est inspirée d’événements réels et d’un pays réel, mais elle reste imaginaire pour l’essentiel. »2
Les lecteurs d’autobiographies se plaisent souvent à trouver des failles dans ces livres, puisque le genre autobiographique est synonyme de rigueur et d’exactitude au sein de la population. Les auteurs d’autofictions leur enlèvent ce plaisir et ce privilège : ils admettent d’emblée que certains faits, certains détails, certains personnages comportent des différences avec la réalité.
« Dans les désorientés, je m’inspire très librement de ma propre jeunesse. Je l’ai passée avec des amis qui croyaient en un monde meilleur. Et même si aucun des personnages de ce livre ne correspond à une personne réelle, aucun n’est entièrement imaginaire. J’ai puisé dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes souvenirs. Les protagonistes du roman avaient été inséparables dans leur jeunesse, puis ils s’étaient dispersés, brouillés, perdus de vue. Ils se trouvent à l’occasion de la mort de l’un d’eux. Les uns n’ont jamais voulu quitter leur pays natal, d’autres ont émigré vers les États-Unis, le Brésil ou la France. Et les voies qu’ils ont suivies les ont menés dans les directions les plus diverses. »3
2 Georgia Makhlouf, Entretien, Amin Maalouf et l’Académie au Liban, Le 11 janvier 2013. http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=31&nid=4370 (consulté le 13 avril 2017.)
3 Maalouf Amin, Les désorientés, 2012, quatrième de couverture.
Nous avons choisi d’étudier le roman “Les désorientés” d’Amin Maalouf pour diverses raisons :
Primo, la notoriété de l’auteur, ainsi parce que la sortie du roman coïncidait avec son élection à l’académie française, en sus ce fut le premier roman qui nous a fait découvrir l’écriture maaloufienne.
Secundo, la lecture de ce roman nous a ouvert d’autres horizons et d’autres perspectives. Le roman véhicule beaucoup de thématiques sensibles et traite beaucoup de sujets d’actualité à l’instar : du conflit israélo-arabe, affrontement des civilisations, la querelle entre l’Orient et l’Occident. Le plus intriguant pour nous c’était l’enchevêtrement de ces faits historiques avec le parcours personnel d’Amin Maalouf, ce qui nous a mené, inexorablement à s’interroger sur la nature de ce récit.
Après une minutieuse lecture du roman, nous avons fixé l’objectif suivant :
– Démontrer que l’œuvre « Les désorientés » ne miroite pas de la pure réalité, or l’auteur raconte sa vie mais sous forme romancée donc il mêle la fiction avec la réalité.
L’intérêt porté à l’œuvre et aux stratégies scripturales adoptées par son créateur, aiguise notre curiosité et nous oriente vers la problématique suivante :
– Quels sont les paramètres qui nous permettent d’effectuer une lecture autofictionnelle des « désorientés » d’Amine Maalouf ?
Autrement dit :
– La lecture approfondie des « désorientés » d’Amine Maalouf permettrait-elle de débusquer des indices autofictionnels afin de mieux saisir les passerelles entre le héros et son créateur ?
Pour répondre à notre problématique, nous émettons l’hypothèse suivante :
Les éléments biographiques et les éléments paratextuels (titre, indication générique, quatrième couverture et entretien) s’avéreraient cruciaux dans la détermination de la catégorie générique à laquelle appartient l’œuvre, à savoir l’autofiction.
Ces éléments épitextuels et péritextuels ainsi que les éléments biographiques qui présentent de multiples ressemblances avec l’auteur, nous laissent dire que cette œuvre est une autofiction.
Nous optons pour la méthode analytique et descriptive, pour notre corpus nous choisissons une approche autofictionnelle. Pour cela, nous avons convoqué pour cela les travaux de : Serge Doubrovsky, ceux de Vincent Colonna et ceux de Gérard Genette. Ainsi, nous nous référons à l’étude analytique des autobiographies initiée par Philippe Lejeune étant donné que toute œuvre autofictionnelle comporte des éléments autobiographiques.
Pour traiter notre sujet de recherche, nous avons jugé utile de diviser notre travail en trois chapitres :
Le premier chapitre intitulé : Amin Maalouf approche biographique, est réservé à la présentation de l’auteur ainsi qu’à son parcours et itinéraire professionnel jusqu’à son élection à l’académie française, et en clôturant ce chapitre par le résumé de l’œuvre qui est l’objet de notre recherche intitulé « Les désorientés ».
Le deuxième chapitre intitulé prolégomènes théoriques portera sur le genre autobiographique puisqu’il est considéré comme la mère nourricière de l’autofiction ainsi que le pacte autobiographique scellé par Philippe Lejeune. Ainsi, nous aborderons la naissance du néologisme autofiction, et de même nous tenterons de cerner les différentes acceptions et les définitions du mot autofiction tout en mettant en exergue les grandes théories du genre.
Dans le troisième chapitre intitulé : l’autofiction dans Les désorientés d’Amin Maalouf, nous nous sommes appuyés sur les études épitextuelles et péritextuelles pour démontrer dans quelle catégorie on peut classer et situer le récit « Les désorientés » pour certifier qu’on peut le classer dans la catégorie des autofictions et non seulement dans la simple catégorie des romans comme l’indique la couverture du livre. Après, on passe par les deux principales composantes de l’autofiction : la quête identitaire, cette recherche identitaire qui a mené Amin Maalouf vers la fictionnalisation de soi, l’autre caractéristique du processus autofictionnel dans la mesure où l’auteur fabule sa propre existence et se projette en des personnages imaginaires.
Ensuite, nous tenterons de clarifier et expliciter la relation entre Amin Maalouf et son œuvre. Pour cela, nous nous sommes référés à la biographie de l’auteur afin de dégager les ressemblances et les similitudes entre sa vie et celle de son personnage principal en se basant sur son itinéraire personnel, familial et professionnel. Nous clôturons ce chapitre par un exercice démonstratif ayant pour but de révéler le fait qu’Amin Maalouf situe son œuvre entre le référentiel et le fictionnel.
Nous terminerons notre travail de recherche par une conclusion, résumant les résultats obtenus lors de la réalisation de cette modeste recherche.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que l’autofiction selon Serge Doubrovsky?
L’autofiction est une écriture hybride associant simultanément la rédaction « factuelle » (auto) et « fictionnelle » (fiction).
Comment Amin Maalouf utilise-t-il l’autofiction dans ‘Les désorientés’?
Maalouf utilise sa propre expérience de jeunesse tout en intégrant une part de fictivité, remettant en question le pacte autobiographique traditionnel.
Quels sont les débats théoriques entourant l’autofiction?
Les débats théoriques opposent le créateur de l’autofiction, Serge Doubrovsky, à d’autres spécialistes de la littérature, cherchant à clarifier sa définition et à lui donner une légitimité dans le champ littéraire.