La méthodologie d’analyse sémantique révèle des dynamiques inattendues dans les discours de Jean-Bertrand Aristide, soulignant des contradictions entre le langage officiel et la réalité haïtienne. Cette étude critique offre des perspectives essentielles sur la crise politique contemporaine et le processus de démocratisation en Haïti.
La langue créole
Indépendant en 1804, l’acte d’indépendance fut rédigé et prononcé en français. La langue du colonisateur fut utilisée comme langue officielle de la nouvelle République. Or le français n’est la langue usuelle que d’une faible minorité, à savoir ; les mulâtres, ceux qui avaient fait des études dans la métropole et quelques noirs instruits. Ainsi, la proportion d’Haïtiens capables de s’exprimer couramment et de comprendre parfaitement la langue officielle de leur pays est très faible.
La non-connaissance du français exclut une grande partie de la population de certaines activités sociales, économiques et politiques. De ce fait, l’acquisition du français représente pour un élément de la classe populaire une étape essentielle de la promotion sociale. Parler français devient synonyme de connaissances, de raffinement et de distinction sociale. Malgré cela, le créole s’est imposé comme langue maternelle de la population. Déprécié, ostracisé, il faut attendre près de deux siècles après l’indépendance (1987)80, dans une constitution écrite en français pour que le créole, la langue parlée par la totalité des Haïtiens soit une langue officielle. Et c’est en 197981 que le créole fasse une entrée timide à l’école haïtienne.
Il en résulte en Haïti entre les deux langues une profonde ambivalence, décrite fort justement par Maximilien Laroche :
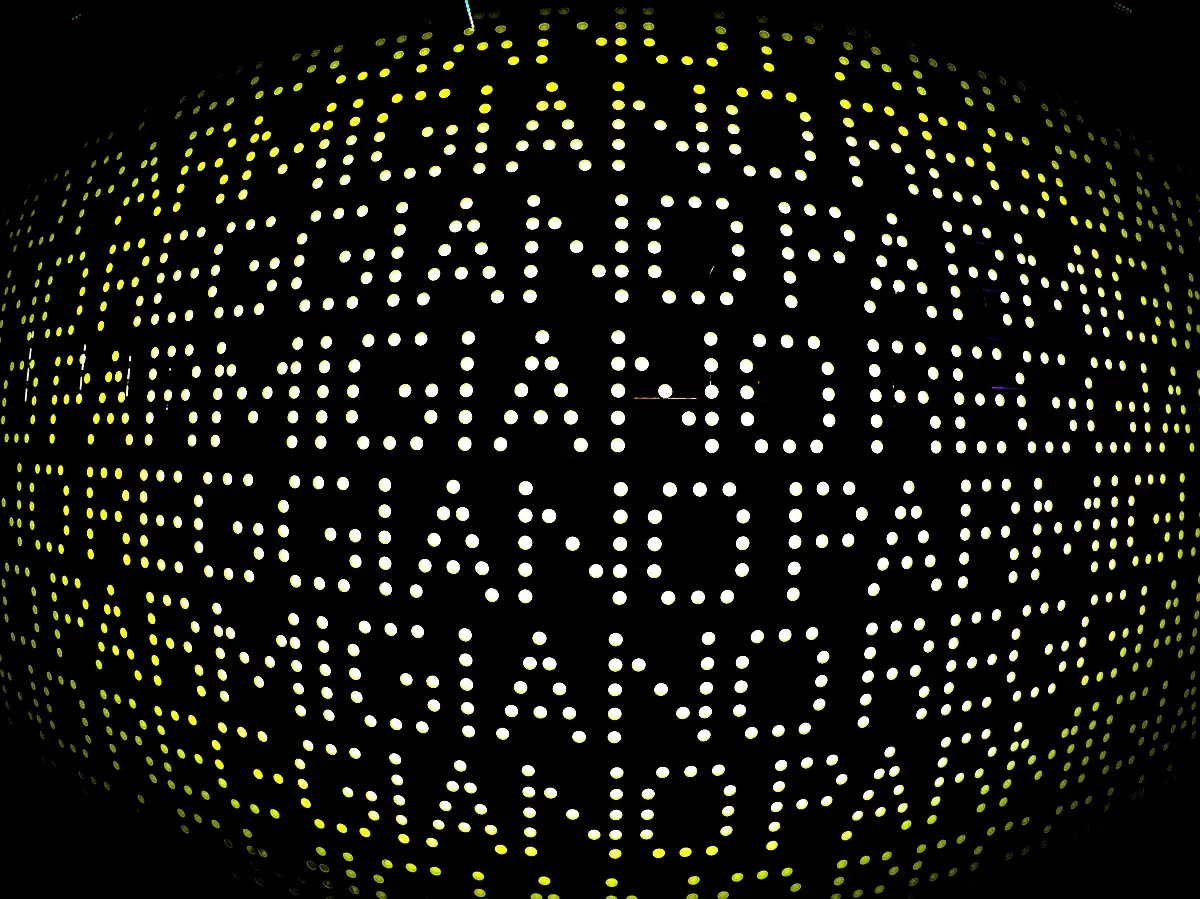
« Si donc l’haïtien est ainsi tiraillé entre son être [le créole] et son désir de paraître [le français], c’est qu’au plus intime de lui-même sa vie repose sur une opposition inconciliée que l’on peut résumer dans le dualisme: vodou -catholicisme, français- créole. Il est déchiré par un malentendu perpétuel et ce conflit est aggravé du fait que si les éléments d’opposition sont d’ordre culturel, ainsi qu’il apparaît à première vue, par leurs implications économiques et sociales ils ont une portée beaucoup plus vaste et en fait se répercutent sur l’ensemble de la vie82 »
Si l’élite haïtienne est bilingue, la totalité de la population est créolophone. De ce côté, il est préférable de parler de diglossie pour caractériser la situation linguistique du pays à la place de bilinguisme. Est diglossie toute communauté dans laquelle deux (ou plus de deux) langues se partagent les domaines d’emploi.
L’une est dominante et considérée plus propre à assumer les fonctions administratives, éducatives et littéraires. L’autre est réservée aux fonctions de la vie courante. Pour l’Haïtien bilingue, qui appartient du fait même de son bilinguisme à une élite privilégiée, chacune des deux langues recouvre un domaine bien défini. Par exemple, s’il emploie le français pour la conversation soignée avec ses pairs ou en présence d’un étranger, il aura recours à la vernaculaire dès qu’il voudra indiquer une certaine familiarité dans ses rapports avec son interlocuteur ou faire résonner une corde affective.
80 Article 213 de la constitution de 1987 « fixer la langue et permettre son développement harmonieux et
scientifique ».
81 Le créole est introduit dans l’éducation nationale haïtienne par une loi votée le 18 décembre 1979.
Bentolila Alain, Gani Léon. Langues et problèmes d’éducation en Haïti. In: Langages, 15e année, n°61, 1981.
Bilinguisme et diglossie. pp. 117-127.
82 M. Laroche, L’Haitien (Montreal: Editions de Sainte-Marie, 1968)
L’ usage politique de la langue créole
Traiter la langue créole comme moyen de participation politique par le bas est étroitement lié aux logiques d’appropriation politique de la démocratie en Haïti. Autant le répertoire religieux est porteur de significations politiques, autant la sémantique, les énonciations discursives des groupes dominés ancrées dans la réalité sociale peuvent être étudiées comme des formes de réinvention de l’État, de construction de stratégies contestant l’État ou amplifiant le champ étatique.
Ainsi, la démocratisation est posée en termes de relations des locuteurs avec la langue créole et les concepts, les mots, les expressions acquièrent le stade d’objet à interpréter au regard de leurs « représentations dans l’imaginaire populaire » à travers des associations, des organisations, des discours qui donnent un sens différent aux mots et concepts tels qu’ils sont énoncés, dénoncés, retravaillés par les gens ordinaires.
Notre analyse se situe dans la période post-duvaliériste, soit après 1986. Cette période est marquée par les difficultés de la société haïtienne à réussir la greffe de la démocratie occidentale. Dans cette phase, la démocratie est réappropriée, prise dans un sens différent. D’abord, elle ne s’exprime pas seulement à travers l’occupation physique des lieux, mais encore par la mobilisation du répertoire linguistique, à l’initiative des divers acteurs sociaux qui ont été marginalisés à travers les dispositifs de contrôle social.
Ensuite, sur l’arène politique, la langue utilisée par les acteurs subordonnés est le créole. Outil de contestation du régime de Duvalier. Le créole a été l’accompagnateur de proximité utilisé par la presse locale qui souvent prend le risque d’informer les citoyens des exactions, des dérives du régime, des violations des droits humains, ainsi s’ouvrant à une réappropriation politique.
Pourtant, le créole a une fonction discriminante, c’est un marqueur identitaire, son usage est réservé aux paysans, aux masses populaires, aux analphabètes, aux marginalisés. Tandis que les « élites », les individus issus de familles riches s’expriment en français. Ce clivage linguistique prolonge les pratiques qui renvoient à l’histoire de la société postcoloniale.
Puisqu’au « lendemain de l’indépendance un double système socio-culturel émerge : celui des classes dominantes qui adoptera le modèle culturel européen au mépris des références africaines et celui des masses paysannes qui restent attachées aux valeurs culturelles africaines83 ». Donc, le champ linguistique est un champ de pouvoir, de luttes, de stratégies.
S’y opposent une langue dominante et une langue dominée. Cette opposition est le lieu de production d’une conflictualité qui renvoie aux clivages internes qui caractérisent la société haïtienne : riches/pauvres, villes/campagnes, citadins/paysans, vodouïsant/catholique. À partir de 1986, les acteurs sociaux font du créole un outil de libération et d’intégration politique. Ainsi, un nouveau champ de pouvoir se constitue par le rejet de la langue française considérée comme une langue étrangère, donc langue d’exclusion sociale.
Dès lors, l’usage du créole jouit d’une popularité incontournable auprès des masses qui y ont recours comme langue de contestation, d’affirmation, et de résistance à la politique. La constitutionnalisation du créole est révélatrice de la profondeur du malaise, l’inscription du créole à l’Article 5 de la constitution de 1987 comme langue officielle à l’égal du français et sa reconnaissance préalable comme lieu commun unique entre tous les haïtiens, rétablissent la langue populaire dans ses droits historiques.
» En voici un témoignage : Robert Malval fut un ancien premier ministre de Jean-Bertrand Aristide, alors en exil, renversé par l’armée. M. Malval rapporte que le 30 Septembre 1991 des fils et des filles de « grandes familles » dévalant les collines au volant de leurs pajeros et criant « le créole, c’est fini 84 ».
Sociologues, anthropologues, observateurs soulignent le caractère polarisant de la société haïtienne. Il y aurait un univers urbain caractérisé par un système de valeurs inspirées de l’Occident et un univers rural : d’un côté, « le système éducatif calqué sur l’Europe, la langue française comme langue de civilisation ; de l’autre, la religion vaudou, la langue créole, système de « lakou, » le « kombit, » le « plaçage » …plus tourné vers l’Afrique. » Le choix d’une langue, les difficultés de s’en approprier sont considérées comme des facteurs de cohésion ou d’exclusion sociale.
Dans ce cadre, l’accès à la citoyenneté prend de contrepied des intellectuels haïtiens. Décrit par Frankétienne dans sa pièce de théâtre « pèlintet », l’intellectuel haïtien n’est d’abord ni à gauche, ni à droite. Il est essentiellement un comédien. Un prestidigitateur. L’homme de la rhétorique, de la magie de belles phrases. La responsabilité dans le désastre et la déchéance d’Haïti réside non pas dans les mensonges ou les demi-vérités qu’il profère, mais dès le départ,
« dans ses analyses logico- grammaticales », c’est-à-dire dans ses performances dans la langue française85 ». Ainsi, la figure de l’intellectuel, dans l’imaginaire haïtien, est en connivence avec le pouvoir, parce qu’il aspire à occuper un poste avec le pouvoir, parce qu’il aspire à occuper un poste ministériel, ou celui de président de la république. Il a donc distance entre la classe moyenne instruite et la paysannerie haïtienne. Ainsi, Jean-Bertrand Aristide est l’un des acteurs politiques qui s’approprie avec le plus de facilité et efficacité cette « polarisation linguistique » dans ses discours et cela avec agressivité.
84 MALVAL, Robert. L’année de toutes les duperies CIDIHCA, op.cit., p. 129.
85 HURBON, Laënnec. Comprendre Haïti, p. 42 – 43.
________________________
80 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
81 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
82 M. Laroche, L’Haitien (Montreal: Editions de Sainte-Marie, 1968). ↑
83 JOINT, Louis Auguste. Le système éducatif haïtien, op.cit., p. 395. ↑
84 MALVAL, Robert. L’année de toutes les duperies CIDIHCA, op.cit., p. 129. ↑
85 HURBON, Laënnec. Comprendre Haïti, p. 42 – 43. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la situation linguistique en Haïti entre le créole et le français?
La situation linguistique en Haïti est caractérisée par une diglossie, où le français est dominant pour les fonctions administratives et éducatives, tandis que le créole est utilisé dans la vie courante par la totalité de la population.
Comment la langue créole est-elle utilisée dans le contexte politique haïtien?
La langue créole est traitée comme un moyen de participation politique par le bas, et les énonciations discursives des groupes dominés peuvent être étudiées comme des formes de réinvention de l’État et de contestation.
Pourquoi le créole a-t-il été reconnu comme langue officielle en Haïti?
Le créole a été reconnu comme langue officielle en 1987 dans une constitution écrite en français, après avoir été longtemps déprécié et ostracisé, ce qui a permis de valoriser la langue parlée par la totalité des Haïtiens.