Les meilleures pratiques de gouvernance urbaine révèlent des inégalités frappantes à Kindu, où l’expansion démographique dépasse les infrastructures. Cette recherche propose une approche décentralisée innovante, essentielle pour transformer la dynamique spatiale et garantir un accès équitable aux services pour tous les habitants.
La gestion spatiale actualisée et équitable
La notion d’équité territoriale fait référence à la dimension spatiale de la justice sociale. « Elle désigne une configuration géographique qui assurerait à tous les territoires et à leurs habitants les mêmes conditions d’accès aux services publics et privés, au logement, à l’emploi, à la vie sociale » (Langevin, 2013).
Un des chapitres de ce travail a largement démontré l’inégale répartition des équipements d’encadrement urbain à Kindu. Il a été prouvé que l’actuelle répartition pourrait faire l’objet de frustration et tensions sociales.
La matérialisation de l’équité spatiale dans la ville de Kindu passe par l’identification des objectifs à atteindre ou points repères qu’il faut standardiser en matière de gouvernance.
Il s’agit ici du niveau d’accès aux différents services publics privés de la ville et de l’accessibilité aux nouveaux et anciens quartiers. D’où il est plus que nécessaire d’effectuer un zonage sur le territoire urbain et y définir une zonation calquée de manière ci-après : zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine, zones franches, zones de développement prioritaire… C’est seulement après cette zonation que l’action locale à mener sera identifiée et envisagée.
En définitive, la notion d’équité spatiale fait recourt à une redistribution pour lequel l’équité repose d’après la théorie de John Rawls (1997) cité par Langevin (2013) sur deux principes :
- Le principe de différence : les inégalités constatées dans une société ne sont acceptables que si elles contribuent à l’augmentation du bien-être collectif ;
- Le principe de réparation : une société équitable doit accorder davantage d’attention aux personnes et aux zones démunis qu’à l’ensemble de la population ou du territoire.
La question qui, cependant, reste en suspens, c’est la participation du privé dans l’équité spatiale. Dans la plupart des cas, le privé est attiré par le bénéfice et non par l’équité sociale. D’où son intervention très souvent dans les zones à forte concentration d’équipements et de population.
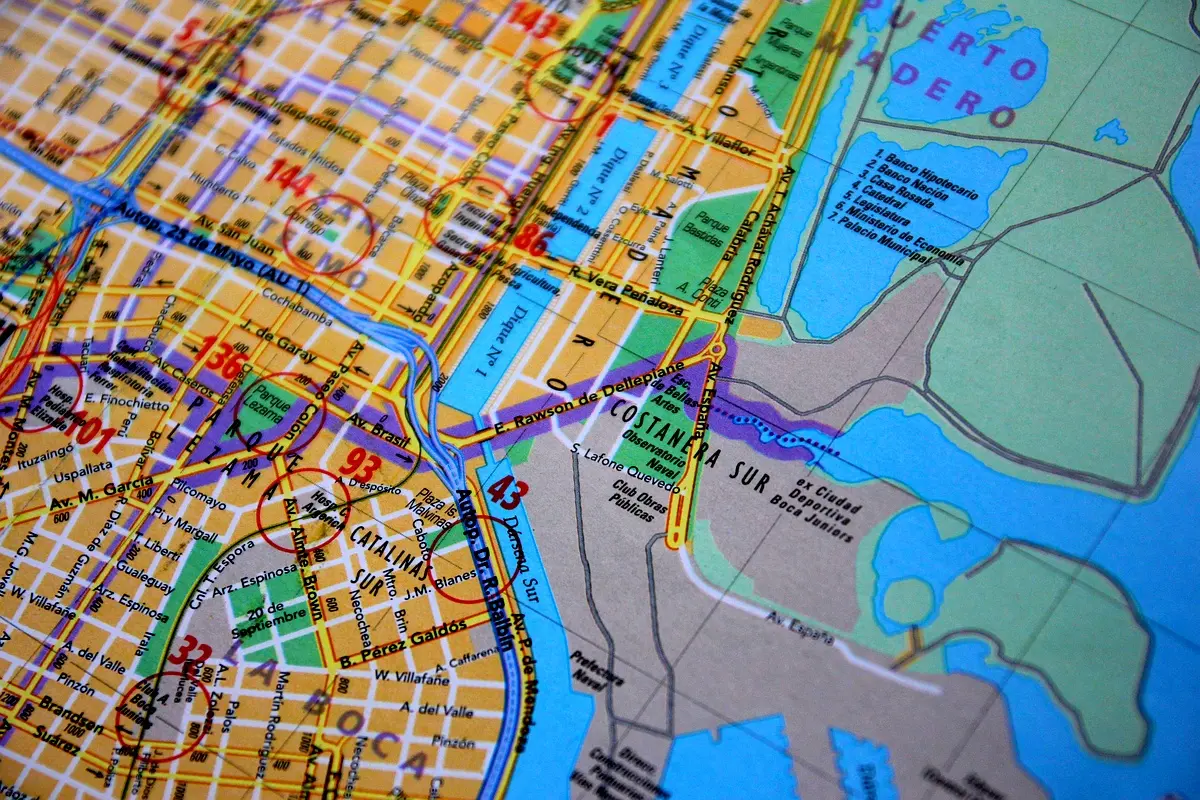
Pour rendre pratique la notion d’équité spatiale, nous proposons une nouvelle zonation d’influence des futures infrastructures ou équipements de base d’encadrement urbain au départ de l’exemple des infrastructures hospitalières.
Le Nord et le Nord-Ouest sont les directions qui ont grignoté plus de l’espace des localités voisines à la rive gauche de la ville de Kindu, et cela que ça soit en terme de bâti ou en terme de la dégradation de la forêt.
A la rive droite par contre, c’est la direction Nord et la direction Sud qui sont privilégiées par le mitage ou exurbanisation.
Deux faits expliquent ce phénomène. Il s’agit :
Premièrement, de la présence des voies de communication qui attirent des populations. Il semble aussi que les migrants s’installent le plus souvent le long des voies de leurs provenances.
Deuxièmement, de la promotion et l’implantation des grandes infrastructures par les programme cinq chantiers et révolution de la modernité. C’est le cas du stade Joseph Kabila, de la modernisation de l’aéroport de Kindu et de l’université de Kindu au Nord, du boc 100 maisons à l’Ouest …
Ces sites ont été envahis au point où leur pourtour ont connu un saucissonnement à des prix élevés entre (5 000 et 10 000$) par terrain. C’est le cas des abords de l’aéroport qui fut lotis construits puis démolis et aujourd’hui classé non aedificandi.
Ainsi donc ayant proposé un découpage (voir annexe), nous avons pensé qu’il fallait réfléchir sur l’implantation des équipements de base pour une gestion équitable et équilibrée de la ville. Ce qui non seulement éviterait des frustrations pour des espaces moins équipés, mais stabiliserait et créerait une harmonie urbaine à Kindu.
Une décentralisation des acteurs et leurs actions basées sur une cartographie et un diagnostic actualisés s’avère indispensable dans ce contexte. Pour cela une géogouvernance participative doit céder la place à la gouvernance politique.
Conclusion partielle
La gouvernance participative est possible à Kindu. La dernière partie de notre étude l’a démontré. Etant une ville à occupation majoritairement spontanée, Kindu peut être équitablement équipé en mettant sur pieds des stratégies de développement spatial appropriées.
Nous avons proposé pour cela la stratégie « D 3B » approche que nous avons trouvée susceptible de corriger à la fois la carence et le déséquilibre spatial en équipements publics.
Une projection basée sur une prospection des potentialités de Kindu nous a permis de proposer le mode de gouvernance dans les différents secteurs de la gestion urbaine. C’est dans ce cadre qu’un découpage (en annexe) a été proposé à la suite du mitage que connaît Kindu dans les localités voisines.
A l’issue de notre travail sur la dynamique territoriale et la géogouvernance à Kindu, nous tenons à rappeler que cette étude est subdivisée en cinq chapitres.
Les deux premiers ont abordé pour le premier l’aspect relatif à la dynamique territoriale de la ville et pour le deuxième l’analyse des équipements d’encadrement urbain, au départ d’une analyse de son évolution depuis son érection comme chef-lieu de province jusqu’en 2020.
Il a été démontré que la ville de Kindu connaît une croissance spatiale rapide depuis les deux dernières décennies. Il s’est observé un mitage vers les localités voisines. C’est le cas de Misenge, Shenge et Kange qui sont actuellement sous gestion de la ville, pourtant totalement situées dans la chefferie de Bangengele pour les deux premières et dans le secteur d’Ambwe pour le dernier.
Il en est de même de la croissance démographique qui a plus que doublé pour la même période alors que la dynamique des infrastructures n’a pas suivi la croissance tant de la population que celle du territoire.
Les analyses faites à ce sujet, montrent que certaines infrastructures conçues pour Kindu comme centre de transbordement, continuent à servir avec la même capacité une population plus nombreuse et un espace assez vaste que ceux pour lesquels elles ont été conçues.
Il s’observe ainsi plusieurs initiatives des privés qui interviennent dans divers domaines, suppléant ainsi aux infrastructures d’encadrement urbain. Les domaines les plus concernés par cette catégorie d’acteurs restent la santé, l’éducation et l’accès à l’eau potable.
Le troisième et quatrième chapitres ont inventorié et analysé les différents intervenants de la gouvernance publique/privée de la ville de Kindu.
L’Etat reste le principal acteur du développement. A ses côtés nous retrouvons plusieurs acteurs, parmi lesquels les Organisations non gouvernementales du système des Nations Unies (PAM, PNUD, UNICEF, BANQUE MONDIALE, ….) qui accompagnent la ville de Kindu depuis des années.
Une deuxième catégorie d’acteurs est constituée des Organisations non gouvernementales nationales et locales. Celles-ci dépendent financièrement des organisations du système des Nations Unies. Il se fait que leurs interventions sont souvent dictées par les donateurs des fonds et non par les besoins de la population.
La dernière catégorie que nous avons identifiée, est constituée des privés. Mues par le lucre, ceux-ci jouent un rôle, non de moindre, dans la gouvernance urbaine de Kindu.
Notons que ces organisations interviennent en majorité dans l’accès aux services publics de base (éducation, santé, eau potable, etc.).
L’analyse (FFMO) nous a permis de nous rendre compte de nombreuses opportunités de la ville, de forces dont elle dispose, mais aussi des menaces et faiblesses que les gestionnaires sont tenus de résoudre comme défis de la gouvernance de la ville de Kindu. Nous nous sommes limités à quelques secteurs que nous avons circonscrits dans ce travail.
Voilà pourquoi, nous avons proposé dans le cinquième chapitre une perspective de la gouvernance territoriale actualisée ou un modèle de gouvernance urbaine. Il s’agit d’une projection de la géogouvernance. Celle-ci passe par un diagnostic actualisé de chaque secteur de la gouvernance urbaine.
A cela, il a été souhaitable qu’un nouveau découpage administratif suivi d’une nouvelle implantation des infrastructures soient envisagés afin d’éviter le déséquilibre spatial.
De ce qui précède nous suggérons pour la ville de Kindu les pistes qui suivent :
- Promouvoir une gouvernance participative au sens propre ;
- Considérer la rue comme l’unité sociale de base sur laquelle doit partir le diagnostic et l’analyse spatiale (schéma ‘’D 3B’’) ;
- Doter la ville de tous les organes politiques en parachevant le processus électoral (organisation des élections locales) ;
- Inculquer la culture fiscale en vue de capitaliser la perception des taxes urbaines, ce qui doterait celle-ci des moyens de sa politique.
N’ayant pas la prétention de vider la question de la gouvernance urbaine à Kindu, nous pensons, pour notre part, que nous venons de planter le décor pour des études futures sur la géogouvernance des villes moyennes de la RDC et cela dans tous les domaines touchant au développement territorial.
Nous pensons que notre étude est un outil important pour la planification urbaine et territoriale. Elle apporte une contribution substantielle pour le plan de développement urbain de Kindu (PDU), programme où nous avons été collaborateur au titre du consultant.
Dans la programmation faite, la CTB projetait dans son projet PAIDECO (Programme d’Appui aux Initiatives du Développement Communautaire), dont l’objectif principal était la reconstruction institutionnelle, économique et sociale de Kindu, une stratégie de responsabilisation des partenaires pour répondre aux besoins de la ville.
Nous estimons, à l’issue de la présente recherche, que la promotion de la gouvernance participative, la prise en compte et la sélection priorisée des potentialités urbaines et périurbaines d’après leurs forces, faiblesses, menaces et opportunités, aideraient la ville à atteindre le développement local tant souhaité par le programme de développement urbain.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les meilleures pratiques de gouvernance urbaine à Kindu ?
La recherche propose une gouvernance participative basée sur la décentralisation à travers la stratégie ‘D 3 B’ pour développer les espaces urbains.
Comment l’équité spatiale est-elle matérialisée à Kindu ?
La matérialisation de l’équité spatiale dans la ville de Kindu passe par l’identification des objectifs à atteindre et un zonage du territoire urbain.
Pourquoi la décentralisation est-elle importante pour la gouvernance à Kindu ?
Une décentralisation des acteurs et leurs actions basées sur une cartographie et un diagnostic actualisés s’avère indispensable pour une gestion équitable et équilibrée de la ville.