La langue et identité en littérature révèlent des enjeux profonds d’appartenance et de déracinement. En explorant l’œuvre de Leïla Sebbar, cet article met en lumière comment le tiraillement entre le français et l’arabe façonne une quête identitaire essentielle, transformant la souffrance en création littéraire.
La langue en société
La question essentielle qu’on se pose d’abord est celle de la langue, elle représente le premier élément d’une communauté ou d’une ethnie, de surcroit « la société n’est possible que par la langue »11 donc chaque communauté linguistique se présente comme un groupe de personnes qui ont le même ensemble des attitudes sociales envers la langue.
Dans notre présent travail, on s’intéresse à une littérature nommée maghrébine de langue française celle-ci est apparue au début de la guerre d’Algérie, en affirmant cette littérature par la plupart des écrivains maghrébins d’expression française tel que : Kateb Yassine, Mouloud Feraoun, Mohamed Dib, etc. Le fait de choisir cette langue étrangère, pour exprimer les idées et les pensées chez les écrivains magrébins, exprime le poids des douleurs vécues pendant cette époque, parce que le français renvoie à un rapport : colonisateur/ colonisé. Ils tentent de faire recours à cette langue afin d’engager dans des sujets politiques et sociaux ainsi pour transmettre la souffrance que vit le peuple dans cette période.
Leïla Sebbar serait donc une écrivaine entre les deux langues, son récit se passe au moment le plus difficile de l’Algérie, sa patrie était sous l’autorité française, durant lequel l’arabe était totalement interdit, la seule langue autorisée et enseignée dans les écoles c’est le français.
Il est évident qu’avant l’époque coloniale la seule langue en Algérie était l’arabe, propagée en même temps que l’islam. Cependant durant la colonisation française le français a été admis dans les administrations algériennes comme une langue officielle12. Certes, les indigènes ont totalement refusé d’acquérir et de côtoyer les écoles françaises et ils ont plutôt fréquenté un autre lieu d’apprentissage nommée la Médersa13, pour pouvoir enseigner le Coran, par contre les intellectuels de la population ont fini par l’admettre et même par la rendre une langue de base, en donnant à titre d’exemple le père de Leïla Sebbar. De ce fait, le français est considéré dans cette époque comme un patrimoine de la colonisation qui vient en réaction contre l’arabe classique.
Dans cette perspective en peut constater que dans l’Algérie coloniale de Leïla Sebbar il n’existe pas une langue nationale, d’une part, il y a dans la société les indigènes qui parlent l’arabe dialectal ou l’arabe classique celle des personnes pratiquant le Coran, et d’autre part il existe l’autre langue étrangère, qui est loin de la société, de la réalité du pays et loin de la misère ambiante.
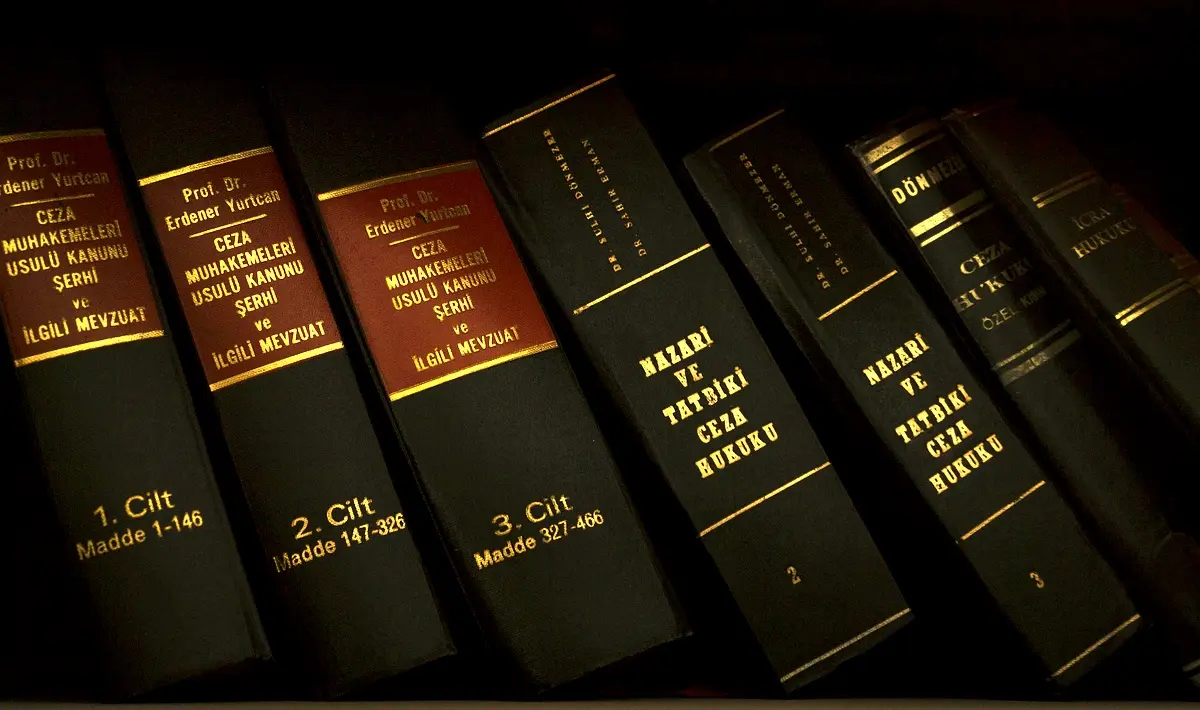
Au commencement, il y a la maison d’école où vit Leïla Sebbar, un lieu clos sur lui- même, idéal où aucune maison du village ne l’avoisine et aucune autre langue que le français n’est permise, ainsi l’espace intérieur de l’école s’arrête à la porte celui-ci sépare cette citadelle du monde extérieur, de l’arabe du père, des indigènes de pays, des femmes de son peuple et de cette terre natale.
Leïla Sebbar écrit : « Je suis née dans une maison où la langue de France est là. La langue arabe n’a pas droit de maison ni d’école. Mon père garde la langue de sa mère dans une terre obscure, interdite, qu’il garde de la langue séductrice. Pas de rivalité entre l’une et l’autre.
L’ombre de la langue arabe la préserve. »14
Cependant, dans cette famille cultivée on enseigne beaucoup de savoirs et de valeurs aux enfants, mais n’échange ni sur les événements extérieurs ni sur les émotions intimes du peuple arabe, contrairement à son père, Leïla et sa famille voient le monde arabe comme un monde mystérieux, ce n’est qu’à travers la trame moustiquaire et les trous d’un grillage que le monde alentour est vu. Il est clair que cet isolement laisse une part de mystère de la langue et les priver de signification rationnelle. Ce sont donc les rires en arabe, les voix et même les silencieux langages gestuels charriés par cette langue qui ravissent et attirent leur attention :
« L’Algérie lointaine peut ainsi revenir à elle par l’entremise de mille et une traces : un mot, une voix soudain entendus, un geste familier tout à coup reconnu abolissent temps et distance pour lui restituer »15 dit Leïla Sebbar.
Cependant pour communiquer avec les autres la mère de Leïla était obligée d’apprendre des mots en arabe par exemple les noms des bonnes Aïcha et Fatima, les noms de ses élèves, les noms des villes et des quartiers, etc.
Aïcha et Fatima les deux sœurs servantes de la famille Sebbar elles-mêmes abandonnent la langue arabe, elles ont parlé la langue étrangère comme par miracle : «Aïcha et Fatima comprennent, apprennent et parlent avec ma mère, avec nous, la langue étrangère, pour elles la langue du travail, du pays chrétien qu’elles ne savent pas où placer dans l’univers »16
14SEBBAR, Leïla, L’ombre de la langue revue transdisciplinaire franco-portugaise, Gris France, 2005, p.135 15SEBBAR, Leïla, Mes Algériens en France, carnet de voyages autobiographique, Paris, Bleu autour, 2004. 16SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père. Paris, Julliard, 2003, p.45
Il est intéressant de signaler par la suite que la famille Sebbar reste toujours à l’écart de la langue donc à l’écart de la société algérienne, elle a accepté de vivre à la française dans un pays arabe, cet isolement est le résultat d’un silence absolu, c’est le mutisme du père Sebbar qui a choisi de ne pas transmettre à sa maison la langue de son pays.
3.1 Le silence du père
Je ne parle pas la langue de mon père est un roman autobiographique. Son principal thème c’est le silence, un silence qui signifie un abandon, un mépris, ou un sacrifice d’un père instituteur qui a choisi de se marier une française et d’adopter sa langue, la langue française qu’il aime et qu’il parle avec plaisir. Ceci apparait dans le discours à travers les énoncés suivants« Elle est sa femme et sa langue est sa langue, lorsqu’il parle avec elle » (…) « Il les aime, la mère de ses enfants et sa langue. »17
En effet, le père de Leïla Sebbar a choisi de parler avec sa femme et ses enfants la langue de l’ennemi et de suivre leur culture. Il abandonne sa propre culture et sa langue maternelle l’arabe. Il préfère d’être s’exiler dans son pays natal. Leïla et ses sœurs ne reconnaissent pas les traditions algérienne, ils n’ont jamais voire le bain maure, ni les cérémonies du henné, ni patio.
Le père ne leur transmet pas les contes et les histoires de son peuple. Son silence fait de sa langue une langue absente, abandonnée et même interdite. Ce silence est attaché à l’exil et une amnésie : « Son silence les protège. C’est ce qu’il pense et, depuis que des enfants lui sont nés corps et langues divisés, étrangers au-delà des mers, hors de lui, à qui il a parlé dans la langue de l’exil, l’unique désormais, avec l’accent, et la voix et le rire ou la colère de sa terre absente, abandonnée, interdite? »18
Nous remarquons dans le passage cité en haut, que Mohamed Sebbar s’interdit de parler de l’histoire de son pays colonisé avec sa famille. Ce mutisme a été gardé plusieurs années pour protéger ses enfants, et de rien révéler à ses enfants et aux petits-enfants les traditions et la culture orientale.
Notre romancière déclare dans son roman que sa mère l’a enfermée dans sa langue, comme encore dans son ventre, donc elle voit que la langue française, celle du colonisateur ait bloquée la communication entre son père et elle : « peut-être la langue étrangère l’a séparé des mots qu’il aurait choisis pour nous, ses enfants. »19 Il existe une raideur entre la fille et son père lorsqu’elle commence à l’interroger sur le passé.
17 Ibid. p. 20
18 Ibid. p. 22
19 Ibid. p. 29
Une conversation rompue entre les deux, des interrogations restent ouverte et sans réponse :
« Je voudrais savoir…- qu’est-ce que tu veux savoir encore?- Non ma fille, non… laisse oublie tout ça…C’est pas la peine, crois-moi c’est pas la peine -Mais papa, ce que tu sais toi, tu es peut être le seul (…) les livres ne disent rien et toi non plus – Ecoute ma fille si je pensais que c’est important, je te répondrais »20
Dans cette citation deux visions se confrontent. On trouve que la fille est très curieuse. Elle veut tout savoir sur le passé et tout ce qui se passe dans l’Algérie colonisée, tandis que son père veut tout oublier et mettre sa famille à l’abri. Il choisit de se taire pour qu’il puisse les protéger de l’ennemi, Le père restera l’étranger bien aimé. Il mourra en 1997 sans avoir révélé à sa fille l’histoire de la guerre d’Algérie et aussi sans avoir partagé avec elle les souvenirs de l’enfance.
Leïla Sebbar reprend la notion de silence tout au long de son livre, insistant sur le mutisme de son père elle déclare qu’elle a vécu une vie douloureuse, déracinée et décentrée. Elle et vivaient à la marge d’une culture occidentale qui dévalorise la culture maghrébine. Cela est affirmé dans un article écrit par Georgia Makhlouf, écrivaine et correspondante à Paris de l’Orient littéraire. Leila Sebbar dit que son père garde le silence pour les protéger de la division :
Mon père m’a protégée d’une division plus grande. Dans l’Algérie coloniale, très divisée et baignée de haines implicites, n’être ni d’un bord ni de l’autre aurait été encore plus difficile à vivre. Son silence m’a placée dans un camp, le camp dominant, celui qui allait me donner les moyens de me construire. Bien évidemment, je ne me suis pas trouvée dans le camp de l’Algérie française. Politiquement.21
Cependant, le père de Leïla ne savait pas ce qui est arrivé à ses filles, parce que les trois filles étaient seules dans le chemin de l’école, elles n’avaient pas parlé à leur père de ces cris articulés. Ces insultes sont gravées dans la mémoire de Leïla et ses sœurs, elles ne peuvent pas les omettre.
Malgré que, le père de Leïla a lu ses écrits où elle raconte la terreur quotidienne, mais malheureusement il se tait et il garde toujours le silence. A propos de cela elle a écrit : « Mon père n’a pas entendu les mots criés vers nous. Les petites filles étrangères qu’on insultait à distance (…) pourtant je l’ai écrit, publié, la moustiquaire en témoigne et d’autres textes.
Silence. Silence de mon père aussi. Il a lu, je le sais, mais il se tait, et je ne demande rien. »22
20 Ibid. p. 12
21 MAKHLOUF-CHEVAL, Georgia, Entretien avec Leïla Sebbar publié dans l’Orient littéraire L’Orient-Le jour, Beyrouth, Mars 2008.
22 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, 2003, p. 36.
Il s’avère important de noter que le père de Leïla n’a pas offert la langue de sa mère à ses enfants. Elle déclare que l’histoire coloniale n’est pas la seule raison de ce geste de rétention, en fait, cela laisse toujours une part d’obscurité et de mystère chez sa famille et ce mutisme attire l’attention de ses enfants, ainsi, ils tentent de chercher et de tout savoir, c’est pour cela Leïla la curieuse ne cesse pas de poser des questions à son père.
________________________
11 BENVENISTE, Emile, Coup d’œil sur le développement de la linguistique, Paris, Gallimard, 1962, p.18 ↑
12 La langue française en Algérie, état des lieux: art, langages, apprentissage, [en ligne], in : http://arlap.hypotheses.org/7953.com consulté le:14/03/2017 ↑
13 Terme d’origine arabe désignant une école, elle est basée sur la Charia, la loi islamique telle qu’explique le Coran régit la plus part des aspects de la vie quotidienne. ↑
14 SEBBAR, Leïla, L’ombre de la langue revue transdisciplinaire franco-portugaise, Gris France, 2005, p.135 ↑
15 SEBBAR, Leïla, Mes Algériens en France, carnet de voyages autobiographique, Paris, Bleu autour, 2004. ↑
16 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père. Paris, Julliard, 2003, p.45 ↑
21 MAKHLOUF-CHEVAL, Georgia, Entretien avec Leïla Sebbar publié dans l’Orient littéraire L’Orient-Le jour, Beyrouth, Mars 2008. ↑
22 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, 2003, p. 36. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la problématique principale abordée dans ‘Je ne parle pas la langue de mon père’ de Leïla Sebbar?
Cette recherche explore la problématique de l’exil et du déracinement identitaire chez Leïla Sebbar à travers son roman ‘Je ne parle pas la langue de mon père’.
Comment la langue française est-elle perçue dans le contexte de la colonisation algérienne selon Leïla Sebbar?
Le français est considéré comme un patrimoine de la colonisation qui vient en réaction contre l’arabe classique.
Quel est le rôle de la langue arabe dans la vie de Leïla Sebbar selon son récit?
Leïla Sebbar décrit que la langue arabe n’a pas droit de maison ni d’école et qu’elle est gardée dans une terre obscure, interdite, par son père.