L’impunité et droits humains sont au cœur d’un débat crucial : comment les amnisties peuvent-elles coexister avec les exigences de justice internationale ? Cette recherche révèle des implications juridiques profondes, redéfinissant notre compréhension des droits des victimes face aux violations graves.
B- Incompatibilité avec les principes de l’Organisation des Nations Unies
Les Nations-Unies ont condamné par leurs principes et politique, l’impunité des crimes graves touchant à la sensibilité internationale. L’ONU affirme que les amnisties, les prescriptions pénales et toute autre forme d’impunité sont incompatible à sa politique.
Les Etats doivent selon elle veiller à ce que: a) les auteurs d’atteintes graves aux droits de l’homme et au droit humanitaire soient traduits en justice69; et b) les victimes aient droit à un recours utile, y compris à réparation70.
Les Nations-Unies dans sa politique, obligent les différends Etats à mettre en place les des mécanismes d’enquête et de réparation des violations des droit de l’homme. Les amnisties et les prescriptions pénales sont prohibées.
C’est ainsi que l’un des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
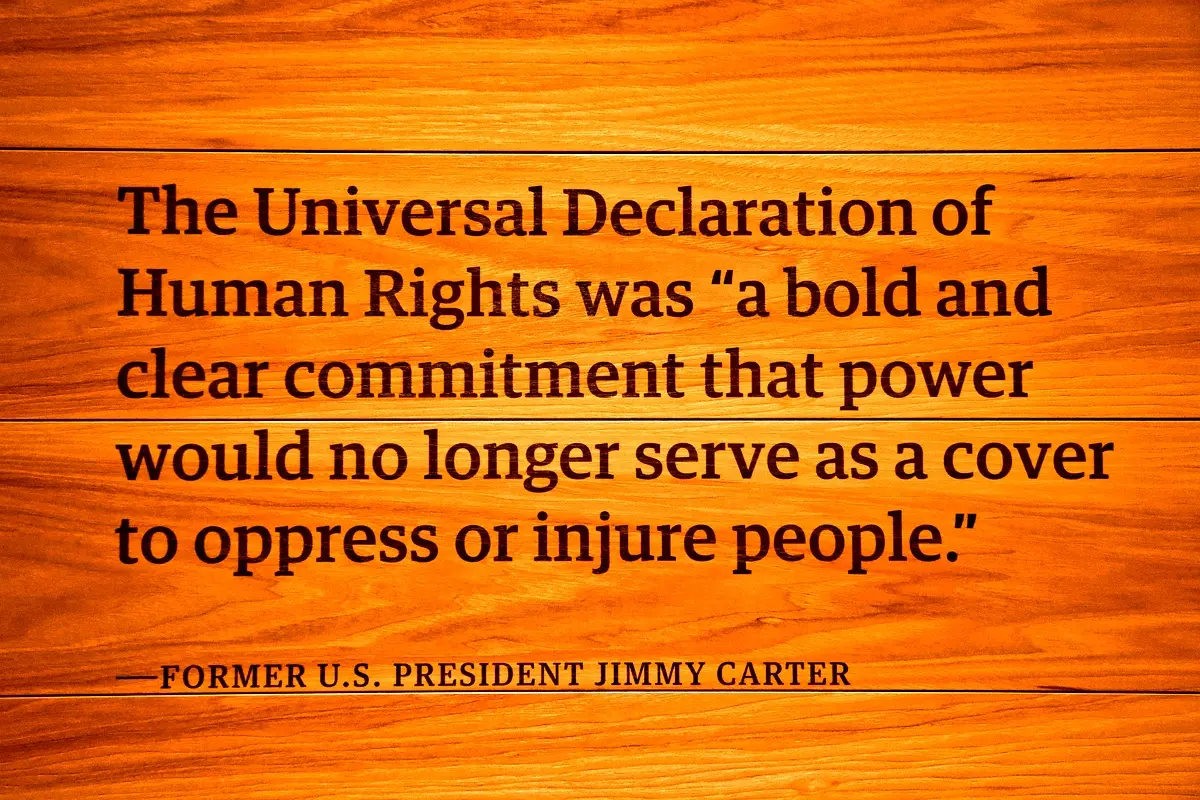
humanitaire, adoptés par l’Assemblée générale en 200571, réaffirme cette obligation lorsqu’il dit : « En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international [par exemple des «crimes de guerre»], les États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne présumée responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations ».
Cette affirmation est une volonté manifeste des NU pour mettre fin aux pratiques d’amnisties et de prescription pénale pour les crimes internationaux.
Aussi, l’Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, dont la Commission des droits de l’homme a pris acte avec satisfaction en 2005, affirme essentiellement la même norme dans son Principe 1972, comme quoi « Les États doivent mener rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et prendre des mesures adéquates à l’égard de leurs auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que les responsables de crimes graves selon le droit international soient poursuivis, jugés et condamnés à des peines appropriées ».
Parlant spécifiquement du cadre des amnisties et des prescriptions pénales, le principe 24 vient donner des limites d’applications aux Etats, si ceux-ci mettaient quand même les impunités en œuvre.
Pour ce principe, « Y compris lorsqu’elles sont destinées à créer des conditions propices à un accord de paix ou à favoriser la réconciliation nationale, l’amnistie et les autres mesures de clémence doivent être contenues dans les limites suivantes:
a) Les auteurs de crimes de droit international graves ne peuvent bénéficier de telles mesures tant que l’État n’a pas satisfait aux obligations visées au Principe 19 ou qu’ils n’ont pas été poursuivis par un tribunal − international, internationalisé ou national – compétent hors de l’État en question… ».
Enfin, plusieurs autres principes comme le principe 31 ou 32 nous permettent de comprendre que la politique des Nations-Unies est incompatible aux institutions prônant l’impunité.
Cette affirmation d’incompatibilité entre les amnisties, les prescriptions pénales et la politique de l’ONU est dans une certaine mesure la conséquence de la monté de la notion d’imprescriptibilité des crimes au rang de principe en DIP.
________________________
69 Par exemple, les Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité prévoient que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité «doivent faire l’objet d’une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu’ils ont commis de tels crimes doivent être … traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, châtiés» (résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée générale). Les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions prévoient: «En aucun cas … une amnistie générale ne pourra exempter de poursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires» (résolution 1989/65, annexe, Principe 19, du Conseil économique et social). La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées prévoit que «[l]es auteurs et les auteurs présumés [d’actes de disparitions forcées] ne peuvent bénéficier d’aucune loi d’amnistie spéciale ni d’autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale» (résolution 47/133, art. 18, de l’Assemblée générale), alors que la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, de 1993, prévoit que les États devraient «agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées» (résolution 48/104, art. 4 c), de l’Assemblée générale). La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, affirme que «[l]es États devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides» (A/CONF.157/24 (partie I), chap. III, par. 60). ↑
70 Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame: «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi» (art. 8). ↑
71 Résolution 60/147, annexe, de l’Assemblée générale. ↑
72 Résolution 2005/81 sur l’impunité, par. 20. ↑
Questions Fréquemment Posées
Pourquoi les amnisties sont-elles incompatibles avec les principes de l’ONU?
Les Nations-Unies affirment que les amnisties, les prescriptions pénales et toute autre forme d’impunité sont incompatibles avec sa politique.
Quels sont les obligations des États concernant les violations des droits humains?
Les États doivent veiller à ce que les auteurs d’atteintes graves aux droits de l’homme soient traduits en justice et que les victimes aient droit à un recours utile, y compris à réparation.
Quelles sont les limites d’application des amnisties selon les principes de l’ONU?
Les auteurs de crimes de droit international graves ne peuvent bénéficier d’amnisties tant que l’État n’a pas satisfait aux obligations d’enquête et de poursuite des auteurs.