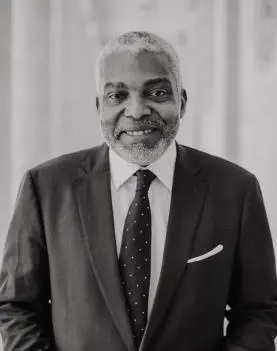L’impact des normes QSE sur les conflits culturels révèle une réalité surprenante : les référentiels ISO, loin de résoudre les tensions interculturelles, peuvent aggraver les relations humaines. Cette étude met en lumière l’urgence d’adapter ces outils aux défis contemporains, notamment post-COVID-19.
PARTIE I : Inexistence d’outil universel de régulation des tensions culturelles : vide constitutif du référentiel normatif ISO
Parce que la norme, quelle qu’ait été son efficience du point de vue de la nécessité économique, a tendance à s’enfermer, ou plus exactement à être enfermée dans un formalisme rigide, rendant son approche très impersonnelle. Dire autrement, laissant de côté les facteurs originaux des êtres, des styles, des cultures, du numérique.
L’objectif ici est d’analyser de quoi sont faits les normes, repérer leurs limites constitutives, ainsi que leur applicabilité. Car nous avons fait le constat que la nature humaine et les relations humaines sont un impensé et une zone aveugle dans les normes.
La pandémie du covid-19 apparait à ce titre, comme un accélérateur de la dépréciation du contact humain, de la désocialisation dans l’entreprise, et où le contact humain sera perçu désormais comme le maillon faible.
Il sera examiné dans cette rubrique d’une part, les facteurs culturels dans les normes (A), d’autre part, promotion et garantie de l’interculturalité par la charte des droits fondamentaux (B).
Facteurs culturels, uniformité et interconnexion du tissu normatif ISO
Il ne s’agit pas ici de décrypter les normes dans tous leurs éléments constitutifs, ni dans l’entièreté des domaines d’exigences respectives, mais d’en extraire quelques aspects d’intérêts, en référence à la présente analyse. Il s’agit surtout d’analyser en profondeur le contenu des facteurs humains et culturels mis en évidence par les normes.
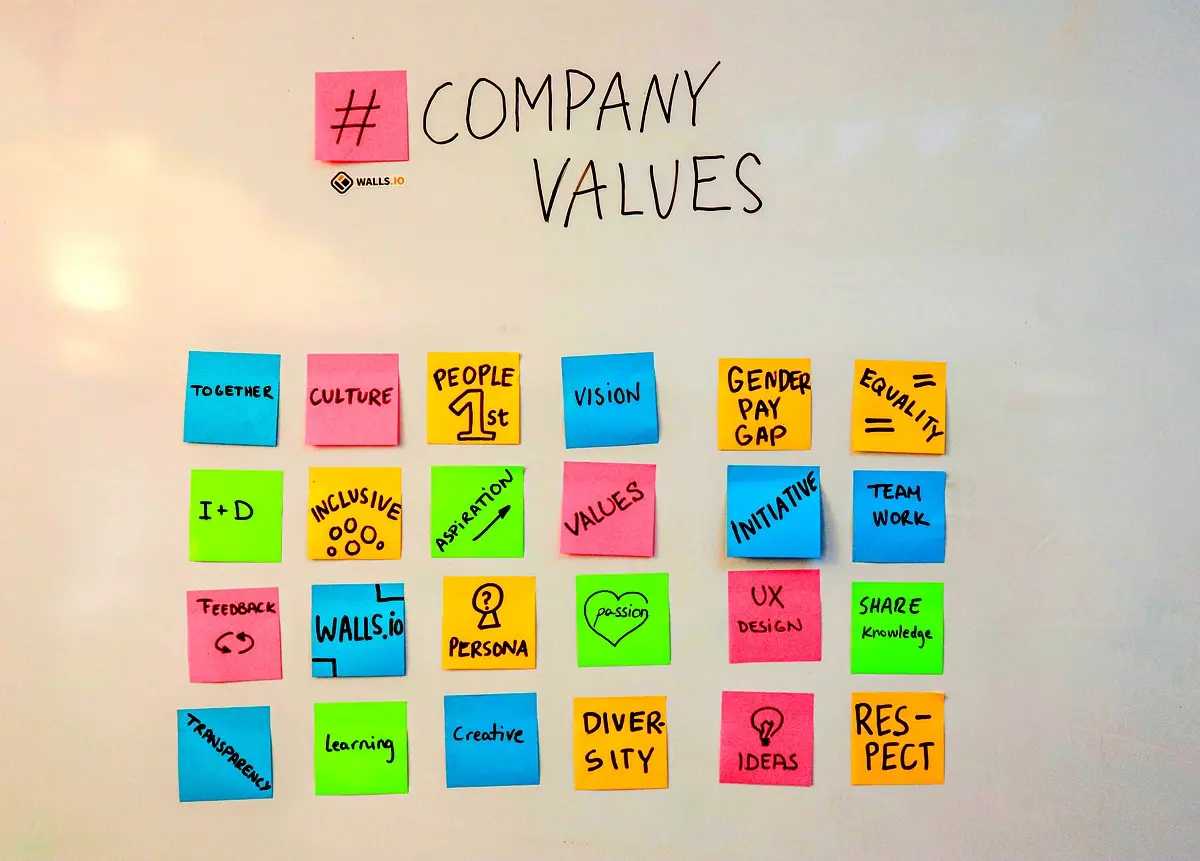
Nous examinerons tour à tour, deux normes (la NF ISO 26000 et la NF ISO 31000) qui sont des codes de bonne conduite, des accords de méthode, non contraignantes pour les entreprises, c’est à dire, n’offrant pas de certification en bout de course.
- La NF ISO 26000 : réponse aux interpellations sociétales, une innovation sociale
La NF ISO 26000, comprend la responsabilité sociétale, qui selon le livre vert de la Commission Européenne5, est définie comme « l’intégration volontaire par les entreprises, des
5 Livre vert : promouvoir un cadre Européen pour la responsabilité sociétale des entreprises, texte E1776 Com (2001) 366 final du 18 /07/2001
préoccupations sociales et environnementales, à leurs activités commerciales et leurs activités avec les parties prenantes. La RSE constitue ainsi, les modalités de réponse de l’entreprise aux interpellations sociétales, en produisant des stratégies, des dispositifs de management, de conduite de changement et des méthodes de pilotage, de contrôle, d’évaluation et de reddition incorporant (du moins en principe), de nouvelles conceptions de performances ».
Seules ces deux questions centrales sont des éléments pacificateurs dans le monde du travail, garanties par la Cjue.
Certains États Européens, comme c’est le cas de la France, ont adopté une loi rendant obligatoire la prise en compte de la RSE dans les entreprises : chaque société cotée en bourse, disposant d’une entière liberté méthodologique pour remplir son obligation d’engendrer des profits, afin de satisfaire ses actionnaires, doit décrire ses activités, ainsi que les impacts en terme qualitatifs. De plus, l’entreprise doit fournir des informations concrètes et si possible quantifiées.
La NF ISO 26000 non certifiable, a pour ambition de fournir les lignes directrices pour tous types d’organisations, concernant la responsabilité sociétale, quelle que soit leur taille ou leur localisation. Elle définit les termes, les principes, les pratiques et les questions centrales de la responsabilité sociétale, ainsi que la façon d’intégrer la responsabilité sociétale dans l’organisation.
- Fondements théoriques : logique d’accompagnement social
Il s’agit d’apprécier et d’évaluer comment la responsabilité sociétale impacte-t-elle la question sociale (accident, lutte contre les discriminations, formation des salariés…) au sein de l’entreprise. Le volet social est mis en avant, mais demeure assez imprécis, sinon flou quant aux objectifs qu’il est possible d’atteindre, car à l’analyse des 7 principes de la Responsabilité Sociétale, la référence à l’enjeu humain apparait dans les trois principes : le comportement éthique, la reconnaissance des parties prenantes, le respect des droits de l’homme. Dans les 7 questions centrales, 2 seulement en font allusion : développement du capital humain, les relations et conditions de travail.
Enfin, dans ces recommandations, la Responsabilité Sociétale engage aussi à l’équité des relations au travail, parce que le salarié en étant partie prenante, est au cœur du processus RSE. Celui-ci garantit ses droits, examine les relations dans l’entreprise et les conditions de travail. A ce propos, la charte des droits fondamentaux de l’UE, consacre ces droits sociaux dans son article 31.
- Vision managériale explicite : logique d’usage
- La Responsabilité Sociétale, va au-delà d’une simple responsabilité économique et contractuelle ou légale : « les entreprises ont une obligation envers les acteurs sociaux au-delà des prescriptions contractuelles »
- La RSE consiste à répondre aux attentes de la société de façon volontaire : importance des responsabilités économiques pour les masses, en développant des initiatives philanthropique et éthique. Cette vision charitable est très couteuse pour l’entreprise, qui n’attend aucun gain de sa conduite socialement responsable, mais en revanche, le retour sur investissement se traduit par la réduction des coûts externes, de l’augmentation de la fidélité des salariés, d’une meilleure réputation.
- La vision moderne de la RSE se traduit comme un ensemble de principes se déclinant au niveau institutionnel, organisationnel et managérial : les interrogations se positionnant en termes de processus.
- Si la RSE entraîne de nouveaux modes de gouvernance, un équilibre doit être trouvé entre les entreprises créatrices d’emploi et les hommes qui contribuent à leur succès.
- La NF ISO 31000 et autres systèmes de management normalisés
La NF ISO 31000, a vocation à énoncer des principes et lignes directrices pour gérer toute forme de risque, et non pas à servir de base de certification. L’objectif est par conséquent d’éviter des crises, et ce, dans une démarche de prévention. IL peut être intégré et adapté à toutes les activités de l’entreprise. Bien entendu la NF ISO 31000 fait partie des systèmes de management normalisés qui intègrent et prennent en compte les risques.
- L’intrication des domaines d’exigences et principes
Il s’agit d’identifier, comprendre et associer les différents processus empruntés ici et là aux référentiels QSE, en vue de leur adaptation au processus de résolution des conflits.
Pour la raison évidente qu’il est périlleux de construire des solutions en dehors des principes ISO, parce que, tout doit obéir à des processus spécifiques, à une conformité absolue.
La NF ISO 31000 dans sa parution de 2009, est venue combler une lacune, relative à la question des risques d’un point de vue global. Complétée et mise à jour en 2018, L’ISO 31000 : 2018 a intégré la structure universelle des normes de management HLS (High Level Structure), qui est un cadre commun pour les normes relatives au système de management.
Cette norme est intégrable aux normes de management QSE (ISO 9001 :2015 ; ISO 14001 :2015 ; ISO 45001 :2018), pour traiter des risques et opportunités.
La NF ISO 31000, est un outil utile pour traiter les risques qualité, environnementaux, de la santé et sécurité au travail.
« La création et la préservation de la valeur » est l’unique finalité du management des risques. Des 11 principes dans la version 2009, ils n’en sont plus que 8, par regroupement et simplification dans la version 2018. Ils permettent de répondre à la question : pourquoi fait-on un management des risques ?
Seul le principe relatif aux facteurs humains et culturels présente un intérêt pour notre analyse, il y est dit que « le management des risques identifie les aptitudes, les perceptions et les intentions des personnes externes et internes. Le comportement et la culture influent de manière significative sur tous les aspects du management des risques à chaque niveau et à chaque étape. »
- La qualité de vie au travail : connaissances organisationnelles
La démarche de la qualité de vie au travail résulte de l’accord national interprofessionnel 6 en 2013. C’est un « sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ».
Trois ans plus tard, la loi Rebsamen inclut le thème de la QVT dans le champ de la négociation annuelle obligatoire des entreprises. La QVT7 devient ainsi un incontournable dans les principes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
6 Publication ANACT (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) du rapport de l’accord national interprofessionnel sur la Qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle du 19 juin 2013
7 Qualité de vie au travail (QVT) d’où ça vient ; qu’est-ce que c’est ? Cyconia
Il est donc évident, compte tenu de ce qui précède, que s’il y a une cohésion au sein d’une équipe multiculturelle, il y a une bonne ambiance, un bon climat de travail et donc un intérêt au travail. C’est en somme, un outil qui est susceptible d’apporter des solutions satisfaisantes dans la réduction des dysfonctionnements.
Le cœur de la QVT, c’est le travail et les façons de l’améliorer. En entreprise, l’approche QVT permet de faire progresser concrètement et de façon combinée la qualité du travail, la performance et la manière dont les salariés vivent et perçoivent leur travail.
Par conséquent, une passerelle s’établit objectivement entre la QVT et la résolution des tensions culturelles, comme étant le fondement d’un bon climat de travail et d’un intérêt au travail.
________________________
5 Livre vert : promouvoir un cadre Européen pour la responsabilité sociétale des entreprises, texte E1776 Com (2001) 366 final du 18 /07/2001. ↑
6 Publication ANACT (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) du rapport de l’accord national interprofessionnel sur la Qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle du 19 juin 2013. ↑
7 Qualité de vie au travail (QVT) d’où ça vient ; qu’est-ce que c’est ? Cyconia. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment les normes QSE influencent-elles les conflits culturels en milieu professionnel?
Les normes QSE, telles que la NF ISO 26000 et la NF ISO 31000, ont tendance à être enfermées dans un formalisme rigide, rendant leur approche impersonnelle et laissant de côté les facteurs humains et culturels.
Quelle est la limite des normes ISO 26000 et 31000 face aux tensions interculturelles?
Les normes ISO 26000 et 31000 ne sont pas contraignantes et n’offrent pas de certification, ce qui limite leur efficacité dans la gestion des tensions interculturelles.
Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté les relations humaines dans le cadre des normes QSE?
La pandémie COVID-19 a accéléré la dépréciation du contact humain et la désocialisation dans l’entreprise, rendant le contact humain perçu comme le maillon faible.