Les défis de coopération des processus métiers révèlent des enjeux cruciaux dans les environnements BPM. Cette recherche innovante propose des modèles formels pour surmonter ces obstacles, promettant une intégration harmonieuse entre divers processus au sein des organisations, avec des implications significatives pour l’efficacité opérationnelle.
Étude des travaux de la recherche Académique
La question de l’intégration et de coopération des PMs a été largement abordée et traitée dans la littérature de recherche.
Dans cette section, on va explorer les différents travaux proposé par ces techniques d’intégration et de coopération des PMs.
L’analyse de l’etat de l’art fait ressortir quatre catégories de travaux, à savoir :
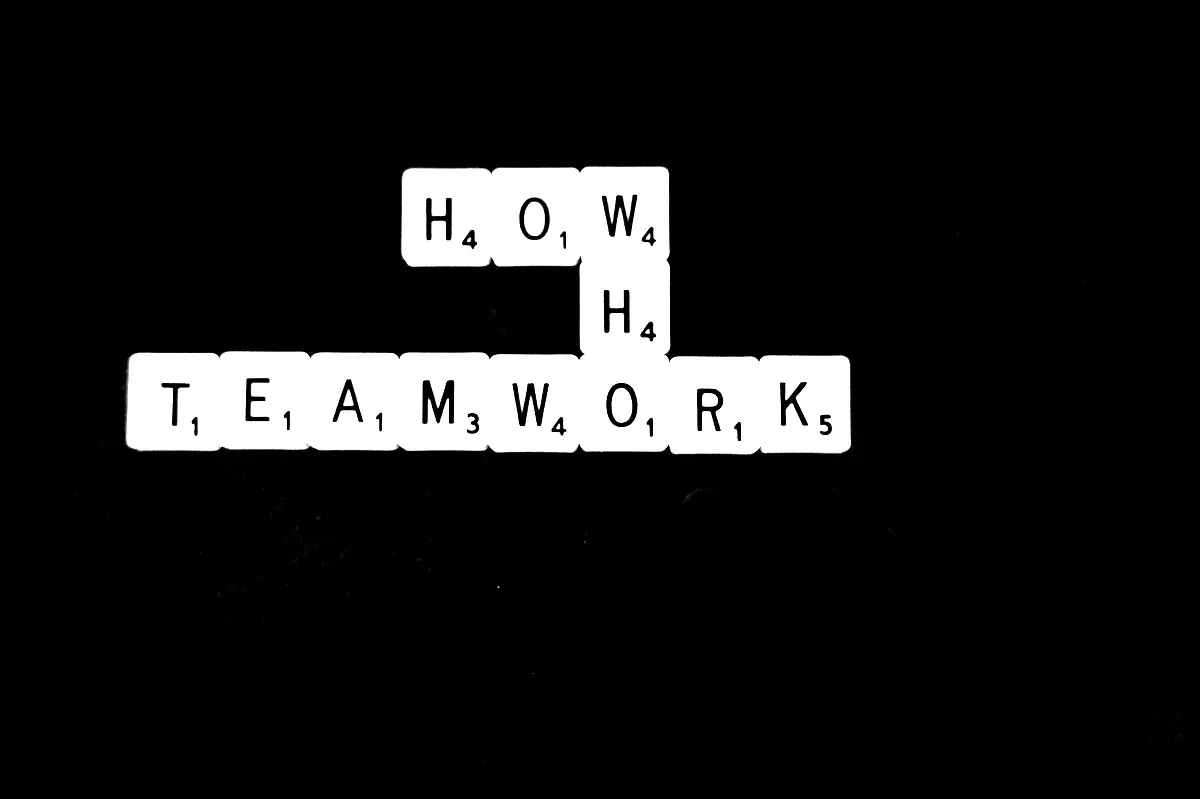
- La première famille présente quelques travaux illustratifs pour les techniques de l’intégration basée sur les données.
- La deuxième famille s’intéresse uniquement à l’intégration des PMs par rapport aux fonctionnalités de l’application (flux de travail).
- Une troisième catégorie de travaux traite de l’intégration des PMs d’un point du vue interface.
- Une quatrième catégorie de travaux qui de traite la coopération des PMs. Les différents travaux sont analysés et discutés, ci-après.
Les techniques d’intégration basées sur les données
Dans la littérature scientifique, le problème de l’intégration des données a reçu beaucoup d’attention. Cependant, la façon dont le problème est perçu varie en fonction de la technologie utilisée et des types de données qui sont manipulées.
Plusieurs approches, par exemples [35, 36, 37, 38], ont abordé la question de l’intégra- tion des données dans un environnement décisionnel de manière plus ou moins com- plète. A signaler que cet aspect à été déjà traité dans le cadre de projet de fin d’étude antérieurs [34, 13].
Travaux sur l’intégration des fonctionnalités
Plusieurs travaux de recherche ont traité le problème de l’intégration des PMs en se basent sur les activités fournies par les application qui prennent en charge les PMs.
- Dans [39], les auteurs présentent une approche basée sur un système de gestion du cycle de vie du produit (PLM) 1 pour l’optimisation de processus de développe- ment du logiciel. L’approche permet de définir l’ensemble des phases qui peuvent être identifiées comme des étapes distinctes qu’un logiciel peut franchir et utilise des typo- logies basées sur quatre critères (temps, stabilité, généricité et mesurabilité) pour gérer la traçabilité. Les systèmes PLM s’appuient sur une approche centrée sur le produit et
le cycle de vie qui indique l’ensemble des phases qui peuvent être reconnues comme des étapes indépendantes qu’un produit peut suivre.
Bien que cette approche garantissant une intégration efficace, la complexité de sa mise en oeuvre entrave son utilisation et son déploiement pour l’intégration de différents systèmes.
- Dans [40], les auteurs proposent une approche basée sur six modèle des processus d’adaptation pour résoudre l’incohérence des PMs pendant l’intégration. L’approche proposée permet de faciliter la modélisation des processus inter-organisationnels par des modèles formalisé avec workflownet (wFnet).
Bien que cette approche assurent une intégration efficace, elle reste limitée à la spécifi- cation du modèle wFnet.
- Dans l’article [41], les auteurs présentent une approche basée sur un cadre d’inté- gration des processus pour les applications fonctionnelles, l’automatisation des flux de travail et des fonctionnalités supplémentaires pour l’optimisation des processus. L’ap- proche proposée combine les applications et les flux de travail et offre une base pour l’amélioration des processus d’entreprise en intégrant les applications et les processus à l’aide de modèles de processus/données intégrés. L’une des principales limites de ce
- PLM : Product Lifecycle Management
travail est que l’approche proposée n’est pas généralisée à l’ensemble des composants de l’architecture du système ERP.
Analyse au niveau d’intégration d’interface
De nombreux articles de recherche ont abordé la question de l’intégration des in- terfaces.
-Dans [42], Chan et al proposent une approche semi-automatique basée sur les deux normes de services web connues sous le nom de WSDL 2 et WSCI 3 pour la composition dynamique des PMs avec la vérification des réseaux de Petri pour faci- liter l’échange de services, et simplifier l’interactivité. L’approche proposée fourni des informations sur la manière de composer des PMs. WSDL décrit les points d’entrée pour chaque service disponible, et WSCI décrit les interactions entre les opérations
WSDL. Après la composition, ils utilisent un modèle Petri-Net du service web pour vérifier qu’il n’y a pas de blockage. Dans cette méthode, les services web sont compo- sés à l’aide d’une programmation à N versions afin d’accroître la stabilité globale du système.
Bien que cette méthode s’intègre efficacement, elle ne tient pas compte de la qualité de service.
– Les auteurs dans [43] proposent une technique qui génère de manière semi-automatique la composition de services web statiques dans le langage BPEL4WS .La solution pro- posée rassemble le strict minimum de données utilisateur et les enregistre dans un modèle relationnel. Elle rassemble également les données nécessaires à la création de
la composition à partir des API WSDL et des modèles de composition des partenaires de coopération. Enfin, la technique de transformation est utilisée pour passer du mo-
- WSDL : Web Services Description Language
- WSCI : Web Service Choreography Interface
dèle relationnel au modèle BPEL.
Bien que cette stratégie garantisse une bonne intégration, elle ne permet pas de choisir la meilleure combinaison possible et sa composition est statique et ne profite pas des avantages de la composition dynamique.
- Un autre travail intéressant est suggéré dans [44]. Dans ce travail, les auteurs dé- crivent une étude des approches existantes, et se concentreront ensuite sur une tech- nique spécifique, la stratégie ASTRO, pour la résolution des problèmes réel de l’in- tégration des PMs et pour gérer des restrictions de composition difficiles. L’approche ASTRO permet la composition automatisée de services web et peut utiliser les fichiers WSDL et WS-BPEL pour définir les interfaces. Elle peut également échanger des mes- sages de manière asynchrone et capturer les protocoles et les structures de données complexes des services dans des domaines réels.
L’inconvénient majeur de la stratégie basée sur ASTRO est qu’elle s’accompagne d’un code complexe dont la maintenance est difficile.
- Le dernier travail étudié dans cette analyse d’intégration d’interfaces est celui pré- senté dans [45], les auteurs développent la planification comme stratégie de vérifica- tion de modèle pour gérer l’interaction asynchrone basée sur les messages entre les services impliqués dans la composition. La technique de composition automatisée est capable de traiter les problèmes de composition lorsque les services composants sont des processus complexes non déterministes et que les exigences de composition du flux de contrôle sont des contraintes complexes sur le comportement du processus.
L’inconvénient de ce travail est que la composition automatisée est limitée à la compo- sition séquentielle de services atomiques, et les exigences de composition sont limitées à des conditions d’accessibilité particulières.
A présent, nous abordons l’aspect coopération des PMs.
Les travaux sur la coopération des PMs
Dans cette catégorie de travaux on se focalise uniquement sur la coopération des PMs.
-Dans [46], les auteurs proposent une approche basée sur la modélisation avec BPMN4VC (BPMN pour Versioning Collaborations), une extension de Méta-modèle BPMN pour résoudre le problème de la flexibilité des processus inter organisationnels (c’est- à-dire coopératives) avant leur adaptation final et leur utilisation dans les entreprises. L’approche proposée permet de fournir une capacité de modélisation des version et de suivre et garder la trace des tâches, des événement, des messages, et la flexibilité des processus de collaboration et faciliter la migration des instances de processus.
Bien que cette stratégie assure une collaboration réussie, elle se limite à complexité de la norme de modèle BPMN4VC et dont l’adoption par toute la communauté n’est pas évidente.
- Les auteurs dans [47] proposent l’outil COMOMOD qui décrit une approche de coopération des PMs dans les environnement distribuée. Cette approche s’avère bé- néfique étant donné que les entreprises collaboratrices ont besoin d’une connaissance partagée de leurs propres processus, ainsi que de ceux d’autres entreprises et organi- sations. Pour réaliser cet objectif, cette approche permet la création simultanée d’un modèle coopératif utilisant de nombreux langages de modélisation en mettant en cor- respondance et en convertissant automatiquement les différentes représentations du modèle. Les chaînes de processus pilotées par les événements et les réseaux de Petri sont utilisés dans la démonstration de faisabilité. Ainsi que l’utilisation d’un service de messagerie pour faciliter la communication lors de la modélisation collaborative des processus métier.
Malgré que cette approche assure une coopération efficace , elle ne prend en charge qu’une étude de cas unique et les résultats ne peuvent donc pas être généralisés.
- Un autre travail intéressant est décrit dans [48]. Les auteurs présentent une stra-
tégie d’interconnexion de flux de travail basée sur les services SOA pour accomplir et faciliter la flexibilité et l’évolutivité des modèles de l’WIFO (workflow Inter organisation- nels). Ils utilisent un méta modèle de processus qui permet de combiner les concepts de workflow et de SOA puisque ces derniers sont caractérisés par leur couplage faible, pour la modélisation des processus inter- organisationnels répondant particulièrement à la forme de coopération.
Le concept de base de cette technique consiste à diviser de manière appropriée le modèle de processus partagé par les nombreux partenaires en sous-processus afin d’encapsuler chacun d’entre eux dans un service qui peut être dé- clenché pour un transfert. Un sous-processus est encadré par deux points de transfert. Cette technique est limitée par l’accent qu’elle met sur les éléments conceptuels plutôt que techniques.
Synthèse des travaux connexes
La table 3.1 ci-dessus résume les travaux connexes ayant abordé la problématique de l’intégration et la coopération des PMs de différents point de vues.
59
| TABLE 3.1 – Synthèse pour les travaux connexe. | |
|---|---|
| Parameter/Criteria | Description/Value |
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les défis de coopération des processus métiers ?
Les défis de coopération des processus métiers sont causés par la diversité des logiques métier propres à chaque organisation.
Quelles techniques sont utilisées pour l’intégration des processus métiers ?
Les techniques d’intégration des processus métiers incluent l’intégration basée sur les données, l’intégration des fonctionnalités de l’application, l’intégration d’interface, et la coopération des processus métiers.
Comment les Automates Finis Déterministes sont-ils utilisés dans l’intégration des processus métiers ?
Les Automates Finis Déterministes sont utilisés pour représenter les processus métier et des patterns pour identifier leurs points communs.