Le cadre théorique de l’analyse sémantique révèle comment les discours de Jean-Bertrand Aristide, entre 1991 et 2004, reflètent des dynamiques socio-politiques complexes en Haïti. Cette recherche met en lumière des relations inattendues entre discours et contexte, essentielles pour comprendre la crise politique contemporaine.
L’influence de la communauté Internationale, les États-Unis et l’église catholique
L’effondrement du bloc de l’Est, joints à l’économie de marché découlant du Nouvel ordre mondial, deviennent de nouvelles normes régissant la conduite des organisations régionales et internationales telles que l’OEA et l’ONU. Comme corollaires de cette réalité, surgissent alors les notions de « droit d’ingérence humanitaire » et de « devoir d’assistance à peuples en danger» faisant des concepts d’État nation, de souveraineté et d’autodétermination des anachronismes91 et consacrant le statut des pays du Nord comme maîtres incontestables du « monde globalisé92.
Ce changement de paradigme dans les relations internationales transforme les pays du Sud en arrière-cour des grandes puissances, et les institutions internationales en instruments d’application des mesures destinées à favoriser l’expansion et la consolidation du Nouvel ordre mondial. L’ingérence des pays auto baptisés « amis d’Haïti93 ». Les États membres de l’OEA ont signé l’Engagement de Santiago envers la démocratie et la rénovation du système interaméricain94, approuvé lors de la troisième séance plénière tenue le 4 juin 1991.
Ils y déclarent leur « engagement irrévocable envers la défense et la promotion de la démocratie représentative et des droits humains dans la région95 ». Dans ce contexte, le coup d’État du 30 septembre 1991, survenu dans l’un de ses pays membres, moins de quatre mois après le vote de L’engagement de Santiago, constituait une dure épreuve pour le prestige et la crédibilité de l’Organisation panaméricaine, d’où sa décision d’imposer des sanctions commerciales au régime militaire de facto dans le but de rendre flexibles les généraux putschistes, de créer chez eux les conditions psychologiques nécessaires au succès des négociations qui auraient dû90 conduire au rétablissement des autorités constitutionnelles au pouvoir, c’est-à-dire le président Aristide et son gouvernement.
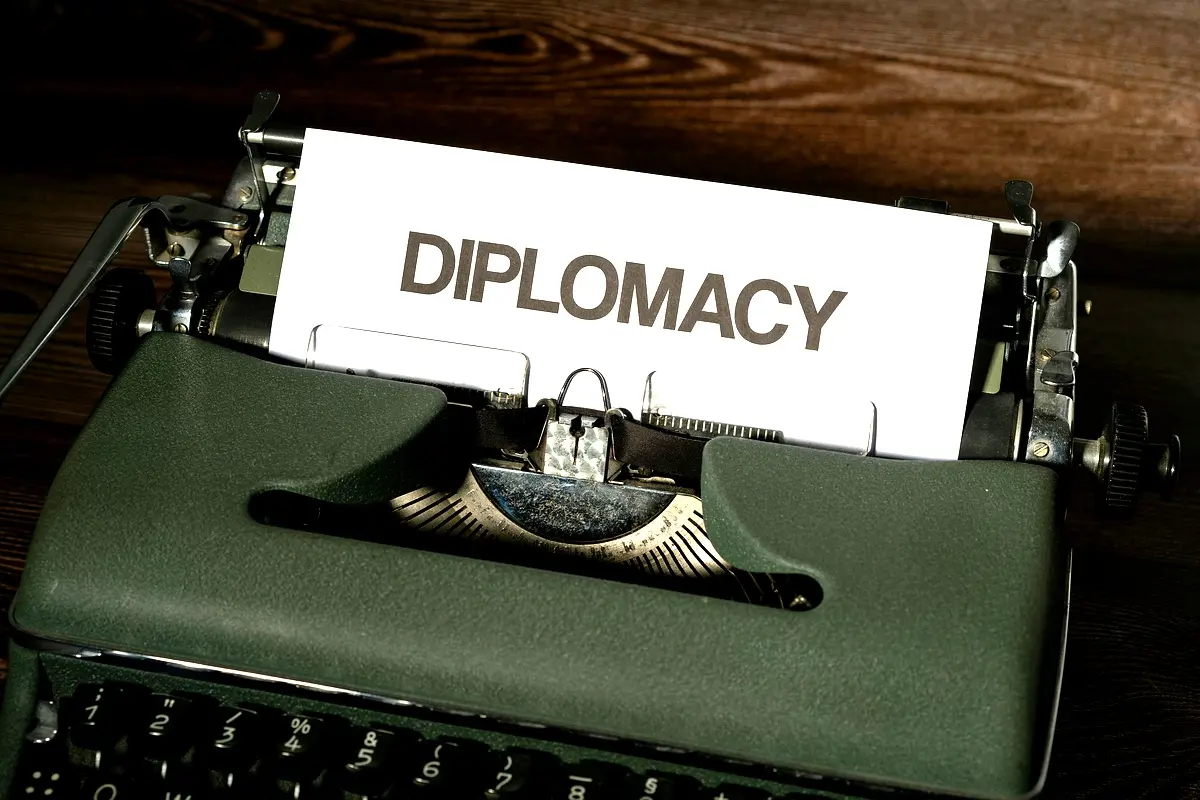
Pour aller en ce sens, le 23 février 1992 un accord est signé à Washington par les protagonistes haïtiens sous l’égide de l’OEA, les militaires ne respecter pas l’accord. Alors, le non-respect de l’embargo par certains pays de la région, la République dominicaine, entre autres, et l’évidente incapacité de l’OEA à résoudre la crise portèrent la diplomatie Haïtienne, avec l’appui des pays amis d’Haïti, à confier à l’ONU la gestion des négociations96. Fin 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies prit une résolution dans laquelle il réaffirma son appui au président déchu. Par suite de cette mesure, le secrétaire général de l’ONU, Boutros Boutros Ghali, nomma Dante Caputo, ancien ministre argentin des Affaires étrangères, émissaire spécial pour Haïti. Le secrétaire général de l’OEA lui attribua le même titre.
Après plusieurs visites infructueuses de l’émissaire onusien à Port-au-Prince, le Conseil de sécurité vota, le 16 juin 1993, la Résolution 841 décrétant un embargo mondial sur les armes et le pétrole contre les autorités militaires de facto.
Entre temps un autre accord est signé 15 octobre 1993, et n’est pas respecté. Le général Céderas ne donna pas sa démission et le président Aristide ne put non plus retourner au pays. L’intransigeance du régime militaire de facto semblait ne laisser à la communauté internationale que l’usage de la force comme unique option permettant de rétablir l’ordre constitutionnel en Haïti.
La diplomatie de la coercition ayant succédé à celle de la négociation, le 6 mars 1994 le Conseil de Sécurité adopta la Résolution 917 décrétant un embargo économique total contre le régime militaire de facto. Réagissant à cette décision, les militaires putschiste du Parlement nomment Émile Jonassaint, juge à la Cour de cassation président provisoire le 11 mai 1994.
Malgré le durcissement des sanctions commerciales imposées par l’ONU les militaires continuaient à afficher leur détermination à rester au pouvoir. Face à cette attitude, le président américain brandit la menace d’une intervention militaire : « Nous n’avons pas encore décidé de recourir à la force, mais, désormais, nous ne pouvons pas l’exclure97 ».
Cette phrase provoqua la colère des Républicains et montra toute la complicité dont bénéficiaient les militaires putschistes sous le gouvernement de George Bush98. Cela irrita profondément certains diplomates de l’OEA et de l’ONU. Le 8 mars 1994, le sénateur96 JEAN-FRANÇOIS, Hérold, Le coup de Cédras. Une analyse comparative du système socio-politique haïtien de l’indépendance à nos jours, p. 437-441.
97 JALLOT, Nicolas et LESEGE, Laurent, p. 149.
98 En réaction à cette déclaration de son successeur, l’ancien président américain affirma que « ce serait une énorme erreur, puisque aucune vie américaine n’est en danger en Haïti » ; il alla même jusqu’à réclamer la fin de l’appui du gouvernement Clinton à « l’instable Aristide ». Voir JALLOT, Nicolas et LESAGE, Laurent.
Christopher J. Dodd avait déjà défini la nouvelle orientation de la politique du gouvernement Clinton dans la crise haïtienne. « Finalement, déclara le sénateur démocrate, la politique que nous avons choisie ne concerne pas les 6 millions d’habitants en Haïti, ni les militaires haïtiens. Il s’agit plutôt de principes et de règles établis dans le cadre du Nouvel ordre mondial.
Il s’agit donc de notre intégrité99 ». Le 15 septembre 1994, l’intervention militaire fixée, le président américain s’adressa à son peuple : « Les dictateurs d’Haïti, dirigés par le général Céderas, contrôlent le régime le plus violent de notre hémisphère. Durant trois ans, ils ont rejeté toutes les solutions pacifiques que la communauté internationale avait proposées.
Ils ont violé un accord qu’ils avaient eux-mêmes signé pour abandonner le pouvoir. Ils ont maltraité leur peuple et détruit son économie […]. Céderas et son armée de voyous ont instauré un régime de terreur, exécutant des enfants, violant des femmes et tuant des prêtres […]. Laissez-moi vous dire une fois de plus que les nations du monde ont essayé toutes les voies possibles pour restaurer la démocratie en Haïti.
Les dictateurs ont rejeté toutes les solutions. La terreur, le désespoir et l’instabilité ne s’achèveront que par leur départ […]. Le message des États-Unis est clair : leur temps est terminé. Qu’ils s’en aillent maintenant ou nous les ferons laisser le pouvoir par la force […].100
Ce discours marque l’influence de l’intervention américaine dans la politique haïtienne. En trois semaines, les troupes américaines contrôlent complètement le pays, font voter la loi d’amnistie en faveur les militaires putschistes par le Parlement, et organisent le départ des officiers les plus liés au coup d’État du 30 septembre 1991. Le lendemain de l’intervention américaine, le président déchu se rend à la Maison-Blanche pour prendre congé de Bill Clinton et le remercier.
Il n’oublia pas non plus de se rendre au Pentagone pour dire au revoir à John Shalikashvili, chef d’état-major américain, et le remercier aussi101.
L’intervention militaire étrangère dans la crise Haïtienne de 1991-1994 avait surtout consacré l’effondrement de l’État haïtien pour n’avoir pas pris en compte sa dimension interne et sociétale.
Ainsi, la communauté internationale a ouvert la voie à une nouvelle conjoncture de crises qui allait affecter le pays au cours des dix dernières années, créant ainsi une situation d’instabilité permanente.
99 Sénat des États-Unis, commission aux Relations étrangères, « Audience sur la politique des États-Unis vis-à-vis d’Haïti », Washington, D. C., mardi 8 mars 1994.
100 MOUTERDE, Pierre et WARGNY, Christophe, Après la fête, les tambours sont lourds. Cinq ans de duplicité américaine en Haïti (1991-1996), Paris, Éditions Austral, 1996, p. 172.
101 L’énigme haïtienne – Chapitre 8. La crise de 1991-1994 ou l’effondrement de l’État haïtien – Presses de l’Université de Montréal, p.17 ; https://books.openedition.org/pum/15189?lang=fr
Dans les quartiers populaires, le mouvement des « Ti-legliz » se transforme progressivement. Les prêtres et les communautés qui les entourent créent des associations laïques, visant à structurer l’action dans les quartiers les plus démunis. Ces groupes sont alors baptisés « Organisations Populaires » (OP). Très diverses dans leurs compositions, elles ont une double vocation, sociale et politique.
Sociale, car elles cherchent à relayer l’aide « humanitaire » et à instaurer des programmes éducatifs. Politique, parce qu’elles poursuivent le combat pour la démocratisation du régime et demandent à ce que les masses puissent se faire entendre. Elles agissent alors par plusieurs modes d’action : les manifestations populaires, les graffitis etc.
Elles subissent alors la répression du secteur militaire et suscitent la méfiance des groupes intellectuels venus de l’exil. Dans ce mouvement, Jean-Bertrand Aristide se positionne logiquement aux côtés des OP. Il crée même une fondation, « la famni se lavi » (« la famille c’est la vie »), qu’il transforme en organisme politique, « l’Organisation populaire Famni Lavalas ».
Devenu porte-parole de l’opposition populaire, chouchouté par les médias audiovisuels étrangers, il est même victime d’une agression par les néo-macoutes du Général Namphy dans sa paroisse, le 11 septembre 1988, alors qu’il est en train de dire la messe. S’il en sort miraculeusement, onze de ses paroissiens meurent dans l’Église. Jean-Bertrand Aristide prend une nouvelle dimension et devient le symbole des martyres du Régime102 (Franklin, 1991).
Et l’église catholique demeure un acteur important sur le terrain politique en Haïti.
102 Midy Franklin, (1991), il faut que ça change: L’Imaginaire en liberté in Cary Hector et Hérard Jadotte, éds., Haïti et l’Après-Duvalier: Continuités et Ruptures, Tome I. Port-au-Prince: Deschamps et Montréal: CIDIHCA. P.89-94
Questions Fréquemment Posées
Quel est le cadre théorique de l’analyse sémantique des discours d’Aristide?
L’étude utilise un cadre méthodologique socio-sémiotique pour analyser cinq discours clés, dont deux discours d’investiture et deux discours aux Nations Unies.
Comment la communauté internationale a-t-elle influencé la politique haïtienne entre 1991 et 2004?
L’ingérence des pays auto baptisés « amis d’Haïti » et les sanctions commerciales imposées par l’OEA ont été des réponses à la crise politique, notamment après le coup d’État du 30 septembre 1991.
Pourquoi l’État haïtien est-il considéré comme faible dans le contexte des discours d’Aristide?
L’étude cherche à établir les relations entre les discours et les contextes socio-historiques de production, tout en explorant les facteurs expliquant la faiblesse de l’État haïtien.