Le cadre théorique de l’analyse sémantique révèle comment les discours de Jean-Bertrand Aristide, loin des attentes, reflètent des dynamiques socio-politiques complexes. Cette étude, essentielle pour comprendre la crise haïtienne contemporaine, offre des perspectives inédites sur la faiblesse de l’État haïtien.
Les termes et concepts opératoires
Évidemment, des termes et concepts entrent dans l’organisation et la structure du présent travail. Pour cela, une présentation de ces termes et concepts est nécessaire et est de nature à aider à la lecture et à la compréhension de ce travail.
Analyse
Selon le dictionnaire français Larousse, le mot analyse signifie : « Étude minutieuse, précise faite pour dégager les éléments qui constituent un ensemble, pour l’expliquer, l’éclairer : Faire l’analyse de la situation16 ». Et selon le dictionnaire l’internaute : « Opération intellectuelle de décomposition d’un tout en des éléments et leur mise en relation.
4.2. La sémantique
Le premier constat important est que les origines de la sémantique contemporaine sont à chercher ailleurs que dans la linguistique17. En effet, Il y a plus d’un siècle, Michel Bréal institua l’analyse du sens dans le langage. À partir de là, le développement de la sémantique repose sur des paradigmes, qui constituent de véritables métaphores de la nature générale du langage. Le sens linguistique relève de la vie mentale des individus pour le paradigme psychologiste qui réunit Bréal, Brunot, Damourette et Pichon, Guillaume et Bally. La nature incertaine de cette vie mentale porte le structuralisme de Saussure, Greimas, Rastier et Wierzbicka à envisager le sens comme dérivant de l’équilibre des oppositions internes à la langue.
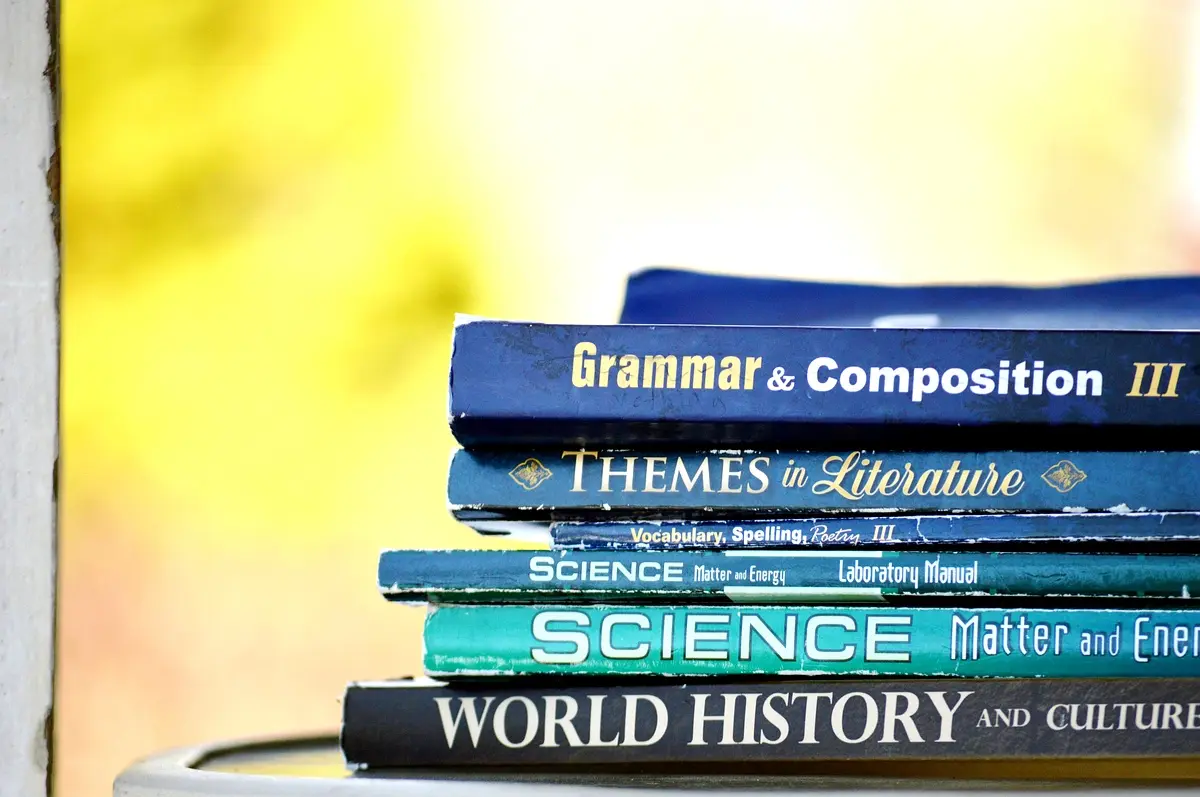
Les déterminismes de15 https://www.alterpresse.org/spip.php?article1023
16 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/analyse/3235 , consulté le 08 octobre 2022.
17 Zandrine Zifferey, et al., Initiation à l’études du Sens (sémantique et pragmatique), Auxerre Cedex, éd. Sciences Humaines, 2012, p.13.
cette organisation sont associés aux conditions de sa mise en œuvre pour le paradigme de l’énonciation élaboré par Benveniste, Ducrot, Anscombre, Nølke et Culioli. Ils sont pour le cognitivisme de Kleiber, de Cadiot, de Fuchs et pour la Grammaire cognitive dérivés d’un esprit au fonctionnement mécaniste. La linguistique a connu un tournant majeur avec les travaux du linguiste américain Noam Chomsky (1928- ).
Toutefois, si Chomsky reconnaît la pertinence de l’étude de la pragmatique pour la compréhension des langues naturelles, il pense que la sémantique n’est qu’une interface de la grammaire, au même titre que la phonologie (Chomsky 1995 ; Hauser, Chomsky & Fitch 2002). En d’autres termes, la sémantique ne constitue pas dans cette approche un domaine d’étude indépendant de la grammaire.
C’est pourquoi les origines de la sémantique contemporaine sont à rechercher dans d’autres disciplines, notamment dans les travaux des logiciens, des philosophes analytiques et des psychologues18.
Selon le dictionnaire les définitions.fr, la Sémantique provient d’un vocable grec pouvant être traduit par « l’art de la signification19 ». Il s’agit de ce qui appartient ou est relatif à la signification/au signifié des mots. Par extension, on entend par sémantique l’étude du signifié des signes linguistiques et de leurs assemblages.
La sémantique est donc associée au signifié, au sens et à l’interprétation des mots, des expressions ou des symboles. Tous les moyens d’expression représentent une correspondance entre les expressions et certaines situations ou choses, pouvant être du monde matériel ou abstrait. Autrement dit, la réalité et les pensées peuvent être décrites par le biais des expressions analysées par la sémantique.
La sémantique linguistique étudie la codification du signifié dans le contexte des expressions linguistiques. Elle peut se diviser en sémantique structurale et sémantique lexicale. La dénotation (le rapport entre un mot et ce qu’il désigne) et la connotation (le rapport entre un mot et son signifié suivant certaines expériences et le contexte) sont des objets d’intérêt de la sémantique.
L’étude du référent (ce que le mot dénote, tel qu’un nom propre ou un substantif commun) et du sens (l’image mentale qui crée le référent) font également partie de la sémantique linguistique. La sémantique logique, par ailleurs, est chargée de l’analyse des problèmes logiques de signification. Pour ce faire, elle étudie les signes (parenthèses, quantificateurs, etc.), les variables et constantes, les prédicats et les règles.
Puis, la sémantique dans les sciences cognitives se centre sur le mécanisme psychique entre les interlocuteurs dans le processus communicatif. La pensée humaine (l’esprit) établie des relations permanentes entre les
18 Zandrine Zifferey, et al., Initiation à l’études du Sens (sémantique et pragmatique), Auxerre Cedex, éd. Sciences Humaines, 2012, p 9-14.
19 https://lesdefinitions.fr/semantique, consulté le 16 juin 2022.
combinaisons de signes et d’autres facteurs externes introduisant un signifié20. Ainsi, Le but de la sémantique (sémiotique, sémiologie) est de mettre à jour « le procès du sens », pour reprendre l’expression de Barthes : « faire émerger les structures invisibles qui lient les éléments entre eux : la matrice structurante du message21 ». Dans cette analyse nous utiliserons la sémantique dans ses acceptations décrites ci-dessus, c’est-à-dire ; linguistique et logique.
Analyse sémantique
L’analyse sémantique est une technique qui permet d’analyser le sens d’un texte. La notion de “sens” est centrale, lorsque l’on fait référence à la sémantique. Contrairement à l’analyse syntaxique, l’enjeu n’est pas d’analyser la structure grammaticale d’une phrase, mais bel et bien les intentions, les ressentis et les émotions qui dictent le sens d’un message. L’analyse sémantique s’intéresse au “fond”, c’est-à-dire au sens des mots22. C’est une technique proche de l’analyse lexicale, mais au lieu de se faire au niveau des mots, l’analyse se fait sur la sémantique des phrases pour déterminer le sens des écrits. Comme pour l’analyse lexicale, l’analyse sémantique peut être utilisée pour analyser toutes formes d’écrits.
Discours
Le terme « discours » n’est pas nouveau et c’est un terme polysémique par excellence. Il peut designer « le propos que l’on tient », ou « un développement oratoire fait devant une réunion de personnes. » (Le nouveau Robert). Cela n’empêche pas qu’il puisse également être un écrit, comme; Le discours de la méthode de Descartes.
C’est utile de dire, bien avant les sophistes grecs et les grands orateurs romains, on a déjà̀ commencé à s’interroger sur les fonctions du discours, sa conception ainsi que son énonciation, que les philosophes classiques prenaient pour la « rhétorique ». Le discours est un terme à̀ la fois historique et d’actualité́.
Il façonne notre vie privée ainsi que notre vie collective, et il devient politique lorsqu’il porte l’organisation de la société́ et le fonctionnement du pouvoir.
20 (Tamba, I. (2005). La sémantique d’hier à aujourd’hui : les strates de l’histoire. Dans : Irène Tamba éd., La sémantique (pp. 7-46). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France).
21 Barthes Roland. Éléments de sémiologie. In: Communications, 4, 1964. Recherches sémiologiques. pp. 91135; doi : https://doi.org/10.3406/comm.1964.1029 https://www.persee.fr/doc/comm_05888018_1964_num_4_1_1029 p.132
22 https://blog.smart-tribune.com/fr/analyse-semantique-definition-enjeux , consulté le 5 octobre 2022.
L’émergence de l’analyse de discours à la française dans les années 1970 orientera durablement la recherche vers les genres de discours, notamment les discours politiques et institutionnels, en mobilisant des approches pluridisciplinaires (Utard 2004, Mazières 2005). La consolidation du terme « discours » dans les années 1980 témoigne d’une convergence liée à la formulation de l’objet à étudier.
Le discours en tant que notion renvoie à plusieurs cadres théoriques, en s’arrimant toute fois à un concept fédérateur : l’énonciation23. Le discours présuppose l’articulation entre énoncé et énonciation. La mise en discours est un mécanisme dans lequel ces deux éléments entretiennent une relation de présupposition réciproque : pas d’énoncé sans énonciation et vice-versa.
Toute énonciation constitue un acte qui vise à modifier une situation. Ainsi, le discours peut être envisagé comme œuvrant à la représentation du monde, il est également une forme d’action sur autrui.
Tout en l’englobant dans la langue, on alloue au discours un fonctionnement propre. Et le découpe en grandes familles de discours : le discours religieux, le discours publicitaire, le discours politique. Le fait même de distinguer des types et genres de discours exige des postures analytiques différentes. Dominique Maingueneau distingue plusieurs approches qui peuvent être ainsi résumées : le discours du point de vue de sa visée communicationnelle, le discours didactique.
On peut appréhender le discours en tenant compte de variables historiques, on choisit alors le point de vue de la situation de communication, associée à des secteurs d’activités sociales: c’est ainsi qu’on parle de discours télévisuel, lui-même englobé dans le discours médiatique. On peut encore catégoriser les discours en fonction des lieux institutionnels : l’hôpital, l’école, la famille.
On peut également catégoriser les discours à partir des positionnements idéologiques: le discours socialiste, le discours catholique… (D. Maingueneau,1998). Ainsi, le discours dans sa dimension linguistique, grammaticale et logique serait :
- Le langage mis en action et assumé par un sujet parlant. (C’est la parole au sens saussurien du terme)24.
- Tout énoncé supérieur à la phrase, considéré du point de vue des règles d’enchaînement des suites de phrases.
23 L’énonciation est l’acte individuel de production, d’utilisation de la langue dans un contexte déterminé, ayant pour résultat l’énoncé. » E. Benvéniste, PLG, II, p.80
24 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discours/25859 , cconsulté le 16 juin 2022.
- Ensemble d’énoncés liés entre eux par une logique spécifique et consistante, faite de règles et de lois qui n’appartiennent pas nécessairement à un langage naturel, et qui apportent des informations sur des objets matériels ou idéels. C’est dans ses acceptations que nous utiliserons le terme discours.
Politique
Le mot « Politique » est à la fois masculin et féminin, les deux dérivées provenant d’une même source étymologique : ils se rapportent tous les deux à l’organisation de la vie publique et du pouvoir, au symbole de cette organisation qui est l’État et à sa gouvernance. Cependant, le politique se réfère plutôt à̀ l’aspect conceptuel du terme, tandis que la politique à l’aspect pragmatique. Le politique s’entend par « tout ce qui dans les sociétés organise et problématise la vie collective au nom de certains principes, de certaines valeurs qui en constituent une sorte de référence morale25 » . Or, La politique implique plutôt « la gestion de cette vie collective26»
La politique étant né d’un désir d’organiser la vie sociale des individus vivant en communauté, il en résulte qu’elle prend corps à travers un certain nombre d’activités de régulation sociale : réguler les rapports de force en vue de maintenir ou d’aplanir certaines situation de domination ou de conflit, et même tenter d’établir des rapports égalitaires entre les individus ; légiférer pour orienter, à travers la promulgation de lois et de sanctions, les comportements des individus pour préserver le bien commun ; distribuer et repartir
les taches, les rôles et les responsabilités des uns et des autres, à travers la mise en place d’un système de délégation plus ou moins hiérarchisé (par nomination ou élection). Ces trois modes de régulation montrent bien que la politique est un espace qui dépend des espaces de discutions et de persuasions (Charaudeau, 2005).
Le discours politique
Dans ce cadre le concept « discours politique », est inhérent à la vie dans la cité, donc à la démocratie. L’ensemble des acceptions du terme, nous donne le droit de dire qu’il y ait deux
25 P. CHARAUDEAU, Le discours politique : Les masques du pouvoir, Limoges, Éditions Lambert- Lucas, 2014, p.33-34.
26 Ibid., p33-34.
éléments essentiels qui en découlent : « parole » et « pensée27 ». C’est d’abord une pratique orale, un acte de langage, un énoncé qui est censé refléter la pensée qui se traduit par des réflexions ordonnées par une certaine logique. Ainsi, une parole prononcée à l’improviste ne doit pas être considérée comme étant un discours, encore moins comme un discours politique, parce qu’il est le produit de l’émotion, qui n’aide pas à̀ concevoir l’objectif à atteindre ni à̀ structurer le discours avec une argumentation
qu’il lui faut. Cela dit, Le discours politique ne se résume pas en une juxtaposition de mots ou des propos tenu dans une situation quelconque. Mais, il se construit à travers des interactions qui ont lieu à̀ l’intersection d’un champ discursif28 et d’un champ politique, qui s’influencent et se conditionnent. Le discours politique est également une forme d’action politique.
C’est « une forme d’action sur autrui29 » qui est conçu et prononcé afin d’influence le comportement. Ainsi, l’acteur politique devient légitime grâce aux postes symboliques auxquels ils accèdent. Cette légitimité lui confère le droit de parler, d’exprimer les valeurs auxquelles il souscrit, pour créer de la résonance parmi les électeurs (citoyens) qui partagent ses mêmes valeurs ou pas.
Il lui reste à convaincre son audience de sa sincérité (dire ce qu’il pense), de sa crédibilité (capable d’honorer la promesse), et de son efficacité (mise en œuvre effective de la promesse). Ce qui n’est pas une mission facile. Selon
P. Charaudeau, il faut que l’acteur politique déploie des stratégies de persuasion, qui consiste en un « parle de soi, à travers l’autre, en parlant du monde30 ». Ces stratégies sont multiples. Ici, nous nous intéressons particulièrement à la persuasion discursive qui est constamment présente dans les discours politique. En effet, il est question du triangle rhétorique Aristotélicienne, à savoir : l’éthos, le pathos et le logos.
________________________
15 https://www.alterpresse.org/spip.php?article1023 ↑
16 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/analyse/3235 , consulté le 08 octobre 2022. ↑
17 Zandrine Zifferey, et al., Initiation à l’études du Sens (sémantique et pragmatique), Auxerre Cedex, éd. Sciences Humaines, 2012, p.13. ↑
18 Zandrine Zifferey, et al., Initiation à l’études du Sens (sémantique et pragmatique), Auxerre Cedex, éd. Sciences Humaines, 2012, p 9-14. ↑
19 https://lesdefinitions.fr/semantique, consulté le 16 juin 2022. ↑
20 (Tamba, I. (2005). La sémantique d’hier à aujourd’hui : les strates de l’histoire. Dans : Irène Tamba éd., La sémantique (pp. 7-46). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France). ↑
21 Barthes Roland. Éléments de sémiologie. In: Communications, 4, 1964. Recherches sémiologiques. pp. 91135; doi : https://doi.org/10.3406/comm.1964.1029 https://www.persee.fr/doc/comm_05888018_1964_num_4_1_1029 p.132 ↑
22 https://blog.smart-tribune.com/fr/analyse-semantique-definition-enjeux , consulté le 5 octobre 2022. ↑
23 L’énonciation est l’acte individuel de production, d’utilisation de la langue dans un contexte déterminé, ayant pour résultat l’énoncé. » E. Benvéniste, PLG, II, p.80 ↑
24 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discours/25859 , cconsulté le 16 juin 2022. ↑
25 P. CHARAUDEAU, Le discours politique : Les masques du pouvoir, Limoges, Éditions Lambert- Lucas, 2014, p.33-34. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que l’analyse sémantique selon l’article?
L’analyse sémantique est définie comme une étude minutieuse pour dégager les éléments qui constituent un ensemble, afin de l’expliquer et de l’éclairer.
Quels sont les paradigmes qui influencent le développement de la sémantique?
Le développement de la sémantique repose sur des paradigmes qui constituent de véritables métaphores de la nature générale du langage, incluant des approches psychologistes, structuralistes et cognitivistes.
Quelle est la différence entre dénotation et connotation en sémantique?
La dénotation concerne le rapport entre un mot et ce qu’il désigne, tandis que la connotation se réfère au rapport entre un mot et son signifié selon certaines expériences et le contexte.