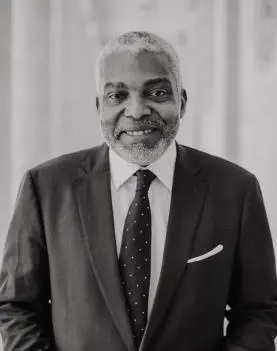Le cadre théorique des normes QSE révèle une lacune surprenante : l’approche impersonnelle des normes ISO 26000 et 31000 ne répond pas aux tensions interculturelles croissantes. Cette étude met en lumière l’impact de la pandémie sur les relations humaines et propose des solutions innovantes pour une meilleure interopérabilité en milieu multiculturel.
- Les innovations manquantes dans les documents de guidage QSE
Qui dit système de management normalisé, dit normes communes et impersonnelles, applicables à l’identique pour tous les pays, quelle que soit leur culture. Ils concernent tous types d’activités et tous types d’organisations.
Entre autres, les aspects de construction du lien social, de la raison et manière d’être y font cruellement défaut.
Il apparait donc que la vocation de L’ISO (international organization for standardization: organisation international de normalisation), est de promouvoir la qualité comme un moteur, un garde-fou, une remorque vers la performance. Il n’y a pas de régime dérogatoire aux principes intangibles en vigueur.
-Une autre approche originale de la qualité, en lien avec les trois sous-systèmes de Le Moigne, est de définir la qualité comme :« Relation d’une unité avec elle-même »8

Relation à la matière | Activité | Vert |
Relation aux éléments constituants | Cohésion | Bleu |
Relation au tout plus vaste | Dynamisme | Rouge |
Ou de manière intentionnelle comme « le rapport entre la raison d’être et l’activité ».
C’est dire que l’entreprise, parce qu’elle doit être le lieu de création et de partage de sa valeur, ne se limite plus seulement à la recherche du profit, mais au renforcement de prise en compte
des enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité. C’est le sens de la loi PACTE9, qui consacre la notion de « la raison d’être », et l’a fait rentrer dans le droit des sociétés. Dorénavant, l’article 1835 du code civil dispose que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels, elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »
- Les points aveugles du système de management normalisé
Les systèmes de management normalisé mis en œuvre par les entreprises, oublient bien des éléments, quelques angles morts identifiés.
Ces systèmes qui sont une manière de faire, ne déborde pas le cadre fixé par l’ISO, ou les domaines d’exigences et laisse de côté la manière d’être. Dit autrement, le poids des procédures et des processus est par trop déresponsabilisant, car il ne laisse pas d’espace pour la créativité et la nouveauté.
Le numérique, l’originalité, le contact personnel, la confrontation des micro-cultures, la dimension intra-personnelle : l’expression verbale (mots, intonation, rythme de la phrase), l’expression comportementale (langage corporel et tactile, distance physique).
Le numérique
La crise sanitaire actuelle conduit à un bouleversement inédit de la relation de travail et au travail. De ce fait et par induction, s’impose une conversion numérique durable, à l’instar de la transition écologique. Objectivement, le monde du travail passe d’un emploi utilitaire du numérique, à un emploi modèle, global et durable, qui malgré tout, maintient le lien et le liant avec l’entreprise. La visio-conférence et les échanges de courriels peuvent-elles remplacer un contact humain chaleureux ?
l’originalité
L’apport particulier (parfois créatif) du collaborateur est négligé (au sens de mal prendre) par la vision des processus. La fidélisation du client passe cependant en partie, par les personnes avec lesquelles il est en contact.
La conformité est également préjudiciable à un apport personnel ou créatif. Ainsi par exemple, dans certains garages-minutes, le devis est appliqué tel quel. Si vous ne savez pas si les bougies9
sont à changer, aucune vérification ou proposition n’est faite. Le processus vise même à éviter le contact entre le client et le mécanicien.
Le contact personnel
Le contact personnel est négligé devant le contrat et les processus, or certaines cultures africaines, latines, méditerranéennes valorisent ces liens, au contraire de la culture anglo-saxonne.
La confiance est un investissement dans les relations et Hampden-Turner10 le souligne : « la qualité d’un produit ne peut être supérieure à celle de l’équipe qui la fournit ».
La confrontation des micro-cultures.
L’idée est de tirer profit de cette diversité pour conquérir de nouveaux marchés et gagner en compétitivité. (écoute, respect et ouverture)
La dimension intra-personnelle.
Elle concerne le souci de chacun, de faire quelque chose de bien, de valable, d’exprimer son être et sa dignité. (sensations, affects, valeurs).
L’expression verbale :
Les mots utilisés, lorsque l’un des collègues a une maîtrise très moyenne de la langue de travail de l’entreprise, peuvent conduire à des malentendus.
L’intonation peut irriter, dans certaines cultures, les gens hausse le ton pour s’exprimer et être persuasif, ce qui peut être considéré comme une marque d’agressivité.
Le rythme de la phrase, trop rapide peut révéler un état de stress ou trop lent, un manque d’assurance, une forme d’hésitation.
L’expression comportementale :
Le langage corporel et tactile, les italiens par exemple, les méditerranéens d’une manière générale agitent beaucoup trop les membres du corps, ont tendance à lier la parole au geste, touchant aussi de temps en temps, pour appuyer un propos, ceci peut être considéré comme invasif et discourtois même.
La distance physique, de même peut poser problème en fonction des cultures, selon que l’on se rapproche ou s’en éloigne.
10 Hampden-Turner, 1994, L’entreprise face à ses valeurs : cartographier les tensions et développer la synergie, EO 1992
Edward T. Hall11, l’appelle distance de fuite, distance critique, en ce qu’elle est un automatisme d’espacement et de survivance, dû à un effet de panique (moyen de protection). Au total, il a recensé dans son ouvrage « La dimension cachée », quatre distances : la distance intime, la distance personnelle, la distance publique, la distance sociale. Avec la crise sanitaire actuelle et l’obligation ou recommandation de garder une distance d’un mètre, tout risque de malentendus et de conflit s’en trouve neutralisé.
De même et inversement, dans certaines cultures, certains hommes se refusent à serrer la main des dames.
- L’apport de « la contingence des pratiques » face au silence de la solution normative
Il a été souligné plus haut, que l’ISO promeut des normes standards, applicables à l’identique partout et en toutes matières. Les limites de cette standardisation apparaissent de manière évidente dans la réflexion présente, car le risque culturel y est absent. C’est dire que, la recherche des recettes ne peut suffire, car ici il n’existe pas d’approche particulière permettant la résolution du conflit culturel. Il va être suggéré de développer un schéma de résolution des conflits, ainsi que les modalités d’implémentation.
Dans ce contexte, la théorie de la contingence fait l’hypothèse, qu’il n’y a aucune méthode universelle ou meilleure manière de gérer une organisation.
Henri Mintzberg12, le principal représentant de l’école de la contingence, affirme que « la structure est liée à la nature de l’environnement, bien qu’elle ne le soit pas de manière mécanique ou déterministe ». L’entreprise dépend dans ce cadre, des buts que se fixent ses dirigeants. Dès lors, les mécanismes régulateurs internes d’une organisation doivent être aussi variés que l’environnement avec lequel, elle doit composer.
Constatant, qu’il n’existe pas d’outil universel s’adaptant à toutes les entreprises et à toutes situations, Mintzberg développe le principe de cohérence pour décrire le fonctionnement interne de l’organisation.
Il fonde son analyse sur l’idée que, c’est la cohérence entre les sous-systèmes qui s’organisent pour maintenir certaines caractéristiques de l’organisation, lui permettant sa régulation.
11 Edward T.Hall, la dimension cachée, Éditions du Seuil
12 Henri Mintzberg, Le management, 1990, (Éditions d’organisations), Le management au quotidien ED Organisations, 1984
- Covid-19, situation de contexte : Avenir du numérique face aux nouveaux usages
Tandis qu’il y a objectivement accroissement de l’usage du numérique, basé sur le télétravail, les commandes à distance et autres choses, une nouvelle grammaire d’utilisation par les entreprises et les administrations se met en place. En France par exemple le télétravail concerne ¼ de travailleurs.
A l’international, toutes les rencontres d’affaires, les conférences, les fora internationaux se font depuis lors via le webinaire.
Le recours excessif et massif aux nouvelles technologies porte en lui-même et de facto, les germes d’un risque culturel futur (technologisme). Il est donc nécessaire de l’anticiper, de le prévenir, en soulignant à grands traits les angles morts et les effets rebond ou paradoxe de Jevons à craindre, du point de vue de l’augmentation de la consommation d’énergie. L’environnement peut dès lors en être gravement impacté.
-Morozov Evgeny13, spécialiste des implications politiques et sociales du progrès technique et du numérique, développe la notion de « solutionnisme technologique » pour expliquer comment chaque problème humain (politique, social, sociétal) est systématiquement transformé en question technique, puis adressé par les acteurs du numérique privés ou les états, avec des solutions numériques traitant les effets des problèmes sans jamais s’intéresser à leurs causes.
Dans son livre « Pour tout résoudre cliquez ici », il nous propose « d’abandonner la notion d’internet et de se pencher sur les technologies individuelles qui le composent »
A ce stade, le télétravail ne deviendra-t-il pas un des principes dans le domaine des exigences normatives ? Quid de la qualité de vie au travail, des relations au travail !
Avoir cette interrogation, c’est admettre l’idée selon laquelle, l’on ne sait pas encore ce que l’on obtiendra à la fin de la crise sanitaire.
La tendance, est le passage progressif d’une utilisation circonstancielle et partiel du numérique pour les activités qui l’exige, à une forme de standardisation et d’utilisation globale. Il deviendra davantage un outil nécessaire aux activités de toute organisation, donnant force aux performances de chaque membre, en dépit de la réduction du contact humain.
13 Evgeny Morozov, Pour tout résoudre cliquez ici, 5 mars 2013, Éditions FYP
- Usage vertueux du numérique : continuité de l’activité
Pendant le confinement, dans certains cas, l’activité s’est poursuivie sans trop de difficultés, pour celles des organisations qui avaient pour modèle économique, l’activité à distance et pas seulement.
C’est un modèle qui est appelé à s’accroitre, car même les résistants à l’utilisation des outils internet ont admis l’importance et la nécessité de ce modèle, réservé autrefois quasi majoritairement aux générations X et Y. Certaines entreprises pour des besoins liés aux coûts de fonctionnement, profiteront de l’effet d’aubaine, en direction d’un basculement vers la numérisation à outrance. Nous assisterons très certainement à une généralisation de la techno-dépendance, ce qui n’est pas sans conséquence sur les relations sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment le cadre théorique des normes QSE influence-t-il la gestion interculturelle ?
Le cadre théorique des normes QSE influence la gestion interculturelle en promouvant une approche de la qualité qui dépasse la simple recherche du profit, en intégrant des enjeux sociaux et environnementaux.
Quels sont les points aveugles des systèmes de management normalisé ?
Les systèmes de management normalisé oublient des éléments tels que la créativité, le contact personnel et la confrontation des micro-cultures, ce qui peut déresponsabiliser les employés.
Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté les relations de travail ?
La pandémie COVID-19 a conduit à un bouleversement inédit de la relation de travail, imposant une conversion numérique durable qui remet en question la capacité des outils numériques à remplacer le contact humain chaleureux.