Le cadre théorique des amnisties révèle des impacts surprenants sur les présumés auteurs de crimes et la société. En examinant les conditions sous lesquelles le droit international des droits de l’homme reconnaît ces institutions, cette recherche offre des perspectives critiques pour comprendre la justice transitionnelle et ses implications.
Section II : Les impacts sur les présumés auteurs de crimes et la société
Les impacts des amnisties et des prescriptions pénales sur les présumés auteurs, les auteurs et la société feront l’objet dans cette section, d’une analyse minutieuse.
Paragraphe I : Sur les présumés auteurs de crimes
Les présumés auteurs des violations des droits de l’homme dans le contexte des CA se retrouvent dans un bon nombre de cas amnistiés ou bénéficient des prescriptions pénales qui, ont des effets non négligeables soit sur leurs condamnation soit sur la suite de leur vie dans la société. C’est pourquoi nous retenons l’effacement de la peine pour l’amnistie et l’oublie de l’acte délictueux au bout d’un temps déterminé par la loi pour les prescriptions pénales.
L’effacement de la peine concerne plus les amnisties que les prescriptions pénales. En effet, nous nous trouvons dans 3 cas distincts. D’abord, lorsque les poursuites contre le présumé auteur des violations n’ont pas encore été déclenché, la mise en œuvre de l’amnistie vient arrêter la possibilité des poursuites.
Dans le deuxième cas, c’est lorsque les poursuites sont en cours et que la décision du juge est attendu pour rendre justice. Dans cette perspective, le prévenu amnistié bénéficiera d’un non-lieu de la part de la juridiction en charge de l’affaire. Ce qui est considéré comme une décision de relaxe.
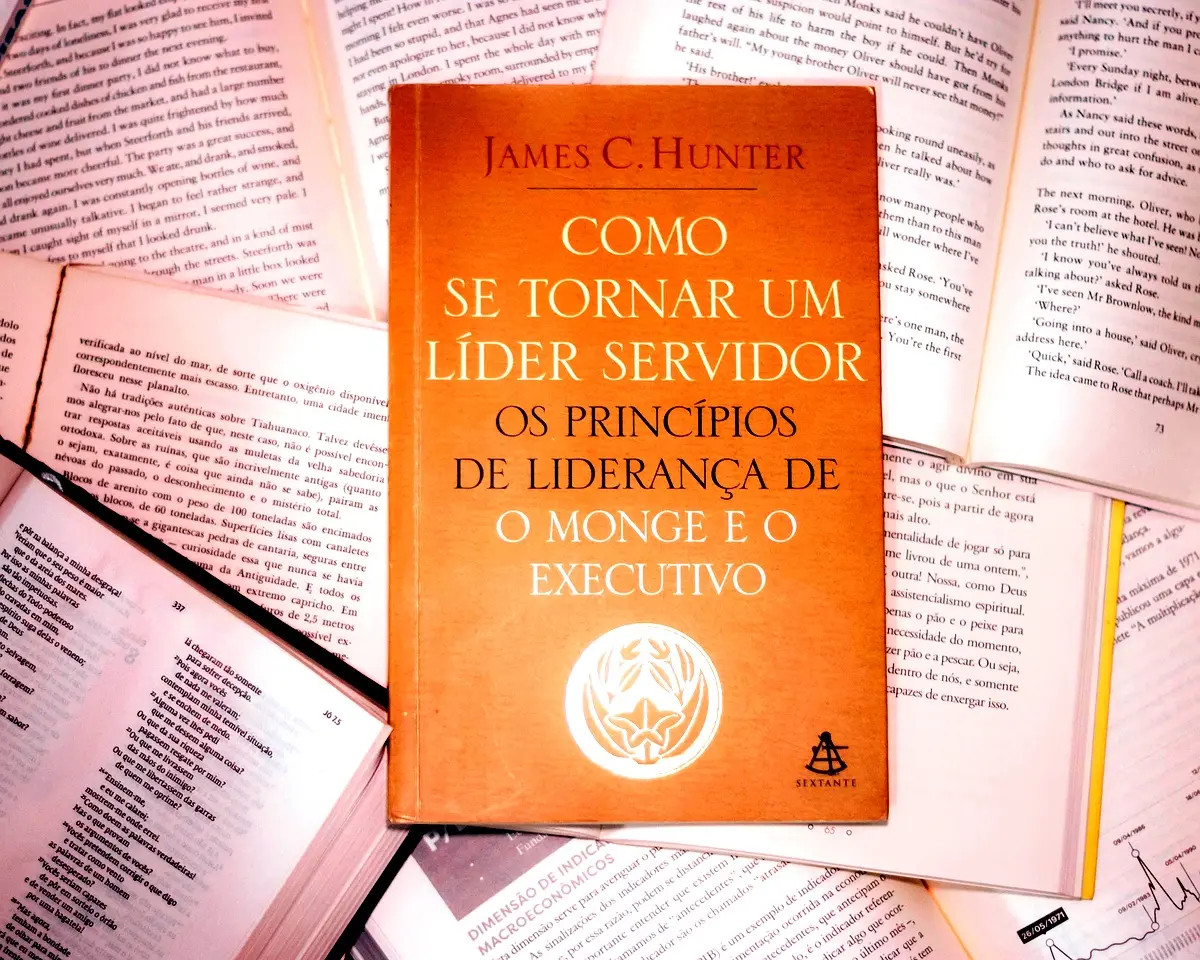
Enfin, si le délinquant avait déjà été condamné pour son acte, la décision d’amnistie vient mettre fin à la condamnation et, les faits pour lesquels il a été condamné ne figureront pas dans son casier judiciaire. Aux termes de l’article 133-9 du CP français, « l’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraine, sans qu’elle puisse donner lieu à la restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablie l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice
du suris qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure. ». Le Conseil constitutionnel français dans une décision ajoute « qu’il est de l’essence même d’une mesure d’amnistie d’enlever pour l’avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappées ; que la dérogation ainsi apportée au principe de la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l’article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l’amnistie »98. Ici, le juge constitutionnel réaffirme l’idée de d’effacer toute peine et poursuite après le vote de la loi d’amnistie.
L’effacement de la peine par la mesure d’amnistie ne donne pas droit à une rétroactivité. En effet, après une condamnation, le délinquant plusieurs avantages, notamment professionnel. Mais, après la loi d’amnistie qui éteint sa condamnation, l’auteur des violations n’est plus en droit de réclamer une réintégration professionnelle. Cet argument est illustré par le CC français en 1988, dans sa décision n 88-244 DC du 20 juillet 1988, lorsqu’il affirme que : « l’amnistie ne comporte pas normalement la remise en état de la situation de ses bénéficiaires ».
En ce qui concerne enfin l’oublie de l’acte délictueux, il concerne les prescriptions pénales car pour ces mesures les peines ne s’effacent pas, mais sont juste oublié. Ainsi, si le présumé auteur commet à nouveau de tels actes, il sera considéré comme récidiviste du fait que son casier judiciaire aura toujours la mentions inculpé pendant une certaine période.
Paragraphe II : Impacts des Amnisties et prescriptions pénales sur la société
Les impacts des amnisties et des prescriptions sur la société sont fondé sur un développement économique et social (B), mais avant et surtout une restauration de la paix (A).
A- La Restauration de la paix
La restauration de la paix est l’un des bénéfices les plus importants que tire la société, des amnisties et des prescriptions pénales. En effet, on peut comprendre la restauration de la paix comme la remise en état stable, l’état d’avant-guerre, la société sur tous les plans.
L’amnistie et la prescription pénale sont deux pratiques qui permettent à la société de bénéficier de cet idéal. La société marquée par des divisions, et le besoin de vengeance des uns sur les
98 Décision 89-258 du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie.
autres fragilise tous les secteurs de la vie et, est incompatible à une vie d’ensemble dans le respect des lois du gouvernement.
Le fait d’effacer ou d’oublier certains crimes, cela permet de stabiliser le pays. Durant la période de la Justice transitionnelle en Afrique du Sud, les dirigeants de la transition ont fait comprendre à la population lors des consultations pour la recherche de la vérité que le droit à la paix est l’un des droits les plus précieux que l’on peut obtenir uniquement si on oubliait les violations des droits du passé, on amnistiait les différents acteurs puisque nécessaire pour la reconstruction du pays, et surtout pour le vivre ensemble.
Au-delà, cette paix est cause de développement notamment dans le domaine économique et social. Quid de ce développement.
Le Développement économique et social
Le développement économique et social est considéré comme la mutation dans les domaines scientifique, sanitaire, social, technologique et démographique que nous pouvons constater sur un lieu donné. A la sortie d’une crise ou ont été perpétrés les crimes les plus graves, il est nécessaire de mettre en place des dispositions favorisant ce développement socio-économique. Ainsi, l’amnistie et la prescription pénale sont deux pratiques permettant à atteindre cette finalité.
Les pratiques d’amnistie et de prescription pénale, comme des institutions qui se fondent sur la réconciliation nationale et la paix durable permettent un développement industriel et un développement par les coopérations.
Le développement industriel nécessite la paix et la stabilité nationale. Les amnisties et les prescriptions pénales en œuvrant sur ces idéaux aident à l’implantation des industries qui elles relèvent l’économie et le social des habitant. Un exemple peut être pris avec l’Afrique du sud qui, pendant plusieurs années à connue des tensions liées à l’Apartheid. A la fin des tensions, des lois d’amnistie et de prescriptions des peines avaient été prises. La conséquence après la prise de ces lois est que ce pays est devenu l’un des plus prospères économiquement et se place de nos jours parmi les pays émergent. La stabilité du pays a permis une industrialisation et le développement des plusieurs secteurs primaires qui a développé le pays.
Enfin, les amnisties et les prescriptions pénales toujours dans l’optique de favoriser la stabilité durable, permet un développement économique et social par la coopération internationale. La coopération internationale est encouragée par l’article 2 du PIDESC en ces
termes : « Chacun des États Parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives. ».
La coopération internationale favorise ainsi la prise en compte des projets économiques par des bailleurs de fond, les prêts par les différentes banques et autres institutions financières internationales. L’exemple le plus palpable en Afrique est celui de la Côte-d’Ivoire qui, depuis plusieurs années après le conflit de 2010 voit la coopération internationale développer son économie touristique.
On peut parler également du plan social mis en place par la cation de ce pays avec l’UE qui permet de construire des écoles et des hôpitaux dans les zones les plus reculées du pays, ce qui change ou du moins développe le niveau de vie social dans ces contré. Avec des enfants qui s’instruisent, des femmes qui accouchent dans des bonnes conditions et des maladies qui peuvent enfin être soignées, ce qui permet de remarquer une hausse importante de l’espérance de vie.
Les amnisties et les prescriptions pénales ont de ce fait un impact considérable sur le développement économique et social de tous les pays détruits par la guerre ou des violences ayant divisées la population.
CONCLUSION
Si les dispositions prévues dans les codes pénaux nationaux règlent dans les détails la discipline des « institutions de clémence » que sont l’amnistie, et la prescription, elles doivent nécessairement être évaluées à la lumière des principes constitutionnels et internationaux en la matière.99
En effet, la pratique des amnisties et des prescriptions pénales qui, remonte à des siècles avant même la mise en place d’une société internationale est toujours présente dans les différents Etats, malgré les tentatives d’exclusion par le DIDH. Ces tentatives qui ont pour but d’empêcher l’impunité ne trouvent pas l’acceptation de tous les Etats, ce qui a pour conséquence une certaine acceptation de ces institutions de clémence en DIDH, bien qu’avec des conditions.
Si le DIDH veut à tout prix bannir les institutions de clémence, ce n’est pas toujours à cause de leur nature mais plutôt de la pratique qui sont fait de ces institutions par les Etat car, on constate de plus en plus que ce sont des institutions qui permettent aux acteurs étatiques de se protéger contre les éventuelles poursuites sur les violations des droits de l’homme dont ils peuvent être à l’origine.
Les fondements social et moral des amnisties et des prescriptions pénales, le but visé dans leur manifestation qui est la réconciliation nationale et la paix durable sont des éléments qui nous ont permis de comprendre leur impact sur la société de manière générale, mais plus particulièrement les auteurs des infractions et les victimes.
Dès lors, quels peuvent être les mécanismes mis en place par le DIDH pour protéger les victimes ?
99 Hélène Ruiz Fabri
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les effets de l’amnistie sur les présumés auteurs de crimes?
L’effacement de la peine concerne plus les amnisties que les prescriptions pénales, permettant d’arrêter les poursuites ou de mettre fin à une condamnation.
Comment les amnisties influencent-elles la société?
Les amnisties et prescriptions pénales contribuent à la restauration de la paix et au développement économique et social.
Quelle est la différence entre l’amnistie et la prescription pénale?
L’amnistie efface les condamnations, tandis que la prescription pénale fait simplement oublier les peines sans les effacer.