Le cadre théorique de la création révèle une crise écologique alarmante, enracinée dans l’anthropocentrisme du christianisme occidental. En s’inspirant de Saint François d’Assise, cette recherche propose des approches novatrices pour rétablir l’harmonie entre l’homme, la nature et le Créateur, avec des implications cruciales pour notre avenir.
CHAPITRE I : LA CRISE ECOLOGIQUE – ETAT DES LIEUX
Introduction
Selon le Pape François, « les réflexions théologiques et philosophiques risquent de devenir un message répétitif et abstrait si elles ne se confrontent pas avec le contexte actuel surtout en ce qu’il a d’inédit pour l’histoire de l’humanité »43. Le souci d’insérer l’Eglise dans le monde contemporain, la constitution pastorale du Vatican II l’avait déjà bien exprimé en ce terme : « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur »44.
Dans la même optique, le professeur Santedi affirme que « parmi les tristesses et les angoisses des hommes qui font monter un cri strident dans l’humanité aujourd’hui, il y a certainement le souci lié à l’avenir de notre terre : le souci de l’écologie »45.
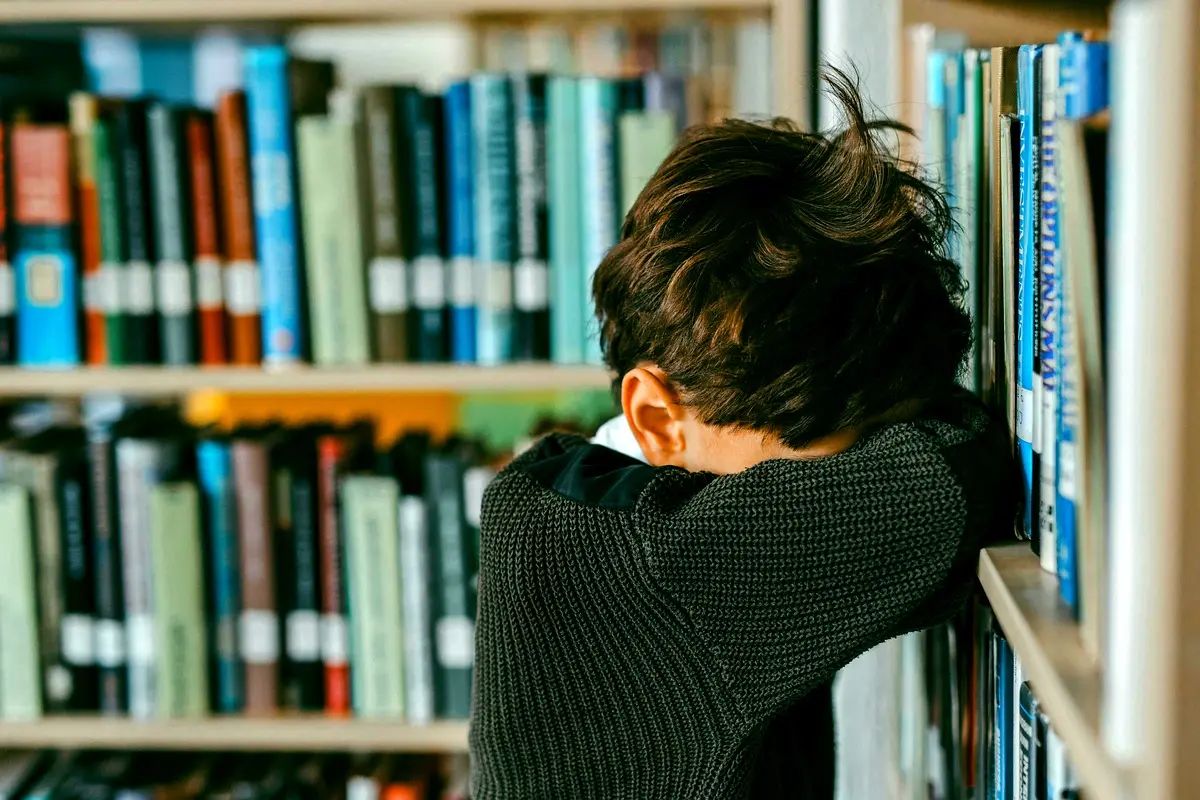
Ainsi, décidément herméneutique et contextuelle, la réflexion théologique sur la création à l’époque contemporaine doit trouver son fondement dans « l’expérience historique de la communauté croyante »46, et au-delà de celle-ci, de « l’ensemble de l’humanité, qui partage la même condition planétaire, celle de fragilisation et d’injustice, laquelle ne peut que conditionner l’accueil de la Révélation et le vécu de la foi »47.
De fait, la situation alarmante de la crise écologique actuelle ne fait qu’accentuer l’urgence de l’implication de tous en faveur de l’harmonie cosmique. C’est pourquoi avant d’aborder la théologie de la création proprement dite, il nous semble pertinent d’explorer le contexte de la crise qui ne cesse de hanter l’esprit des chercheurs tant en science naturelle qu’en théologie.
Aujourd’hui, bien que la prise de conscience soit quasi-totale, les réponses proposées sont loin d’être toutes convergentes et convaincantes.
Ce premier chapitre va nous permettre donc de jeter un regard critique sur la situation de notre milieu naturel qu’est le monde, notre maison commune. Notre investigation nous permettra d’abord de justifier la nécessité de penser aussi théologiquement la crise écologique et sa manifestation multiforme.
Nous chercherons ensuite, après une clarification de quelques concepts de base, à découvrir les manifestations et causes profondes de la crise qui sont essentiellement, des causes anthropiques, tout en épinglant leurs conséquences à court et à long terme sur l’humanité et sur tout le cosmos. Telles sont les préoccupations fondamentales qui guideront notre recherche en ce chapitre premier.
La nécessité de penser théologiquement la crise écologique.
Pour proposer une théologie de la création crédible, il nous semble pertinent d’analyser et de présenter le contexte critique dans laquelle s’épanouit la foi chrétienne aujourd’hui. Comme le dit si bien Claude Geffré, « la théologie devient herméneutique dans la mesure où elle comprend qu’il n’y a pas d’affirmation sur Dieu qui n’implique une affirmation sur l’homme »48.
Ainsi « le théologien ne doit plus se contenter de chercher l’intelligibilité en soi des énoncés scripturaires dogmatiques mais cherche à dégager leur sens pour aujourd’hui »49. A nous yeux, il est nécessaire que l’expérience de la crise écologique actuelle devienne un locus théologicus qui suscite une conscience nouvelle dans la manière de penser l’existence de l’homme en relation avec le monde qui l’entoure.
En fait, il n’est plus un secret pour personne aujourd’hui que l’humanité traverse une époque nouvelle communément appelée « l’âge écologique »50. Selon l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, cette époque se caractérise par la conviction scientifique unanimement admise selon laquelle « nous partageons une histoire commune avec toute la matière cosmique et que nous sommes des enfants des étoiles, les frères des bêtes sauvages et les cousins de jolis coquelicots des champs »51.
En d’autres termes, notre réflexion devra désormais prendre en compte « deux réalité indissociable, à savoir ; ‘l’altérité de la nature et un ‘exister interdépendant avec la nature’ comme des données constitutives pour la réflexion théologique »52. Ainsi, il est devenu inconcevable de penser le salut du genre humain sans le monde naturel qui est indispensable à la survie de l’humanité.
Il faudra dès lors repenser théologiquement les relations que l’homme entretient avec le cosmos en dépassant toutes les ambiguïtés qui ont marqué ces rapports durant les siècles. En effet, « aujourd’hui il ne s’agit pas de défendre la nature à tout prix : ce serait la protéger contre l’homme, ou de la diviniser : ce serait renoncer au progrès de l’homme, sujet moral et politique, mais plus fondamentalement de repenser nos rapports à la nature »53.
Mais avant de commencer notre investigation scientifique, il nous semble pertinent de clarifier les concepts majeurs qui feront objet de notre étude tout ou long de ce chapitre premier de notre travail. Il s’agit de l’écologie comme science et de la crise écologique comme réalité évidente dans le monde contemporain.
Considérée à l’origine comme une discipline biologique, l’écologie s’intéresse aux différents niveaux qui englobent l’individu : population, biocénose, réseau trophique (constitué de chaînes alimentaires), écosystème, biosphère, écosphère. Désormais, les écologues privilégient une analyse systémique et holistique.
Plus récemment, certains tentent d’intégrer l’homme dans le concept d’ « éco-complexe». Écologie, biosphère, biocénose, autant de termes qui nous viennent du XIXème siècle et qui font partie du champ lexical et conceptuel de l’écologie contemporaine.
Cf. P. MATAGNE, Aux origines de l’écologie, dans Innovations, Cahier d’économie de l’innovation, Vol. 2, n° 18, (2003), p. 27. On peut distinguer deux groupes de ceux qui travaillent dans le domaine écologique.
Ils s’agit des écologues sont des spécialistes des interrelations entre les vivants et les écologistes qui s’engagent dans les actions en faveur de l’environnement même si la même personne peut assumer les deux rôles.
Cf. J-M. DROUIN, Ecologie scientifique dans D. BOURG & A.PAPAUX (dirs), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2015, p. 341.
________________________
45 L. SANTEDI KINKUPU, Pour une nouvelle sagesse d’habiter le monde, Editorial de Revue Africaine de Théologie, Vol. 25, n°56, (2004) p.167. ↑
46 L. VAILLANCOURT, La théologie écologique de Gérard Siegwalt, dans Laval théologique et philosophique, 66,2, (2010), p.313. ↑
48 C. GEFFRE, La crise de l’herméneutique et ses conséquences pour la théologie, dans Revue des Sciences Religieuses, tome 52, fascicule 3-4, (1978), p.268. ↑
50 L’historien nord-américain Donald WORSTER définit l’âge écologique comme une époque de l’histoire humaine contemporaine qui se caractérise par la prise de conscience planétaire des conséquences désastreuses de certaines activités humaines sur l’environnement. Cf. D. WORSTER, Les pionniers de l’écologie. Une histoire des idées écologiques, Paris, Sang de la terre, 1992, p.365. ↑
51 R. COSTE, Dieu et l’écologie : Environnement, Théologie, Spiritualité, Paris, Les Ateliers, 1994 p. 17. ↑
52 A. KIM MI-JEUNG, art.cit., p. 85. ↑
53 P. SANDRINE, Courrier de l’environnement de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique), n°31, août 1997. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la relation entre la crise écologique et la théologie de la création ?
La crise écologique contemporaine est présentée comme une conséquence de la rupture des relations entre l’homme, la nature et le Créateur.
Comment l’anthropocentrisme du christianisme occidental influence-t-il la crise écologique ?
Selon la thèse de Lynn White Jr., les racines historiques de la crise écologique sont attribuées à l’anthropocentrisme du christianisme occidental.
Pourquoi est-il nécessaire de penser théologiquement la crise écologique ?
Il est nécessaire de penser théologiquement la crise écologique pour susciter une conscience nouvelle dans la manière de penser l’existence de l’homme en relation avec le monde qui l’entoure.