Les applications pratiques de la cybercriminalité révèlent des défis juridiques inattendus dans le cadre du nouveau Code congolais du numérique. Cette étude comparative met en lumière les failles des dispositifs répressifs français et congolais, offrant des solutions cruciales pour renforcer la lutte contre ce fléau numérique.
DEUXIÈME PARTIE : DE LA RÉPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITÉ EN DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAIS ; ET DE L’ÉTUDE COMPARATIVE DE LADITE REPRESSION ENTRE LES DROITS FRANÇAIS ET CONGOLAIS À L’ÈRE DU CODE CONGOLAIS DU NUMÉRIQUE
La répression de la cybercriminalité est devenue une problématique majeure dans le contexte mondial actuel, où les technologies de l’information et de la communication occupent une place centrale dans les échanges et les interactions humaines. En droit français, la lutte contre la cybercriminalité repose sur une combinaison de lois nationales, de directives européennes et de conventions internationales visant à encadrer la criminalité numérique, assurer la sécurité des systèmes d’information et protéger les données personnelles des citoyens.
En revanche, la République Démocratique du Congo, avec l’adoption récente de son Code Congolais du Numérique, s’efforce de structurer juridiquement sa répression de la cybercriminalité afin de répondre aux enjeux spécifiques du pays.
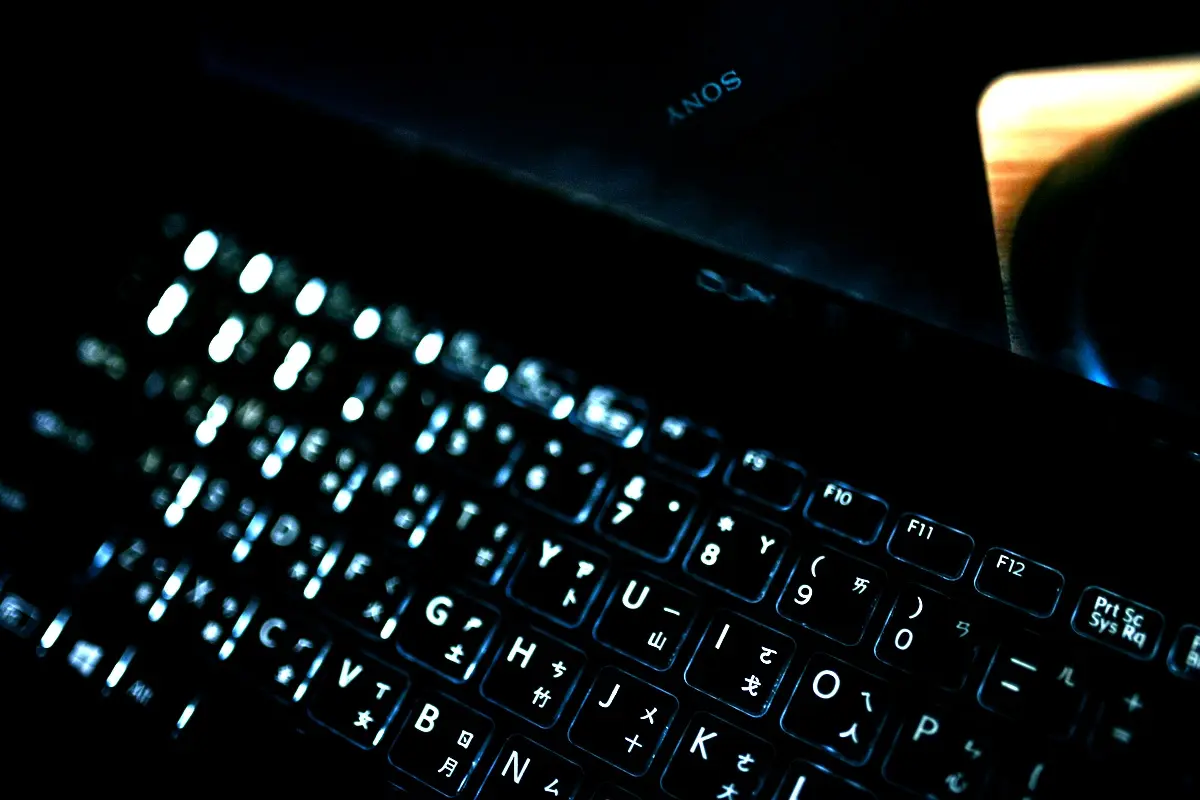
Une étude comparative entre les systèmes juridiques français et congolais met en lumière non seulement les similitudes dans la reconnaissance des infractions cybercriminelles, mais aussi les divergences dans l’application des lois, les modalités de coopération internationale en matière de cybercriminalité.
Ainsi, cette deuxième et dernière partie de notre travail va porter sur : la répression de la cybercriminalité en Droits Congolais et Français (titre 1er) et l’étude comparative de la répression de la cybercriminalité en Droits Français et Congolais à l’ère du code Congolais du numérique.
TITRE 1ER. DE LA RÉPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITÉ EN DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAIS
Dans ce titre, nous allons aborder tour à tour : La répression de la cybercriminalité en droit Congolais à l’ère du code Congolais du numérique (chapitre 1er) ; et la répression de la cybercriminalité en Droit Français (chapitre 2)
CHAPITRE 1ER. DE LA REPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITÉ EN DROIT CONGOLAIS À L’ÈRE DU CODE CONGOLAIS DU NUMÉRIQUE
Ce 1er chapitre de la deuxième partie de notre travail, va étudier respectivement : le cadre législatif de la répression de la cybercriminalité en Droit Congolais, les infractions et les peines (section 1ère) ; et, la procédure ou les moyens d’investigation et de répression de la cybercriminalité à l’ère de code Congolais du numérique (section 2).
SECTION 1ÈRE. LE CADRE LÉGISLATIF DE LA RÉPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITÉ EN DROIT CONGOLAIS, LES CYBERCRIMES ET LES PEINES
La présente section va aborder tour à tour : le cadre législatif de la répression de la cybercriminalité en RDC (paragraphe 1er) ; et les infractions (cybercrimes) et les peines (paragraphe 2).
§1er. Du cadre législatif de la répression de la cybercriminalité en RDC
Le contexte évolutif et le cadre juridique de répression de la cybercriminalité en RDC
Contexte évolutif du numérique en RDC
La RDC est un pays situé en Afrique centrale. Deuxième pays africain par sa superficie, après l’Algérie, il s’étend sur 2.345.409 km167 et partage ses frontières avec neuf autres pays. Sa capitale est Kinshasa. La RDC est un État régionalisé ou autonomique (sur le plan de l’organisation territoriale). Sa langue officielle est le français. Elle est un pays indépendant et souverain168 depuis le 30 juin 1960, indépendance acquise après 52 ans de colonisation belge.
167 NDAYWEL E NZIEM, Nouvelle histoire du Congo : des origines à la République Démocratique, Le Cri- Afrique Éditions Histoire, Bruxelles, 2009, p. 42.
168 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 (Textes coordonnés), JORDC, numéro spécial, 5 février 2011, Article 1er.
Son régime politique actuel étant semi-présidentiel, elle a, à ce jour, connu cinq Présidents de la République et trente-un Premiers ministres. Sa population est estimée à 100 millions d’habitants.
L’histoire du numérique dans ce grand État gravite essentiellement autour du développement des réseaux de communication.169 Successivement, du début de la colonisation (1908) à l’accession à l’indépendance et à la souveraineté internationale (1960), puis de cette dernière à nos jours, la gestion des télécommunications fut caractérisée par une rigidité héritée de l’organisation territoriale centralisée de l’État.
En effet, l’administration coloniale gérait directement la poste et les télécommunications en régie avant qu’un établissement public ne se voie octroyer le monopole d’exploitation du réseau existant. Au début des années 2000, le constat dans ce secteur traduisait une véritable cohue : une défectuosité des infrastructures de l’exploitant public [et détenteur du monopole], une entrée impromptue des opérateurs privés dans le marché et une législation en déphasage avec la transformation numérique et les nouveaux usages.
La naissance et l’évolution
À l’instar des autres États du monde, la RDC a progressivement rejoint la tendance mondiale de la révolution numérique. Ce mouvement s’est traduit par la construction, dès le XXe siècle, d’un secteur des télécommunications dont les débuts furent marqués par les considérations politiques de l’époque (A.1.). Par la suite, ce secteur, caractérisé par un système monopolistique, a difficilement évolué avant de subir la montée en puissance des technologies de l’information et de la communication ainsi que celle du libéralisme dans le monde (A.2.).170
Les débuts du numérique en RDC
169 Il sied de noter qu’il existe trois grands modes de transmission de données à distance : la transmission optique, la transmission filaire et la transmission radio ou par ondes électromagnétiques.
170 KODJO NDUKUMA ADJAYI, Cyber droit : Télécoms, Internet, Contrats de e-Commerce, une contribution au Droit congolais, Presses Universitaires du Congo (PUC), Kinshasa, 2009, p. 77.
Les esquisses du numérique en RDC appellent à cerner, dans un premier temps, le contexte colonial de l’époque et, dans un second temps, le monopole absolu originel).
Le prisme colonial
Vingt-trois ans après la Conférence de Berlin de 1885, la Belgique héritait, elle aussi, d’un empire colonial. Considérant toutefois l’ancien statut de « territoire international » lié au « bassin conventionnel du Congo »171 et la malheureuse expérience de l’aventure léopoldienne, les autorités coloniales avaient pris le soin d’établir une nette distinction entre la métropole et la colonie du Congo. Il demeurait toutefois une question fondamentale : celle de savoir s’il serait possible d’administrer des terres quatre-vingts fois plus vastes que le territoire belge.
En termes de gestion, au « Congo belge », le douloureux souvenir des atrocités commises durant la période léopoldienne avait conduit à la fixation de remparts pour éviter d’autres méfaits. Néanmoins, les réformes adoptées conféraient à la structure de la colonie une forme kafkaïenne.
L’organisation se caractérisait « par une extrême centralisation, non pas sur le terrain, auprès du gouverneur général, mais à Bruxelles, autour du Ministère des Colonies, la nouvelle fonction politique mise en place, en octobre 1908, au sein du gouvernement belge ».172
Un début marqué par un monopole d’État
S’appuyant sur l’administration postale créée en 1885, du temps de l’État indépendant du Congo (EIC), les autorités coloniales renforcèrent les moyens de communication avec l’arrivée du téléphone filaire, de la radiophonie et du télégraphe. Pour mieux réguler ce domaine, l’Ordonnance législative 254/TELEC du 23 août 1940, premier texte réglementaire sur les télécommunications, fut prise par le Gouverneur
171 NDAYWEL E NZIEM, Nouvelle histoire du Congo : des origines à la République Démocratique, Le Cri- Afrique Éditions Histoire, Bruxelles, 2009, p. 42.
172 NDAYWEL E NZIEM, op. cit., p. 345.
général du Congo belge. Ce texte, marqué par la politique économique de l’époque, disposait à l’alinéa 1er de son article 2 : « La colonie a seule le droit d’établir et d’exploiter sur son territoire des voies et des installations des télécommunications de quelque nature que ce soit pour la correspondance publique ».173
L’ordonnance législative de 1940 accordait à l’État le monopole de l’exploitation des télécommunications.174 Cette exploitation s’opérait par voie de régie,175 à travers l’Administration des Postes, Téléphones et Télécommunications (PTT) qui dépendait directement du ministère des Finances.176 Le monopole ainsi défini se fondait également sur le caractère de service public des télécommunications dans ce pays. Toutefois, la colonie pouvait, à travers le Gouverneur général, confier partiellement ou totalement à des tiers, par voie de concession ou d’autorisation particulière, l’établissement et l’exploitation des voies de télécommunications.
Le Gouverneur général disposait également d’un pouvoir d’instruction des commandes visant à autoriser des installations de télécommunications privées et du pouvoir de réglementer l’établissement, la mise en œuvre et l’exploitation des installations. Au demeurant, il pouvait retirer cette autorisation à tout concessionnaire qui contrevenait à ces règles. Notons également que selon la même ordonnance législative, les détenteurs d’installations autorisées ne pouvaient franchir les limites de leurs propriétés sans autorisation du Gouverneur général. Il leur était également interdit de percevoir des redevances, rémunérations ou avantages du fait de leurs activités.
173 Article 2 alinéa 1er, Ordonnance législative 254/TELEC du 23 août 1940, Moniteur congolais, JO RDC, numéro spécial, 25 janvier 2005.
174 Selon l’article 1er de l’Ordonnance législative précitée : « est réputée télécommunications toute communication télégraphique, téléphonique de signe, de signaux, d’écrits, d’image et de sons de toute nature, par fil, radio en autres systèmes ou procédés de signalisation électrique ou visuelle ».
175 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 11e éd., PUF/Quadrige, Paris, 2016, p. 878.
176 Société Congolaise des Postes et des Télécommunications, Qui sommes nous ? [en ligne], Disponible en ligne : http://www.scpt.cd/web , consulté le 12 octobre 2024 ;
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la législation sur la répression de la cybercriminalité en République Démocratique du Congo ?
Le cadre législatif de la répression de la cybercriminalité en RDC est structuré par le Code Congolais du Numérique adopté en 2023, qui vise à répondre aux enjeux spécifiques du pays.
Comment la répression de la cybercriminalité est-elle abordée en droit français ?
En droit français, la lutte contre la cybercriminalité repose sur une combinaison de lois nationales, de directives européennes et de conventions internationales visant à encadrer la criminalité numérique.
Quelles sont les similitudes et divergences entre les droits français et congolais concernant la cybercriminalité ?
Une étude comparative entre les systèmes juridiques français et congolais met en lumière les similitudes dans la reconnaissance des infractions cybercriminelles, ainsi que les divergences dans l’application des lois et les modalités de coopération internationale.