Les applications pratiques du stress révèlent des implications surprenantes sur le système immunitaire. En explorant comment le stress environnemental influence notre santé, cette recherche remet en question des croyances établies et offre des perspectives essentielles pour comprendre notre réponse au stress.
Chapitre II
Concept de stress en biologie
Le stress est souvent rendu responsable de nombreux problèmes physiques ou psychologiques. Chacun d’entre nous a déjà vécu l’expérience du stress et a pu noter son impact sur la mémoire. (Aurélie, 2002).
Suite à un évènement stressant, tel que la détection d’un prédateur, le système nerveux central d’un mammifère s’active rapidement pour répondre physiquement au danger. Plus spécifiquement, lorsqu’un animal détecte un danger, un stimulus sensoriel active l’hypothalamus qui produit des facteurs d’activation de l’hypophyse qui sécrète alors l’Adénocorticotrophine hormone (ACTH), une hormone agissant sur les glandes surrénales. Ce sont ces dernières qui sécrètent les glucocorticoïdes dans le sang, communément appelés hormones de stress. (Gilles et Dominique, 2016).
Définition et historique du stress
Le stress, terme anglais venant de l’ancien français de stresse, correspond à l’ensemble des réponses d’un organisme lorsqu’il est soumis à des pressions ou des contraintes venant de son environnement. (Fanny, 2014).
En d’autres termes, le stress n’apparaît que si l’animal perçoit un danger ou un inconfort. Ainsi, les conditions de logement, des changements d’environnement physique ou social ou des événements ponctuels aversifs survenant dans la vie d’un animal sont autant de facteurs de stress pouvant moduler son activité neuroendocrinienne et de cette façon affecter son système immunitaire (Merlot, 2004).
La notion de « stress » vient du latin « stringere » qui signifie « rendre raide » « serrer » « presser ». Au 14ème siècle, un auteur anglais (R Mannyng) parle déjà du stress. Ce n’est pourtant qu’en 1936 que le professeur (Selye. H) de Montréal, en s’inscrivant dans la lignée de grands physiologistes comme (C. Bernard ou W. Cannon), diffusa ses premières observations sur la réaction d’alarme. Un peu plus tard, en 1948, il exposa le syndrome général d’adaptation avec ses aspects biochimiques et son mécanisme endocrinien. Les psychologues furent pratiquement les seuls à s’intéresser à ces travaux jusqu’à ce que les progrès réalisés dans les domaines de la neuroendocrinologie et de l’immunologie permettent de décrire l’état de stress en termes physiologiques et d’aborder ses mécanismes de façon expérimentale (Gordana, 2009).
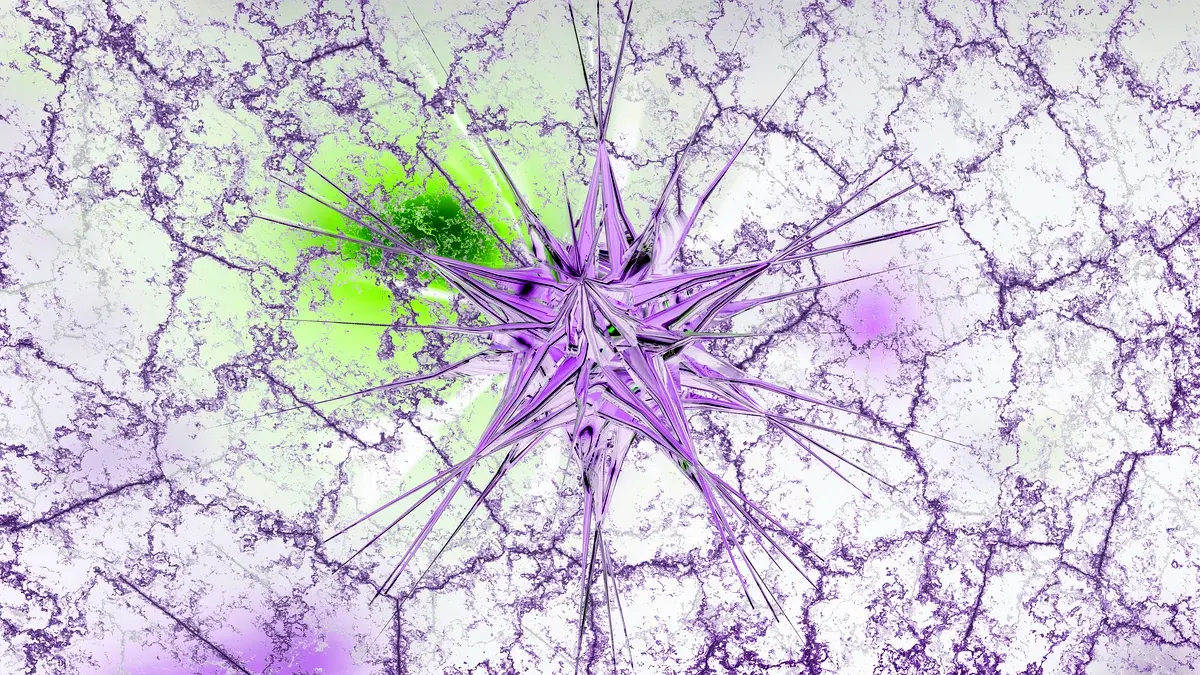
Les facteurs de stress
Ces facteurs peuvent se subdiviser en deux catégories : les stimuli cognitifs et les stimuli non cognitifs.
-Les stimuli cognitifs : sont perceptibles par les organes des sens/ le cerveau. Ils sont de nature psychologique (période d’examen, divorce, veuvage, rupture sentimentale, décès, maladie, licenciement, déménagement) ou environnementale (chaud/froid, agents toxiques, radicaux libres, allergènes …). En 1967, (Holmes et Rahe) établissent une échelle des facteurs de stress psychologiques où les évènements de vie (Gordana, 2009).
-Le concept de stimuli non cognitifs : fut exposé en 1984 par Blalock, et a déjà été brièvement évoqué précédemment. Partant du principe que les cellules immunitaires secrètent le même type de molécules que le système endocrinien et répondent à des messagers communs, Blalock propose que le SI fonctionne comme un organe sensoriel réagissant à des facteurs de stress non reconnus par le système nerveux central (SNC) ou non perçus par les organes des sens « classiques » : il pourrait s’agir d’infections par des virus, des bactéries, de tumeurs, de lésions tissulaires, de dérèglements hormonaux… (Blalock, 1984).
Il existerait ainsi un axe lympho-corticotrope dans lequel les cellules immunitaires jouant les 72 rôles d’organe sensoriel à divers stimuli stressant, permettraient le déclenchement d’une réponse au stress (Gordana, 2009).
Différents types de stress
- Le stress homotypique
Correspondant à un facteur de stress répété toujours de même nature, du stress hétérotypique qui est une combinaison de différents facteurs. Lors de la première rencontre d’un stress homotypique, la réponse de l’axe HPA est maximale puis elle va rapidement et durablement diminuer. Cette désensibilisation, souvent assimilée à une habituation de l’individu à la situation de stress, va se caractériser par une diminution de la libération d’ACTH dans le sang et un retour plus rapide des glucocorticoïdes à leur niveau plasmatique basal. En revanche, le contact avec un stress hétérotypique va renforcer l’intensité de la réponse qui peut perdurer. Ainsi, lorsque des rats sont soumis à un protocole de stress variés et imprévisibles, l’habituation ne s’établit pas (Gaignier, 2014).
- Stress aigu, ou stress occasionnel
Ce type de stress découle d’événements ou de situations spécifiques pour lesquelles l’individu va ressentir une perte de contrôle et qui impliquent des éléments d’imprévisibilité et de nouveauté. Le stress aigu n’est pas nécessairement délétère, puisqu’il stimule la sécrétion d’hormones qui aident à gérer la situation et à rétablir l’homéostasie de l’organisme (Gaignier, 2014).
- Le stress chronique
Venant de l’exposition prolongée et/ou répétée à un ou plusieurs facteurs stressants, est récurrent, plutôt de faible intensité et dont les conséquences sur l’organisme sont de plus grande ampleur et de plus longue durée que celles observées lors d’un stress aigu. Il peut aboutir au stade d’épuisement si l’organisme ne parvient pas à se rééquilibrer. Ses conséquences font donc l’objet de nombreuses études autant chez l’humain que chez les animaux d’élevage ou de laboratoire. Les stress chroniques affectent notamment le système immunitaire, ce qui peut mener au développement de pathologies graves, notamment des pathologies infectieuses ou tumorales (Gaignier, 2014).
- Eustress
Désigne le « bon » stress qui provient des effets physiques et psychologiques des circonstances positives, et dont les résultats sont normalement bénéfiques. On associe l’eustress à la motivation, à l’épanouissement, et à l’amélioration d’une performance quelconque, l’eustress se manifeste notamment lorsqu’on joue à un sport, lors de terminer un projet amusant, lorsqu’on surmonte un défi. On le ressent aussi sur une montagne russe ou lorsqu’on écoute un film horreur. Toutes ces activités nous exigent un certain effort physique ou mental, mais ils provoquent en même temps une excitation qui peut accentuer la motivation et la créativité [2].
Les étapes de la réponse au stress
Les réponses aux facteurs de stress ou environnementaux menaçants, mettent en œuvre des mécanismes d’adaptation centraux et périphériques, qui sont coordonnés par le processus du stress dans le système nerveux central : SNC (cible de la perception du stress), et par ses composants périphériques : l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), le système nerveux autonome (figure 04).
Les principales voies impliquées dans les effets du stress sur la réponse immunitaire à médiation cellulaire et humorale, correspondent à l’activation directe de l’axe corticotrope (CRH, ACTH) avec la libération de glucocorticoïdes, mais également une activation du système sympathique périphérique (figure 04). En plus de la libération du Corticotropin-releasing Factor (CRH), de l’adrénaline et de la noradrénaline, certains médiateurs périphériques sécrétés (les enképhalines, les endomorphines, la substance P et le neuropeptide Y) pendant le stress affectent aussi la réponse immunitaire (Bousta-Er, 2001).
Figure 04 : Médiateurs biologiques des réponses de stress
(Moisan et Le Moal, 2012).
Selye (1956) a élaboré un modèle théorique le « Syndrome Général d’Adaptation » (SGA) qui précise qu’à la suite d’un stress, l’organisme a pour objectif de rétablir l’homéostasie. Il a pu montrer que lorsque l’équilibre homéostatique est perturbé par une demande environnementale, l’organisme réagit toujours par une double réponse. la première est spécifique et correspond à une réponse propre aux demandes environnementales, tandis que la deuxième est non spécifique car elle est identique en toutes situations.
Cette dernière est une réponse innée et stéréotypée qui se déclenche d’elle-même dès que l’homéostasie est perturbée. Ainsi peu importe que l’agent stressant soit d’origine physique ou psychique, interne ou externe, objectif ou subjectif, plaisant ou déplaisant, la réponse non spécifique, physiologique, humorale et endocrinienne, sera toujours la même (Célérier, 2002).
Le Syndrome Général d’Adaptation (SGA) comprend trois phases :
- Phase d’alarme
La phase d’alarme, également appelée phase de choc, qui peut durer de quelques minutes à 24 heures. Lors d’une exposition soudaine à un choc, l’organisme va tout faire pour s’adapter à la situation et met en place des phénomènes généraux non spécifiques. Ce type de stress provoque une réaction immédiate (une dizaine de secondes) du SNS, et une réaction différée (une dizaine de minutes) de type neuroendocrinien. Les modifications biologiques observées (augmentation des fréquences cardiaque et respiratoire, redistribution du sang vers les muscles, stimulation de la glycogénolyse, de la gluconéogenèse et de la lipolyse…) sont principalement liées à la libération des CA (Galinowski et Lôo, 2003).
- Phase de résistance
Au cours de laquelle l’organisme tente de s’adapter à la situation pour rétablir l’homéostasie. La résistance vis-à-vis de l’agent stressant impliqué s’accentue, mais en même temps l’organisme devient plus sensible à l’influence d’autres agents stressants. Cette phase d’adaptation fait intervenir l’axe HPA, activé à partir du NPV (Jaksimovic, 2009).
- Phase d’épuisement
Si le stress persiste, l’organisme s’épuise à force de fonctionner à plein régime. La colère, la dépression ou le sentiment d’impuissance apparaissent. Le corps ne peut plus compenser les dépenses énergétiques, les défenses immunitaires faiblissent et fragilisent l’individu face aux attaques extérieures. Les mécanismes de défense active arrivent à saturation ce qui peut conduire au développement de maladies (ulcères, maladies cardio-vasculaires, HTA, asthme, troubles gastro-intestinaux…) voire même dans certains cas extrêmes à la mort (Jaksimovic, 2009).
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que le stress environnemental ?
Le stress environnemental correspond à l’ensemble des réponses d’un organisme lorsqu’il est soumis à des pressions ou des contraintes venant de son environnement.
Comment le stress affecte-t-il le système immunitaire ?
Le stress modifie l’activité neuroendocrinienne et peut affecter le système immunitaire en réponse à des facteurs de stress tels que des changements d’environnement physique ou social.
Quels sont les types de facteurs de stress ?
Les facteurs de stress se subdivisent en deux catégories : les stimuli cognitifs, perceptibles par les organes des sens, et les stimuli non cognitifs, qui ne sont pas reconnus par le système nerveux central.