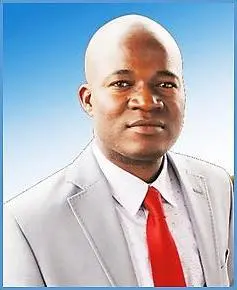Les applications pratiques du séchage révèlent des résultats surprenants sur la cinétique de séchage du rachis du palmier raphia hookeri. Cette étude met en lumière l’impact des conditions de séchage, offrant des insights cruciaux pour optimiser les procédés industriels.
– Micro-ondes
1.4.1- Configuration d’une installation micro-ondes
Une installation micro-ondes est constituée de 2 éléments:
- le générateur avec son alimentation ;
- l’applicateur.
Le générateur micro-ondes ou magnétron est un tube électronique hyperfréquences qui, à partir d’un courant électrique 50Hz, utilise la modulation de vitesse pour transformer un faisceau continu d’électrons émis à la cathode vers une anode concentrique, en une onde électromagnétique (Vialard-Goudou A, Maupas P, Carlier A, Mothiron JC, 1976).
L’applicateur est la surface conductrice nécessaire au confinement des ondes (four, enceinte, cavité, cage de Faraday, guide d’ondes). Il doit assurer une distribution stationnaire des champs électriques et magnétiques adaptée au produit en question (Berteaud AJ, Delmotte M, 1993).

L’applicateur est la structure dans laquelle se trouve le produit à traiter.
Il est conçu de manière à ce que le maximum d’énergie micro-ondes soit absorbé par le produit et à éviter toute fuite d’énergie micro-ondes vers l’extérieur.
Il existe deux grands types d’installation micro-ondes selon le type d’applicateur, monomode ou multimode :
- dans le cas d’une installation de type monomode (voir figure 2), le transport de l’énergie rayonnée par le magnétron se fait grâce à des conducteurs creux appelés guides d’ondes. Dans la continuité du guide d’onde se trouve le produit à sécher.
A la sortie d’un guide d’onde monomode, il n’existe qu’un seul mode de propagation de l’onde. La répartition du champ électrique est parfaitement calculable et celui-ci se trouve dans un plan défini connu.
Un guide monomode peut fonctionner suivant deux principes:
en ondes progressives. L’énergie micro-ondes non consommées par le matériau est absorbée par une charge à eau. L’applicateur fonctionne sans onde de retour ;
en ondes stationnaires. Une plaque métallique, en bout d’enceinte, induit une réflexion totale des ondes non absorbées. On parle alors de cavité résonnante.
[4_applications-pratiques-du-sechage-du-raphia-hookeri_2]
Figure 2 : Schéma simplifié d’une installation micro-ondes monomode
progressive (Xavier Gauthier 1977).
s’il existe plusieurs modes de propagation de l’onde à l’intérieur de l’applicateur, celui-ci est dit multi-mode. Il est dans ce cas difficile de connaître la répartition spatiale instantanée du champ électromagnétique. La propagation des ondes s’effectue dans toutes les directions de l’espace, l’objectif étant de créer un champ de micro-ondes distribuées avec la meilleure répartition possible dans le volume du produit.
Les installations industrielles sont de type multimode.
– Cinétique de séchage et courbes caractéristiques
1.5.1- Introduction
Le séchage consiste à diminuer l’activité de l’eau des produits sèches jusqu’à une valeur assurant leur conservation. Le processus doit respecter certains critères de qualité lies au produit tout en garantissant, pour la chaine de production, une cadence et un cout raisonnable. De nombreux modelés mathématiques empiriques ont été élabores pour rendre compte de la cinétique de séchage en couche mince des produits végétaux et cela pour divers produits tels que le poivre vert, le haricot et la courge verte (O. Yaldiz, & al., 2001), les abricots (T.I Togrul, D. Pehlivan, 2002, R. Al Hodali, 1997), l’Eucalyptus globulus (M. Kouhila & al., 2002), la menthe, la verveine, et la sauge (M. Kouhila, 2001), la pistache (A.Midilli, & H. Kucuk, 2003a, A Midilli, 2001), fruit du cactus (S Lahsasni, & al.,2004a), la carotte, les feuilles de menthe, les tranches du potiron et tomate (I. Doymaz, 2004, I. Doymaz, 2006 et I. Doymaz, 2007a et 2007b), les feuilles de Citrusaurantium (L. Ait Mohamed, & al., 2005) et des tartes d’olives (N. A. Akgun, & I.Doymaz, 2005).
Le but de mener une étude de l’influence des différents paramètres tels que la température sur le processus du séchage et déterminer les courbes caractéristiques de séchage, nous avons étudié la cinétique de séchage du palmier raphia hookeri.
1.5.2- Modélisation des cinétiques de séchage
1.5.2.1- Courbes de séchage
On entend par courbes de séchage soit les courbes représentant les variations de la teneur en eau X en fonction du temps t, soit celles donnant la vitesse de séchage en fonction du temps t ou de la teneur en eau.
La courbe obtenue expérimentalement s’obtient en suivant l’évolution de la masse humide du produit Mh en cours de séchage par pesées successives jusqu’à atteindre la teneur en eau finale X indice :
𝑿(𝒕) = 𝑴𝒉−𝑴𝒔
𝑴𝑺
(1.1)
La masse sèche Ms du produit, est obtenue à la fin de chaque essai.
Cette courbe contient l’ensemble des informations expérimentales. (M. Belahmidi, & al. 1993 et B. C. Boutaleb, 1997).
Pour chaque produit, il est possible de définir une valeur optimale de X fin pour laquelle le produit ne se détériore pas et garde ses qualités nutritionnelles et organoleptiques (forme, texture, odeur et huiles essentielles) (T. Rocha Mier, 1993, S. Dwivedi, & al. 2004 et Encyclopédie d’épices, 2007).
L’installation et les conditions de séchage doivent impérativement permettre d’atteindre cette valeur optimale d’humidité.
1.5.2.2- Modèle de séchage
La modélisation des courbes de séchage solaire consiste à définir une fonction vérifiant l’équation : X* = f (t) dite équation caractéristique de séchage.
On a relevé dans la littérature une abondance de modèles mathématiques sous forme de relations empiriques ou semi-empiriques pour décrire les courbes de cinétiques de séchage.
Les diverses équations donnent l’évolution au cours de séchage de la teneur en eau déduite en fonction du temps. Ces équations contiennent des constantes qui sont ajustées pour concorder par les courbes expérimentales de séchage. Par conséquent, elles sont valables seulement dans le domaine d’étude expérimentale pour lequel elles ont été établies (S. Lahsasni, & al. 2004b et 2004c et S. Simal, & al. 2005).
1.5.2.3- Paramètres statistiques utilisés
Le coefficient de corrélation (r) est l’un des critères pour analyser la précision de l’équation qui décrit les courbes de séchage.
En plus de r, les paramètres statistiques ki-carré réduits (𝑥2) et l’erreur systématique moyenne ESM sont utilisés pour étudier la précision du lissage (T. L. Togrul, & D. Pehlivan, 2003 [33]). Ces paramètres statiques sont calculés comme suit :
∑𝑵 (𝑿𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊−𝑿̅𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊)∗(𝑿𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊−𝑿̅𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊)
𝒓𝟐 = 𝒊=𝟏
(1.2)
√∑𝑵
(𝑿
−𝑿̅
𝟐 √∑𝑵
(𝑿
−𝑿̅
)𝟐
𝒊=𝟏
𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊
𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊) ∗
𝒊=𝟏
𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊
𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊
avec :
𝑿̅
= 1 ∑𝑁 𝑿
(1.3)
𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊
𝑁 𝑖=1
𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊
𝑿̅ = 1 ∑𝑁 𝑿
(1.4)
𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊 𝑁 𝑖=1 𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊
et :
∑𝑁
(𝑿
2
−𝑿
𝑥2 =
𝑖=1
𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊
𝑑𝑓
𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆;𝒊)
(1.5)
𝐸𝑆𝑀 = √1 ∑𝑵
(𝑿
− 𝑿
)𝟐
(1.6)
𝑁 𝒊=𝟏 𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊 𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊
ou :
𝑿𝒆𝒒𝒆𝒙𝒑,𝒊 est la ième teneur en eau expérimentale d’équilibre,
𝑿𝒆𝒒𝒑𝒓𝒆,𝒊 est la ième teneur en eau d’équilibre prédite par chaque modèle,
N est le nombre de point expérimentaux et 𝑑𝑓est le degré de liberté de régression du modèle (𝑑𝑓 = 𝑁 − 𝑛 où n désigne le nombre des constantes de chaque modèle.
1.5.3 – Modèle de courbes caractéristiques de séchage
La méthode a été proposée et développée par D. A. Van Meel en 1958. Le modèle
CCS n’est valable que pour des échantillons non massifs et a couche mince permettant de négliger les gradients de diffusion. Plusieurs auteurs (A. Belghit & al. 2000, N. Kechaou, 2000, A. A. El-Sebaii, & al. 2002 et C. Ertekin, & O. Yaldiz, 2004) ont exploite la notion de (CCS) dans le but de déterminer l’expression de la vitesse de séchage d’un produit.
Les mesures expérimentales permettent d’obtenir un ensemble de courbes de séchage. La courbe caractéristiques de séchage (CCS) représente la vitesse de
séchage normée par rapport a la vitesse de séchage dans la première phase en fonction de la teneur en eau réduite (X(t)-Xeq)/(X0-Xeq).
avec :
X(t) teneur en eau a l’instant t (% MS) X0 teneur en eau initiale (% MS)
Xeq teneur en eau à l’équilibre (kg eau /kg MS) donnée par la relation de G.A.B:
𝑋𝑒𝑞
= 𝐶∗𝐾∗𝑋𝑀∗𝑎𝑤
(1−𝐾∗𝑎𝑤)∗(1−𝐾∗𝑎𝑤+𝐶∗𝐾∗𝑎𝑤
(1.7)
C et K sont deux constantes de G.A.B définies par :
𝐶(𝑇) = 𝐶0
∗ exp (𝐻𝑚−𝐻𝑛) (1.8)
𝑅𝑇
où : ∆𝐻1 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑛
𝐾(𝑇) = 𝐾0
∗ exp (𝐻1−𝐻𝑛) (1.9)
𝑅𝑇
où : ∆𝐻2 = 𝐻1 − 𝐻𝑛
C0, K0 constantes
H1 enthalpie de condensation de la vapeur d’eau pure (kJ.mol-1)
Hm enthalpie intégrale de sorption des premières molécules d’adsorbat sur tous
les sites primaires (kJ/mol)
Hn enthalpie intégrale de sorption des couches d’eau supplémentaires (kJ.mol-1)
R constante des gaz parfaits (J /mol.K) T température (K)
XM teneur en eau a la saturation de la monocouche de Brunauer (kg eau. (kg MS)-1)
Il faut noter que la teneur en eau d’équilibre Xeq est déduite des isothermes de désorption du produit (B.Touati & al. 2006 et 2007.
Conclusion du chapitre I
Les études et investigations réalisées antérieurement, ne nous offrent pas une solution intégrale sur l’effet des conditions de séchage sur la cinétique de séchage du rachis du palmier raphia hookeri.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Comment fonctionne une installation micro-ondes pour le séchage du raphia hookeri?
Une installation micro-ondes est constituée d’un générateur et d’un applicateur, où le générateur transforme un courant électrique en une onde électromagnétique, et l’applicateur confine ces ondes pour sécher le produit.
Quels sont les types d’installations micro-ondes utilisées pour le séchage?
Il existe deux grands types d’installation micro-ondes : monomode et multimode. Les installations monomodes utilisent des guides d’ondes pour le transport de l’énergie, tandis que les installations multimodes permettent une propagation des ondes dans toutes les directions.
Pourquoi est-il important d’étudier la cinétique de séchage du palmier raphia hookeri?
L’étude de la cinétique de séchage vise à diminuer l’activité de l’eau des produits pour assurer leur conservation tout en respectant des critères de qualité et en garantissant une cadence de production raisonnable.