Les applications pratiques du droit numérique révèlent des disparités surprenantes entre les systèmes juridiques français et congolais en matière de cybercriminalité. Cette étude comparative met en lumière les défis critiques et propose des solutions innovantes pour renforcer l’efficacité des dispositifs répressifs dans un contexte en constante évolution.
- Edmond Mboloko Elima, « l’étude comparative de la répression de la cybercriminalité en droits Congolais et Français »17
Dans ce travail, l’auteur part d’une inquiétude résidant dans la question de savoir s’il existait un système de répression de la criminalité informatique dans les deux législations, c’est-à-dire procéder à l’étude minutieuse des mécanismes juridiques prévus en droits Français et Congolais pour la lutte et l’éradication du fléau à caractère nouveau que l’on nomme : « la cybercriminalité ».
Cet auteur constate que les technologies de l’information et de la communication apportent bel et bien des changements dans les sociétés partout dans le monde. Elles améliorent la productivité des industries, révolutionnent les méthodes de travail et remodèlent le flux de transfert des capitaux, en les accélérant. Cette croissance rapide a également rendu possible des nouvelles formes de criminalités liées à l’utilisation des réseaux informatiques, appelées cybercriminalité, cyber banditisme, cyber délinquance, criminalité de hautes technologies ou criminalité des NTIC.
Au regard des considérations comparatives de la répression de la cybercriminalité en droits français et Congolais, l’auteur soutient qu’en
17 Edmond MBOLOKO ELIMA, l’étude comparative de la répression de la cybercriminalité en droits Congolais et Français, mémoire de licence en Droit, faculté de Droit, département de Droit privé et judiciaire, Université de Mbandaka, 2014 ;
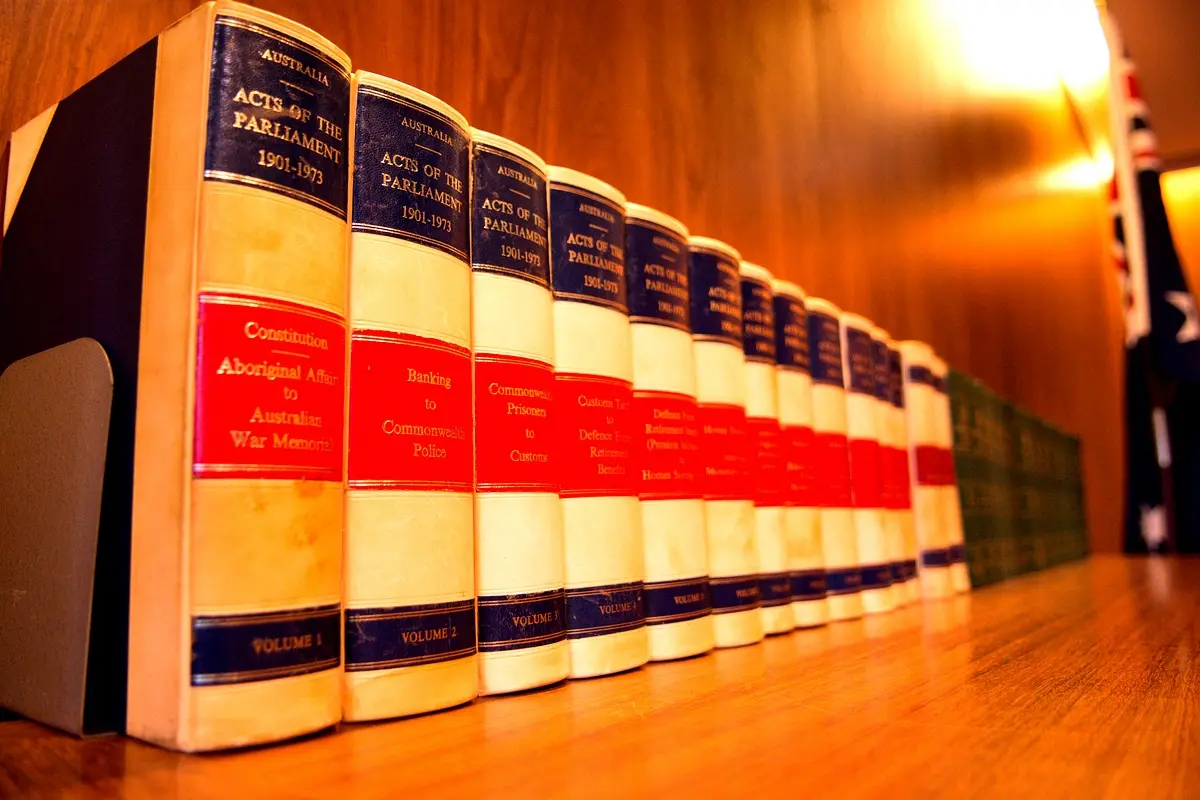
Droit Français, le législateur a trouvé des solutions pour l’éradication de la cybercriminalité depuis les années 1978, notamment en adoptant la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en insérant quelques articles dans le code pénal Français. Ensuite, la loi Godfrain du 05 janvier 1988 relative à la fraude informatique, insérant à son tour quelques articles dans le code pénal Français. Par ailleurs, la France fait partie de la convention européenne sur la cybercriminalité du 28 Novembre 2001, ainsi que les diverses lois en la matière.
L’auteur souligne que le droit français réprime les infractions ontologiques de la cybercriminalité, notamment les infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques ; les infractions informatiques, les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits voisins. Hormis ces infractions, mentionne l’auteur, le code pénal Français, réprime également quelques infractions facilitées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), c’est-à-dire les infractions de droit commun ou de nature traditionnelle.
Nous partageons le même avis que l’auteur, lorsqu’il argue que sur le plan organisationnel, la France est dotée des plusieurs organes chargés de lutter contre la cybercriminalité tant au niveau national qu’à celui international.
L’auteur continue en signalant que la législation Congolaise relative aux NTIC était composée à l’époque (en 2014), d’une loi, la loi nº 13/2002 du 06 octobre 2002 sur les télécommunications et d’une ordonnance nº 87/243 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l’activité informatique au Zaïre. Par ailleurs, cette législation réprimait six
(6) infractions ontologiques de la cybercriminalité, qui apparaît inappropriée, inadaptée et trop rudimentaire à la réalité évolutive des NTIC. Face à cette déficience juridique, renchérit l’auteur, certaines dispositions du code pénal congolais et ainsi que d’autres lois particulières ont été retenues à titre des infractions des infractions
facilitées par les NTIC. L’auteur rappelle également l’inexistence en droit Congolais des toutes les règles de coopération internationale contre la cybercriminalité, la non adoption des nouvelles lois capables de régir les NTIC et leurs criminalités, la non adhésion à la convention européenne sur la cybercriminalité, l’inefficacité des sanctions en vigueur en droit pénal Congolais ainsi que l’insuffisance des organes chargés contre ce fléau.
Nous nous accordons avec l’auteur, lorsqu’il conclut que, comparativement au Droit Français, le droit pénal Congolais accuse son inefficacité à réprimer la cybercriminalité, ce qui fait appel à un système efficient.
Contrairement aux études sus analysées, la présente étude se veut d’étudier comparativement la répression de la cybercriminalité en Droits Français et Congolais à l’ère du Code congolais du numérique.
Le relevé des études antérieures sur le thème de recherche étant fait, nous passons maintenant aux choix et intérêts que revêt cette étude.
Dans un travail scientifique, il parait parfois très difficile à tout chercheur, des domaines confondus, d’énoncer les raisons qui l’auraient poussé à opter pour tel ou tel autre sujet de travail. C’est le choix du sujet. Mais, à coté de ce choix encore faudra-t-il préciser ou déterminer l’apport que le travail fait en faveur de la science, la société contemporaine et celle future. C’est l’intérêt du sujet. Nous allons démontrer les raisons motivant notre option pour ce sujet dans un premier temps et l’intérêt y rattaché au second.
Dans le cadre de ce travail, nous avons opéré notre choix sur le sujet dont le contenu a été énoncé ci-haut, parce que nous avons fait un constat selon lequel à l’ère actuelle, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, au-delà de leur côté bénéfique, aident aussi à la commission d’une catégorie d’infractions ; à savoir : les infractions en ligne ou numérique ou encore informatiques et celles
facilitées par les NTIC. Cette cybercriminalité prenant de plus en plus de l’ampleur, les différents Etats du monde ont pensé à sa répression. La faiblesse ou l’insuffisance de cette répression et le souci d’une répression efficace ont rendu opportune, la présente étude.
Ce travail présente un intérêt sur un tripe aspect.
Sur le plan personnel, nous avons opté pour ce sujet parce que, d’une part, étant un être humain et habitant cette terre, nous nous sommes senti être premièrement concernés par ce mal social qui déstabilise la vie humaine et celle de notre société.
D’autre part, nous avons estimé utile de faire nos premiers grands pas dans la recherche scientifique dans ce domaine, ce qui va nous permettre d’améliorer ou de compléter nos connaissances en droit des NTIC ou le droit numérique, en droit pénale et en criminologie. Nous même, aspirant à emboiter les pas de nos maitres criminalistes et criminologues.
Sur le plan social et/ou pratique, ce travail se voulant d’étudier comparativement en droits Congolais et Français, la répression de la cybercriminalité à l’ère du code Congolais du numérique, va alors résoudre un problème pratique ou social. Ceci, en ce sens qu’il va proposer des solutions qui pourront servir de soutien à la formulation de politiques :
- L’étude pourra aider les décideurs congolais à améliorer leur cadre législatif en matière de cybercriminalité.
- Sensibilisation : Éduquer le public et les professionnels du droit sur les enjeux de la cybercriminalité et les protections disponibles dans chaque pays.
- Renforcement des capacités : Identifier des modèles de bonnes
pratiques et des mécanismes de coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité.
Sur le plan scientifique, le choix de ce sujet pour nous dans cette étude, après mise aux points de toute la problématique y afférente, va permettre à tout chercheur des domaines juridique et numérique d’obtenir ou d’acquérir des capacités essentielles en vue de perpétuer cette étude de la répression de la cybercriminalité à l’ère du code Congolais du numérique, dans les jours à venir.
Notre souci est aussi celui de permettre aux autres chercheurs dans la matière d’avoir des connaissances efficaces, qui à leurs tours, leurs permettront de prendre en considération les autres aspects nouveaux que notre étude n’aurait peut-être pas pu développer ou analysé. Bref : Enrichir le corpus de recherches sur le droit numérique en Afrique et en particulier en RDC.
Comme tout chercheur, après avoir trouvé notre objet de recherche pour une bonne orientation, nous devons poser des questions constitutives de l’objet principal de notre recherche avant de proposer des solutions, ces sont la problématique et les hypothèses.
A en croire Marcous Bindungwa Ibanda, « la problématique désigne la partie de l’introduction générale qui pose le problème traité dans le travail sous forme d’un questionnement. Sans se réduire à cette interrogation, elle est toute une organisation littéraire autour de celle-ci ».
De son côté, le professeur Shomba Kinyamba soutient que, « la problématique désigne l’ensemble de questions posées dans un domaine de la science en vue d’une recherche des solutions scientifiques. Présenter la problématique signifie répondre à la question : Pourquoi avons-nous besoin de réaliser la présente investigation et de connaitre les résultats probables ».19
18 Marcous BINDUNGWA IBANDA, Comment élaborer un travail de ftn de cycle ? contenu et étapes, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2008, p.34 ;
19 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de recherches scientiftques, P.U.K, Kinshasa, 2006, p.41
La problématique, c’est l’ensemble construit, autour d’une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui permettront de traiter le sujet choisi.20
La présente étude a le souci d’étudier la répression de la cybercriminalité à travers le prisme du Code Congolais du numérique, en analysant le cadre juridique relatif à la cybercriminalité en France et en République Démocratique du Congo ; évaluer l’efficacité des dispositifs de répression prévus par le Code Congolais du numérique en les comparant à ceux du droit français ; identifier les défis et les failles dans l’application de la législation sur la cybercriminalité en RDC ; pour proposer enfin des solutions pour une amélioration.
La cybercriminalité représente un défi de plus en plus complexe pour les systèmes juridiques nationaux et internationaux, en raison de la nature transnationale et évolutive des technologies numériques. Le Code Congolais du Numérique, récemment adopté, vise à répondre aux menaces croissantes liées aux infractions commises en ligne. Cependant, l’efficacité de ce cadre juridique reste à évaluer, notamment par rapport aux standards internationaux, tels que ceux applicables en France, qui possède une législation plus ancienne et régulièrement mise à jour pour contrer ces nouvelles formes de criminalité sur internet. Ce code tant espéré pour réguler ce secteur, ne répond cependant pas à l’attente de la population.
Ne pouvant guère laisser ce fléau évoluer ainsi à grand pas, nous avons voulu apporter notre contribution dans la résolution du problème à travers cette réflexion thérapeutique axée sur ces questions :
- Dans quelle mesure le Code Congolais du Numérique permet-il de réprimer efficacement la cybercriminalité à l’ère numérique, et comment se compare-t-il aux dispositifs juridiques prévus par le droit français en matière de lutte contre la criminalité en ligne ?
20 Michel Beaud, L’art de la thèse, comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat et tout autre travail universitaire à l’ère du Net, Éditions La découverte, édition révisée, mise à jour et élargie, paris, 2006, p. 55 ;
- Comment le cadre juridique congolais a-t-il évolué pour prendre en compte les nouvelles formes de criminalité numérique ? La France, avec des lois plus anciennes et une expérience plus large dans la lutte contre la cybercriminalité, constitue-t-elle un modèle de référence pour le Congo ?
- Les sanctions prévues par le Code Congolais du numérique sont-
elles suffisamment dissuasives et adaptées à la nature évolutive de la cybercriminalité ?
Après avoir posé les questions constitutives de la problématique de notre étude, nous allons maintenant y répondre d’une manière provisoire et anticipative en termes d’hypothèses.
Du grec, hypothesis, l’hypothèse désigne une proposition provisoire offerte en réponse à un problème donné, et qui attend d’être vérifiée par une démonstration expérientielle ou une argumentation doctrinale pour confirmer son assertion.21
En effet, « l’Hypothèse est envisagée comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche ».22
Pour le professeur Shomba Kinyamba, « l’Hypothèse est une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bienfondé ».23
En revanche, une hypothèse étant une proposition initiale à partir de laquelle on construit un raisonnement ; c’est donc une supposition ou une éventualité. C’est ainsi qu’à partir des questions posées dans la problématique, nous allons émettre des réponses éventuelles et provisoires dans les paragraphes qui suivent.
21 Jonas SHAMUANA MABENGA, Pédagogie de la recherche scientiftque et de la rédaction des travaux de ftn des cycles universitaires, 2ème édition, Éditions presses Africaines du savoir (EDIPAS), Kinshasa, 2017, p. 294 ;
22 Pierre Felix KANDOLO, Méthodes et règles de rédaction d’un travail de recherche en Droit, éditions universitaires européennes, Paris, 2018, p.50 ;
23 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, op.cit., p.50.
Comme réponse à la première question, bien que le Code Congolais du Numérique représente une avancée significative, il est encore en phase de développement et doit être perfectionné pour répondre aux défis complexes de la cybercriminalité. Contrairement à la France, qui a une longue expérience dans la régulation des activités numériques, le cadre congolais manque de certains mécanismes essentiels, tels que la coopération internationale, la protection des données personnelles, et des dispositifs de répression adaptés aux nouvelles formes de cybercriminalité (ransomwares, phishing, cyberterrorisme, etc.).
Deuxièmement, le Code Congolais du Numérique pourrait avoir été largement influencé par des modèles juridiques étrangers, notamment le droit français et les instruments internationaux comme la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Il serait pertinent de vérifier si cette influence a été bien intégrée dans le contexte juridique, social et économique congolais, ou si des ajustements sont nécessaires pour assurer son efficacité locale.
Troisièmement, même avec un cadre juridique adéquat, la mise en œuvre de la répression de la cybercriminalité en RDC est entravée par des limitations institutionnelles et capacitaires (manque de formation des magistrats, d’agents spécialisés, ou de ressources techniques). Contrairement à la France, qui dispose de structures spécialisées (comme l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information – ANSSI), la RDC pourrait être confrontée à des défis pratiques dans l’application de la loi. Les sanctions prévues par le Code Congolais du numérique ne pourraient être dissuasives aussi longtemps qu’elles ne sont pas fortes comme c’est le cas en droit Français.
Après avoir répondu provisoirement aux questions constitutives de la problématique de notre travail, il y a lieu pour nous de décrire les méthodes et techniques utilisées dans la rédaction de ce travail, c’est la méthodologie.
La méthodologie est selon le professeur Boris Barraud ; « la science de la méthode ou le discours sur la méthode ».24
A en croire Jean Louis Bergel : « la méthodologie est une étude des méthodes scientifiques et techniques, de procédés utilisés dans une discipline déterminée ».25
Estimant que : « aucune recherche n’est bonne, s’il existe un mauvais départ sur les méthodes utilisées, Pierre Félix Kandolo enseigne qu’un travail de recherche doit déterminer la (les) méthode(s) ayant servi à la démonstration de résultats ». C’est ainsi que nous allons dans les 2 (deux) sous-points, définir et déterminer les méthodes et techniques utilisées dans ce travail.
Le concept « méthode » est différemment défini par les auteurs. Selon Jean Louis Bergel : « la méthode est un cheminement. Elle est conçue comme un enchaînement raisonné des moyens en vue d’une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat ».26
De son côté, Boris Barraud définit la méthode comme « un ensemble ordonné des principes, des règles, d’étapes, qui constituent un moyen pour parvenir à un résultat ; ou encore un ensemble de règles qui permettent l’apprentissage d’une technique, d’une science ».27
Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour les méthodes exégétique et sociologique d’une part et celle comparative d’autre part. La méthode exégétique consiste à chercher la volonté, la raison d’être, ce que le législateur a voulu dire. Comme le dit le professeur Hilaire Kabuya Kabeya Tshilobo que : « la méthode exégétique recherche non seulement le sens du texte mais plutôt, l’esprit de la loi dans le texte
24 Boris Barraud, La recherche juridique, sciences et pensées du Droit, Édition l’Harmattan, Collection Logiques juridiques, Paris, 2016, p. 167 ;
25 Jean Louis Bergel, Méthodologie juridique, Ed. P.U.F, Paris, 2001, p.17 ;
26 Jean Louis Bergel, Loc.cit ;
27 Boris Barraud, Op.cit, P.167 ;
lui-même appuyé par les documents qui l’ont préparé (travaux préparatoires) ».28
Cette méthode nous a permis d’analyser ce que la loi dit par rapport à la cybercriminalité, objet de notre étude. Nous avons ainsi analysé les dispositions de la convention européenne sur la cybercriminalité ou la convention de Budapest, la loi française nº 2024- 449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ; l’ ordonnance loi nº 23/010 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique, le code pénal Français, et tant d’autres lois spécifiques en la matière
La méthode sociologique nous a permis de recourir aux cas concrets qui se posent sur terrain pour s’imprégner de la réalité de l’application des règles de droit. Donc, de faire la comparaison entre la teneur de la loi sur la répression de la cybercriminalité et la procédure à suivre pour y parvenir ainsi que la manière dont elle est appliquée. Ce qui nous a permis de déceler les vrais problèmes et difficultés que rencontrent les destinataires de la loi en vue d’imaginer les autres solutions par voie de réformes législatives.
Nous avons également utilisé la méthode comparative. Cette méthode, définie par Reuchelin comme une démarche cognitive par laquelle on s’efforce à comprendre un phénomène par confrontation des situations différentes29 ; nous a permis de confronter les textes légaux Français et Congolais pour en dégager les points de ressemblance et dissemblance.
Une technique de recherche est un ensemble de procédés limités, ordonnés, mettant en jeu des éléments pratiques et concrets, adaptés à un but précis et défini, permettant à l’investigation soit de
28 Hilaire KABUYA KABEYA TSHILOBO, Introduction générale à l’étude du Droit, contexte africain et congolais, Medias Paul, Kinshasa, 2018, p.223
29 Michel REUCHELIN, Les méthodes en psychologie, 3ème édition, P. U.F., Paris 1973,
p. 25 ;
choisir une portion d’individus, d’objets, de mesure parmi la population mère en étude ; soit de rassembler les informations sur un sujet donné.
Pour pierre Félix Kandolo, « la technique est un mode opératoire prouvé, bien établi, précis et reproductible. Elle décrit dans le détail les opérations nécessaires à l’entretien non directif et à la discussion des groupes ».30
Dans le cadre de ce travail, la technique documentaire nous a servi de base préconçue d’instrument. Car, elle nous a permis de réaliser l’investigation minutieuse et une collecte des données à travers les sources documentaires diverses en rapport avec notre thème de recherche (ouvrages, revues, journaux, articles, mémoires et autres documents).
Nous avons également utilisé la technique d’interview libre qui nous a permis d’entrer en contact avec les différentes personnes chez qui nous avons eu des informations recherchées.
Après avoir déterminé les méthodes et techniques utilisées pour la rédaction du présent travail, place maintenant à sa délimitation spatio-temporelle.
Délimiter un sujet, c’est préciser à la fois non seulement les cadres chronologique et géographique, mais aussi les cadres conceptuel et thématique.
Délimiter une étude comparative sur la répression de la cybercriminalité n’est pas facile. La cybercriminalité au-delà du fait qu’elle est la nationale, elle est non seulement transnationale mais surtout mondiale. Elle n’épargne aucun Etat du monde.
Qu’à cela ne tienne, nous allons tant soit peu circonscrire notre travail sur deux territoires : le territoire Français et celui Congolais.
30 Pierre Félix KANDOLO, Méthodes et règles de rédaction d’un travail de recherche en droit, Ed. Universitaire Européenne, 2018, P.264
Dans le temps, notre travail se voulant d’étudier comparativement la répression de la cybercriminalité en Droits Français et Congolais spécifiquement à l’ère du code Congolais du numérique ; part de 2023, année de la promulgation et la publication au journal Officiel de l’ordonnance loi nº 23/010 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique à 2024, l’année de la promulgation de la loi Française nº 2024-449du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ; et du 21 mai 2024 à ce jour.
Hormis l’introduction générale et la conclusion générale, ce travail est subdivisé en deux grandes parties subdivisées chacune en deux titres, chaque titre en deux chapitres, le chapitre en sections, la section en paragraphes, le paragraphe en points et le point en sous-points.
Ainsi, voici le plan sommaire de ce travail
Première partie. Des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de la cybercriminalité
Titre 1er. Des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Chapitre 1er. L’analyse conceptuelle et le contenu des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Chapitre 2. L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication
Titre 2. De la cybercriminalité
Chapitre unique La cybercriminalité, la légalité des incriminations, peines et procédure ainsi que l’application de la loi pénale
Chapitre 2. La répression de la cybercriminalité en droit Congolais à l’ère du code Congolais du numérique
Deuxième partie. De la répression de la cybercriminalité en Droits Français et Congolais ; et de l’étude comparative de la répression de
la cybercriminalité en Droits Français et Congolais à l’ère du code Congolais du numérique
Titre 1er. De la répression de la cybercriminalité en Droits Congolais et Français
Chapitre 1er. La répression de la cybercriminalité en droit Congolais à l’ère du code Congolais du numérique
Chapitre 2. La répression de la cybercriminalité en Droit Français
Titre 2. De l’étude comparative de la répression de la cybercriminalité en Droits Français et Congolais à l’ère du code Congolais du numérique
Chapitre 1er. Cadres juridiques et procédure comparés
Chapitre 2. Les infractions spécifiques et les sanctions comparées
La conception d’un tel travail n’est pas chose facile, surtout lorsqu’il s’agit d’une première tentative. Le caractère inadéquat du calendrier académique ainsi que les surcharges d’horaire en fin d’année dans une promotion terminale n’ont eu pour effet que l’aménuisement du temps consacré à ce travail. Une autre difficulté est due à la constitution d’une documentation nécessaire étant donné que la cybercriminalité ne fait pas encore l’objet des plusieurs publications scientifiques en République démocratique du Congo.
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux défis de la législation congolaise sur la cybercriminalité?
L’article souligne l’inexistence de règles de coopération internationale contre la cybercriminalité, la non adoption de nouvelles lois régissant les NTIC, et l’inefficacité des sanctions en vigueur en droit pénal congolais.
Comment la France a-t-elle évolué dans la lutte contre la cybercriminalité?
Le droit français a trouvé des solutions pour l’éradication de la cybercriminalité depuis les années 1978, notamment avec l’adoption de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que la loi Godfrain de 1988.
Quelles infractions sont réprimées par le droit français en matière de cybercriminalité?
Le droit français réprime les infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques, ainsi que les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits voisins.