Les applications pratiques des amnisties révèlent des enjeux cruciaux pour la justice internationale. Cette étude met en lumière comment le droit international des droits de l’homme, tout en reconnaissant certaines amnisties, rejette les prescriptions pénales, redéfinissant ainsi le cadre de la responsabilité pour les violations des droits humains.
D- INTERET DE L’ETUDE
A propos de l’intérêt du sujet, François Depeltaeu écrivait : « Le choix d’un sujet est un acte purement objectif. Il va de soi que ce choix se fasse en fonction de l’expérience passée et de la personnalité du chercheur »15. Ainsi, notre sujet peut être perçu sous un double intérêt. D’abord scientifique (A), ensuite sociale (B).
12 Voir, par ex., M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, collection « Les voies du droit », Paris, PUF, 1986 (nouv. édition en 2004, collection « Quadrige »), p. 81.
Selon l’auteur, « le temps qui passe dénoue parfois querelles et conflits, apaise les tracas, les tensions, la souffrance même, d’un moment. Oubli de la colère et du ressentiment, il peut être aussi oubli des preuves – usure du temps sur la mémoire des témoins, la qualité des écrits et « pièces à conviction » diverses.
La sagesse du droit est de le reconnaître par tout un jeu de règles techniques. Le temps qui passe efface parfois le droit qui se dessaisit lui-même lorsque le temps passé a entraîné l’oubli (…) ».
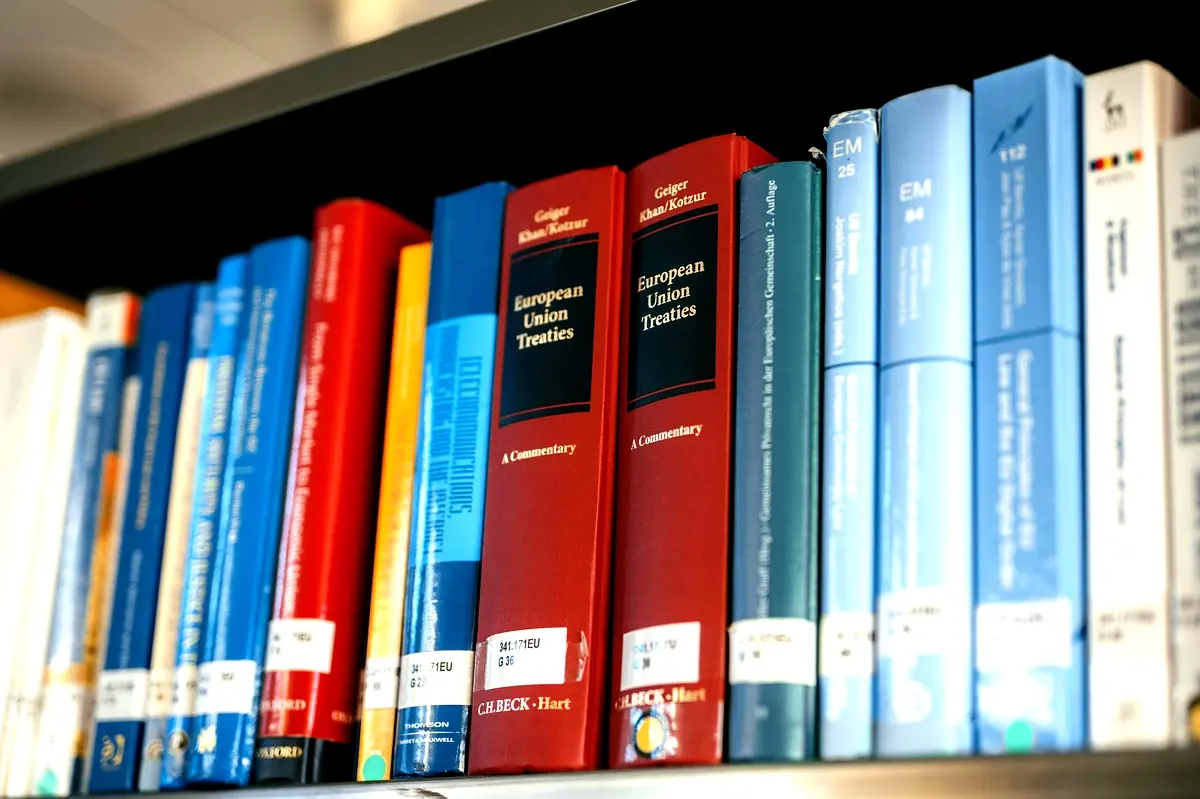
13 Voir, à titre d’exemple, les jurisprudences belges (Conseil d’ Etat belge, avis D.P., chambre 1963- 1964, n°861/1, p.2, cité par P. de MERTENS, L’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité : étude de droit international et de droit pénal comparé, Bruxelles, Ed. De l’Université de Bruxelles, 1974, p. 39 : « la prescription n’est pas une faveur que la loi accorde aux condamnés mais une mesure d’intérêt social qui n’ouvre pas de droits acquis »), française (Cour de Cassation française, Chambre crim., 26 janvier 1984, arrêt Barbie, Bull. Crim., 34 : « le droit à l’acquisition de la prescription ne saurait constituer un droit de l’homme ou une liberté fondamentale ») ou portugaise (Tribunal constitutionnel portugais, 2ème Section, arrêt 483/2002, procès n°565/2001, selon lequel la prescription n’est pas un droit subjectif, Cf. http://w3b.tribunalconstitucional).
14 Hélène Ruiz Fabri, Gabriele Della Morte, Elisabeth Lambert Abdelgawad, Kathia Martin-Chenut, in « INSTITUTIONS DE CLÉMENCE (AMNISTIE, GRÂCE, PRESCRIPTION) EN DROIT INTERNATIONAL ET DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ ». Archives de politiques criminelles ; P.149
15 François DEPELTEAU, La démarche d’une recherche en sciences humaines. De la question de départ à la communication des résultats, Méthodes en sciences humaines, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2000 p.100
Intérêt scientifique
Notre étude intervient au moment où plusieurs travaux et réflexions ont été produits sur les questions d’amnistie et de prescription pénales en DI, et plus particulièrement en DIDH dans le contexte africain. Des auteurs comme Javier CIURLIZZA16, Javier CIURLIZZA17 et bien d’autres ont démontré dans leurs travaux un réel intérêt en ce qui concerne les avantages et les inconvénients des mesures de clémence que sont l’amnistie et la prescription pénale pour les crimes internationaux.
La valeur ajoutée de notre étude consiste à apporter une contribution dans le débat scientifique sur l’influence des mesures de clémence en DIDH. Il s’agit de voir dans quelle mesure les mesures de clémences apportent un changement après un conflit armé dans les pays africains. Sur le plan scientifique, cette étude se situe dans le cadre des dispositions internationales relatives au DIH et au DIP.
Il permet de montrer l’encadrement conventionnel et jurisprudentiel de l’amnistie et de la prescription pénale des crimes. Le droit africain qui a très souvent évoqués séparément ces deux concepts, notre étude a envisagée de les joindre afin de mener une réflexion d’ensemble et nourrir la compréhension scientifique sur ces éléments.
La particularité de notre étude réside dans le fait qu’elle développe de manière jointe les questions d’amnistie et de prescription pénale dans le contexte purement africain. Un autre aspect de notre intérêt scientifique est que notre travail a permis d’offrir aux chercheurs une liste des pays africains ou les mesures de clémences ont eu une influence considérable après des conflits, conflit qui quelquefois a engendré des débats au sein des populations.
Enfin, notre étude a permis de montrer les textes sur lesquels les différents pays s’appuient pour mettre en place ces mesures. Elle pourra également servir à des fins de recherche. Mais aussi, elle servira comme un support d’application pour les instances publiques, organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme.
Qu’en est-il de l’intérêt social ?
Intérêt social
L’intérêt social de notre étude est manifeste dans la mesure où l’application des mesures d’amnistie et de prescription pénale est bénéfique pour la population. En effet, l’amnistie et la prescription pénale sont à la base deux mesures sociales dont le but est de restaurer la paix.
16 J. CIURLIZZA, « Pérou : la défaite juridique de l’amnistie et l’agenda politique en suspens », Mouvements 2008/1 (n° 53).
17 Javier CIURLIZZA Amnistie des crimes de guerre : définir les limites de la reconnaissance internationale, Revue internationale de la Croix-Rouge.
Chère à la cohésion nationale, la paix est un élément qui favorise le développement de la société et des individus. La population visée dans ces institutions de clémences sont d’abord celles qui ont participé directement aux conflits afin de les apaiser, il est donc important de considérer les présumer auteur et les victimes des différentes violations.
Pour atteindre cette fin qui est la paix, il faut que les populations qui, sont un élément fondamental dans l’application des mesures de clémence, adhèrent au projet, par le biais de leurs représentants. Cette contribution permet aussi de faire prendre connaissance de l’existence d’une multitude de conventions internationales et surtout régionales relatif aux conditions d’application des institutions de clémence à la sortie d’un conflit armé ayant occasionné de graves crimes internationaux.
Aussi, cette étude a un intérêt économique puisque, indissociable à la paix, le développement de l’économie est la conséquence d’une stabilité sociale et d’une paix durable. Enfin, cette étude constitue notre contribution à la promotion des Droits de l’homme et plus particulièrement de leur protection à travers le DIDH en Afrique.
________________________
12 Voir, par ex., M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, collection « Les voies du droit », Paris, PUF, 1986 (nouv. édition en 2004, collection « Quadrige »), p. 81. Selon l’auteur, « le temps qui passe dénoue parfois querelles et conflits, apaise les tracas, les tensions, la souffrance même, d’un moment. Oubli de la colère et du ressentiment, il peut être aussi oubli des preuves – usure du temps sur la mémoire des témoins, la qualité des écrits et « pièces à conviction » diverses. La sagesse du droit est de le reconnaître par tout un jeu de règles techniques. Le temps qui passe efface parfois le droit qui se dessaisit lui-même lorsque le temps passé a entraîné l’oubli (…) ». ↑
13 Voir, à titre d’exemple, les jurisprudences belges (Conseil d’ Etat belge, avis D.P., chambre 1963- 1964, n°861/1, p.2, cité par P. de MERTENS, L’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité : étude de droit international et de droit pénal comparé, Bruxelles, Ed. De l’Université de Bruxelles, 1974, p. 39 : « la prescription n’est pas une faveur que la loi accorde aux condamnés mais une mesure d’intérêt social qui n’ouvre pas de droits acquis »), française (Cour de Cassation française, Chambre crim., 26 janvier 1984, arrêt Barbie, Bull. Crim., 34 : « le droit à l’acquisition de la prescription ne saurait constituer un droit de l’homme ou une liberté fondamentale ») ou portugaise (Tribunal constitutionnel portugais, 2ème Section, arrêt 483/2002, procès n°565/2001, selon lequel la prescription n’est pas un droit subjectif, Cf. http://w3b.tribunalconstitucional). ↑
14 Hélène Ruiz Fabri, Gabriele Della Morte, Elisabeth Lambert Abdelgawad, Kathia Martin-Chenut, in « INSTITUTIONS DE CLÉMENCE (AMNISTIE, GRÂCE, PRESCRIPTION) EN DROIT INTERNATIONAL ET DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ ». Archives de politiques criminelles ; P.149 ↑
15 François DEPELTEAU, La démarche d’une recherche en sciences humaines. De la question de départ à la communication des résultats, Méthodes en sciences humaines, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2000 p.100 ↑
16 J. CIURLIZZA, « Pérou : la défaite juridique de l’amnistie et l’agenda politique en suspens », Mouvements 2008/1 (n° 53). ↑
17 Javier CIURLIZZA Amnistie des crimes de guerre : définir les limites de la reconnaissance internationale, Revue internationale de la Croix-Rouge. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les conditions de reconnaissance des amnisties en droit international des droits de l’homme ?
Le droit international des droits de l’homme reconnaît les amnisties sous certaines conditions tout en rejetant les prescriptions pénales pour promouvoir l’imprescriptibilité des crimes.
Quel est l’impact des amnisties sur les victimes et les auteurs présumés de violations des droits humains ?
L’étude examine les impacts juridiques sur les victimes et les auteurs présumés de violations des droits humains.
Comment les mesures de clémence influencent-elles le droit international des droits de l’homme ?
La valeur ajoutée de notre étude consiste à apporter une contribution dans le débat scientifique sur l’influence des mesures de clémence en DIDH, notamment en analysant leur impact après un conflit armé dans les pays africains.