L’analyse de cas sur la cybercriminalité révèle que, malgré l’adoption du Code congolais du numérique en 2023, des failles persistent dans la répression. Cette étude comparative entre les droits français et congolais met en lumière des défis cruciaux, offrant des pistes pour renforcer l’efficacité législative.
Les axes de l’évolution du numérique en RDC : cas du secteur des télécommunications
Durant la seconde moitié du XXe siècle, le secteur des télécommunications a entamé son évolution sous le prisme du monopole ayant prévalu avant 1960. Au vu des nombreuses limites de ce système, une observation diachronique [jusqu’au début des années 2000] de ce secteur permet de retenir deux situations marquantes dans ce processus évolutif.
La persistance du monopole d’État
Les années ayant suivi l’accession de la RDC à la souveraineté internationale ne furent pas de tout répit. L’instabilité politique, d’une part, et les sécessions (Katanga et Sud-Kasaï) et guerres civiles, d’autre part, rendirent le Pays ingouvernable. Dans ce contexte, le Lieutenant- Général Joseph Désiré Mobutu, commandant en chef de l’Armée nationale congolaise, prit le pouvoir le 24 novembre 1965 par un coup d’État qui aboutit à la destitution du premier Président de ce pays, Joseph Kasa-Vubu.
Le nouveau régime s’activa à mettre en place un pouvoir énergique « tranchant avec le laxisme des années précédentes ».177 Dans la foulée, la suppression des partis politiques fut décrétée, le poste de Premier ministre connut le même sort et l’organisation territoriale fut revue. Le fédéralisme céda sa place à une plus grande centralisation en ce que les vingt-deux provinces existantes furent d’abord réduites à douze, puis à huit.
Elles étaient redevenues de simples entités administratives comme au temps colonial.
Le secteur stratégique des télécommunications, alors caractérisé par une bureaucratie excessive, une centralisation extrême du pouvoir décisionnel et une absence d’esprit commercial dans un monde en pleine mutation, n’a pas échappé aux réformes du nouveau pouvoir en place. L’administration des PTT céda sa place à un établissement public dénommé « Office Congolais des Postes et
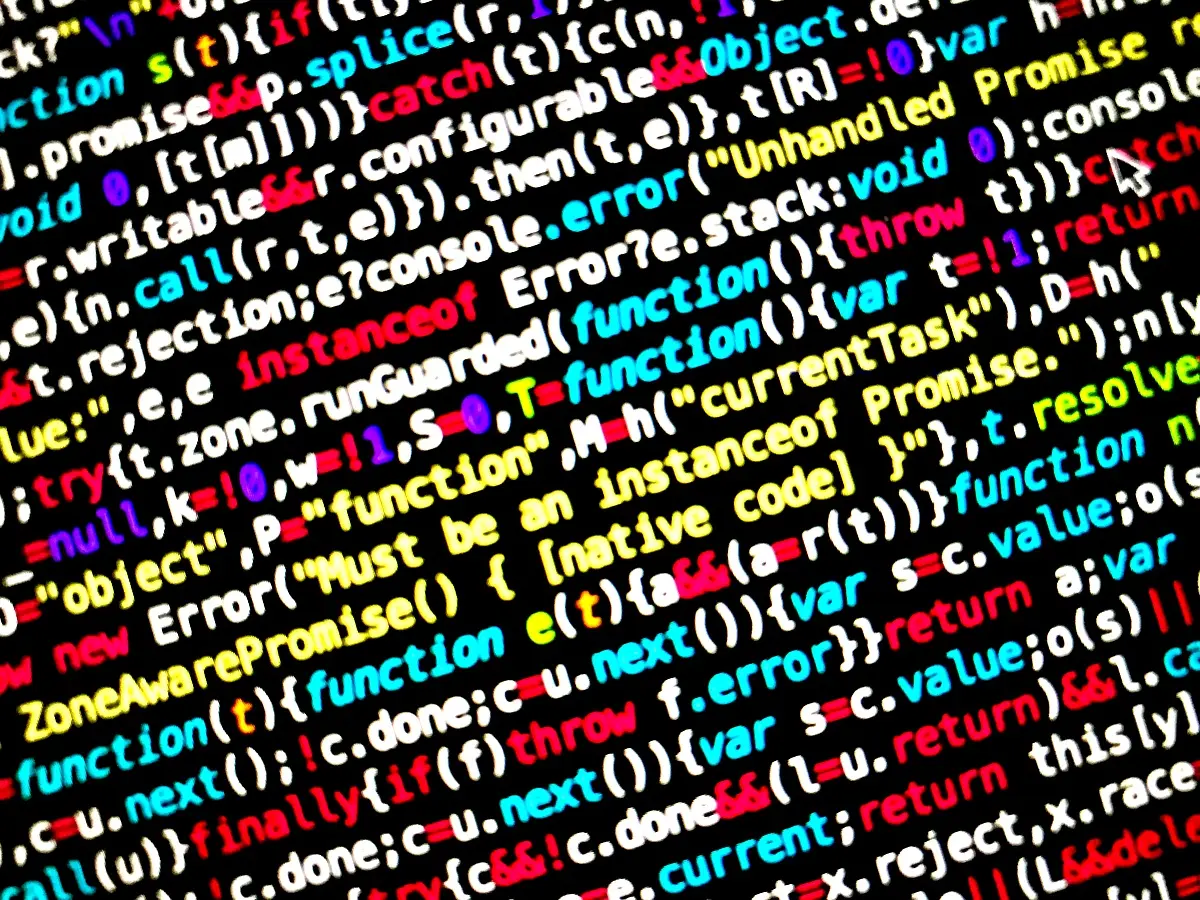
177 NDAYWEL E NZIEM, op. cit., p.504.
Télécommunications178 » (OCPT), créé par l’Ordonnance-loi n°68-475 du
13 décembre 1968. L’OCPT se voyait confier un monopole d’État par l’article 2 dudit texte qui disposait : « l’office est chargé de l’exploitation du service public des postes et télécommunications, à cet effet, il exerce le monopole postal, télégraphique, téléphonique et des signaux et communications par satellites ».179
De facto, l’OCPT exerçait aussi une fonction de réglementation par la tenue des dossiers d’octroi de licences et la gestion des fréquences radioélectriques. Il disposait aussi d’un pouvoir de concession. Qualifié « d’exploitant public », il appliquait « la réglementation aux acteurs privés intervenant dans son champ de gestion à monopole absolu du service public ».180 Logiquement, des royalties lui étaient versées pour les autorisations qu’il délivrait aux détenteurs des installations radioélectriques privées.
Le monopole dans les activités de télécommunications se justifiait, tant il était considéré que celles-ci demeuraient un élément de l’administration publique, au même titre que la poste ou la voirie. La logique monopolistique perdura avec la création d’une autre compagnie d’État, par l’Ordonnance n° 97/240 du 30 Septembre 1991, chargée d’assurer les communications nationales par satellite.
Le Réseau National des Télécommunications par Satellite (RENATELSAT) venait en complément à l’OCPT, en vue de servir à la transmission des programmes de la radio et télévision nationale, de la capitale (Kinshasa) vers les provinces où étaient installées des stations terriennes.
178 De nos jours : Société Congolaise des Postes et des Télécommunications
179 Article 2, Ordonnance-loi n°68-475 du 13 décembre 1968 portant création de l’OCPT, Moniteur congolais, n°3, 1er février 1969.
180 KODJO NDUKUMA ADJAYI, Droit des télécoms et du numérique : Profil africain et congolais, prospective comparée d’Europe et de France, L’Harmattan, Paris, 2019, p. 69.
Les esquisses d’un changement de paradigme : Réforme de l’exploitant public et démonopolisation de fait
La concentration des pouvoirs, qui prévalait depuis 1965, commençait à s’essouffler. La RDC, débaptisée Zaïre (à partir du 27 octobre 1971), était en proie à une grande cacophonie sur le plan organisationnel. Frôlant une apoplexie, les pouvoirs publics réalisèrent que l’organisation centralisée – certes déconcentrée – avait montré ses limites, notamment dans le secteur des télécommunications. C’est ainsi que fut entamée la réforme des entreprises publiques monopolistiques.
L’OCPT, autrefois établissement public, fut reformé en entreprise publique industrielle et commerciale. L’idée était de rapprocher son mode de gestion de celui des entreprises privées pour lui conférer plus d’autonomie. La matérialisation de cette idée se fit à travers l’ordonnance n°78-222 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Office national des postes et télécommunications du Zaïre (ONPTZ). Cette entreprise publique continuait d’exercer le monopole de l’exploitation dans le secteur, avec, notamment, l’ambition de réhabiliter les installations existantes (réseaux, commutations, communications régionales et internationales) et d’investir dans les réseaux locaux. Bien qu’autonome juridiquement, l’ONPTZ était placé sous une double tutelle des Ministères des PTT et du portefeuille.181
Néanmoins, la dichotomie entre les textes et la réalité n’était un secret pour personne. Le monopole de l’opérateur historique accusait bien des faiblesses. Dans le temps, le constat était tel que les ressources financières essentielles à une fourniture adéquate de services faisaient défaut. Cela étant dû à la situation économique désastreuse de l’époque et à la mégestion des équipes dirigeantes qui se sont succédées. Les usagers ne pouvaient donc pas bénéficier d’un service de qualité. Par ailleurs, les rapports entre l’ONPTZ et les ministères de tutelle étaient souvent tendus du fait de leurs animateurs. Cela avait naturellement réduit le pouvoir
181 Article 26, Ordonnance n°78-222 du 5 mai 1978 portant statuts de l’ONPTZ, JOZ n°3, 15 juin 1978, Kinshasa, 19ème année.
d’action de l’exploitant public, désormais dans la difficulté de réaliser ses missions de manière efficiente.
« Le manque de vision et de volonté politique véritable, l’inexistence d’un plan d’ensemble cohérent de développement économique pour le pays, l’insuffisance de programmation des investissements dans le secteur et l’insatisfaction des demandes de plus en plus nombreuses de raccordement au réseau public» appelaient à reformer les choses. Cependant, en lieu et place d’entamer une réforme profonde, les autorités zaïroises choisirent de délivrer des licences de concessions de services publics des télécommunications à des opérateurs privés alors que le monopole d’État demeurait consacré sur le plan textuel.
Les difficultés rencontrées par l’opérateur public n’ont pas échappé aux mutations technologiques des années 1980. À défaut de s’adapter sur le plan juridique, l’exploitant public a été amené, avec une réglementation désuète et incomplète à l’égard des « normes comme les procédures d’agrégation des matériels et des firmes actives dans le domaine des télécommunications », à concéder une partie de son marché.
Ce fut le cas en 1989, avec l’entrée en lice du premier opérateur de réseau mobile privé appelé TELECEL (devenu STARCEL). La société avait obtenu une concession de 30 ans pour exploiter la téléphonie cellulaire dans 25 villes du Zaïre. Elle opérait par la technologie Advanced Mobile Phone System (AMPS) sur la bande de 800 MHz et comptait près de 14000 abonnés sur l’ensemble du territoire, au début des années 2000.
En 1995, une deuxième licence d’exploitation de la téléphonie AMPS fut accordée à COMCELL. Cette société disposait de plusieurs stations terriennes sur le territoire national et comptait 3000 abonnés. Il est à noter que ces deux premiers opérateurs ne répondaient qu’aux besoins de communication des personnes les plus nanties. TELECEL, par exemple, offrait certains de ses téléphones à 2500 $ [environ 2250 €].
Avec le temps, plusieurs faits ont confirmé la démonopolisation progressive qui s’opérait :
- En 1997182 : le Gouvernement désigna la technologie Global System for Mobile Communication (GSM) comme standard officiel du fonctionnement des réseaux mobiles et obligea les deux premiers opérateurs à s’y conformer ;
- En 1998 : une licence GSM 900 était accordée à Congolese Wireless
Network, le premier opérateur de téléphonie GSM (devenu Vodacom Congo, à la suite d’une joint-venture signée avec Vodacom International Ltd, en 2001) ;
- En 2000 : le Gouvernement accorda respectivement une licence
GSM 900 à Celtel Congo , une licence GSM 1800 à SAIT Télécom et une autre à Congo Chine Télécom (CCT)183 ;
- En 2002 : le réseau Vodacom Congo fut officiellement ouvert au
public.
Il ressort de ce qui précède que le secteur des télécommunications et numérique en RDC a connu une démonopolisation de fait.
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment le monopole d’État a-t-il influencé le secteur des télécommunications en RDC ?
Le monopole d’État dans le secteur des télécommunications était justifié par la considération que ces activités demeuraient un élément de l’administration publique, ce qui a conduit à une centralisation excessive et à une bureaucratie dans la gestion des services.
Quelles réformes ont été mises en place dans le secteur des télécommunications en RDC ?
Des réformes ont été mises en place avec la création de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) en 1968, qui a exercé un monopole d’État sur les services de télécommunications, suivi de la création du Réseau National des Télécommunications par Satellite (RENATELSAT) en 1991.
Quels défis la législation congolaise sur la cybercriminalité doit-elle surmonter ?
La recherche identifie des défis et failles dans l’application de la législation congolaise sur la cybercriminalité, nécessitant des propositions d’amélioration pour renforcer la lutte contre ce phénomène criminel numérique.