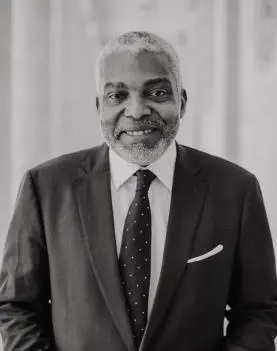L’analyse comparative des référentiels QSE révèle des limites surprenantes des normes ISO 26000 et 31000 face aux tensions interculturelles. En période de pandémie, cette étude critique souligne l’urgence d’adapter les outils QSE pour favoriser des solutions concrètes aux conflits culturels en milieu professionnel multiculturel.
PARTIE II : Adaptation des outils QSE au risque interculturel
Parce que le risque s’applique à tout objet et à tous, il concerne un ensemble de stratégies et de techniques, visant à gérer des personnes dans une organisation professionnelle, en prenant en considération toutes les différences induites par leurs cultures respectives : connaissances, manière de penser, façon de concevoir le monde, comportements, mode de fonctionnement…
Il est question ici d’une démarche diagnostic, permettant de cerner de manière exhaustive les contours du risque culturel.
Le management du risque global (La NF ISO 31000), doit aider à trouver des solutions aux problèmes interculturels : visions divergentes, difficultés de communication, comportement inapproprié…
Le risque culturel pourrait par extension, même si cela n’est pas précisé explicitement dans les normes, être traité comme tous les autres risques de non qualité.
Il s’agit d’appliquer les processus, à l’instar de ceux du management de risque global, capables d’instaurer des pratiques managériales adaptées aux équipes cosmopolites et multiculturelles. Pour atteindre ses objectifs et créer une réelle cohésion d’équipe, le manager interculturel doit respecter trois valeurs de base : l’écoute attentive, le respect de l’autre, l’ouverture à la différence.

Il ressort cependant que, la disparition de l’empathie est de plus en plus prégnante, à cause de l’accroissement de l’individualisme et de l’automatisation de l’outil de travail. De ce point de vue, la survenue de la crise sanitaire liée au covid-19, est un accélérateur de cet individualisme et donc de la diminution de l’empathie.
En ce moment, un débat houleux entre les instances représentatives des salariés et le gouvernement, fait état d’un projet de décret, tendant à faire passer le covid-19, en risque professionnel. Cela étant, la question de l’adaptation des outils QSE au risque interculturel, sera examinée d’une part, du point de vue de l’articulation de la diversité culturelle avec la construction de la cohésion des travailleurs, point de départ de la démarche prévention(A), d’autre part, de la prévention du risque interculturel par conception : la reliance (B),
enfin de l’ébauche d’un Document Unique, comme cadre de contrôle et de résolution(C).
La construction de la cohésion sociale prônée par l’Acte Unique Européen
Les risques interculturels sont les menaces que font peser sur les entreprises, les conflits liés aux différences culturelles, dans les équipes multinationales. Ces risques peuvent être de différentes natures : du management d’équipes mixtes, de l’implantation à l’international, de relation inter-entreprises, de négociation internationale…
Selon Meier20, « les conflits culturels ont souvent pour cause, l’existence des stéréotypes, des préjugés, et de jugement de valeur entre des personnes de profil, d’histoire et de système de valeurs différents. Ils sont également liés, à des questions de distance géographique, culturelle, administrative, économique ou technologique ».
« L’objectif de la gestion des risques interculturels, est de permettre aux collaborateurs et partenaires de différentes nationalités, de comprendre leurs réactions et perceptions réceptives, pour leur permettre de s’ajuster les uns aux autres, d’améliorer la coopération et de limiter les risques de conflits culturels » Loth21.
L’acte unique européen22 (AUE), relativement à la cohésion économique et sociale des travailleurs, dans son nouvel article 118 A CEE, promeut « l’amélioration, notamment du milieu du travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ».
- Tableau de principe de l’AMDEC : évaluation d’incidences et de gravité
Il est question de mettre en lumière, ou plutôt de faire une photographie de la diversité, sur la base de multiples critères : psychologique, bagage intellectuel, catégorie sociale, ethnique, de l’identité de genre, de langue, de génération, d’orientation sexuelle, de croyance, de style, de tempérament…
Il s’agit donc d’une observation attentive de la situation de départ, qui aidera à trouver des clés de lecture des salariés et particulièrement, au moment où apparaissent les difficultés. L’analyse AMDEC, méthode rigoureuse de travail en groupe, permet d’établir comme critères : la gravité des effets de la conflictualité, la fréquence d’apparition de celle-ci, puis enfin, la capacité de détection. L’observation est une étape essentielle, nécessaire pour modifier, qualifier et adapter la gestion des risques.
20 Meier O. Management interculturel, 5e édition, Dunod 2013
21 Désiré Loth, Le management interculturel, L’harmattan 2006
22 L’acte unique européen signé par 12 Etats les 17 et 28 février 1986, respectivement à Luxembourg et à la Haye, et est entré en vigueur le 1er juillet 1987
[6_analyse-comparative-des-referentiels-qse-pour-la-gestion-interculturelle_1]
Source: URL
- L’intersectionnalité23, révélatrice de l’étendue des marqueurs identitaires
L’intersectionnalité étudie « les formes de domination et de discrimination non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que, les différenciations sociales, comme le genre, la race, la classe ou l’orientation sexuelle ne sont pas cloisonnées, ou encore les rapports de domination entre catégories sociales, ne peuvent pas être entièrement expliqués, s’ils sont étudiés séparément les uns des autres ».
Il s’agit de reconnaître et d’admettre l’existence de ces quelques particularités, non exhaustives au demeurant : la différence générationnelle, de croyance, de genre, d’orientation sexuelle.
Il est souhaitable en guise de Qualité, de maintenir et de promouvoir un haut niveau de cohésion au sein de ces identités plurielles.
Le Néerlandais G. Hofstede a étudié l’impact de la diversité des cultures, sur les activités de l’entreprise. (voir tableau en annexe)
23 L’intersectionnalité proposée par Kimberle Williams Crenshaw, est une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui désigne la situation de personne subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Source Wikipédia.
Dès lors qu’apparaissent des tensions, des incompréhensions, le risque de non-qualité devient présent, car il peut obérer durablement les performances de l’entreprise.
Nous allons par conséquent inventorier des risques interculturels et les évaluer :
– la différence générationnelle : l’âgisme24, il y a nécessité de prendre en compte dans une équipe intergénérationnelle, leurs modes de pensées, de communication et volonté, qui ne sont pas les mêmes que celles des jeunes générations. De plus, il est admis que l’évolution culturelle entre générations a entrainé le passage d’une culture de la chaîne de commandement, à une culture axée sur les projets. Il faut noter en toile de fond, qu’il existe quand même, une mise à l’écart des plus âgés, peut-être parce que, moins souples, plus rétifs au changement, à la nouveauté, moins enclins à la prise de risque.
Nous recensons 5 catégories :
- Les seniors (70 ans et plus) ont un sens aigu du service
- Les baby-boomers (45 ans à 65 ans) mettent l’accent sur l’accomplissement personnel, le travail d’équipe. « Vivre pour travailler »
- La génération X (30 ans à 45 ans) davantage d’indépendance et d’adaptabilité.
« Travailler pour vivre »
- La génération Y (moins de 35 ans) élevée à la technologie et à la mondialisation, préfère la flexibilité, la responsabilisation et la valeur du travail.
- La génération Z (née avec le Web), celle-ci n’entend pas tout sacrifier à la valeur travail.
- la différence de croyance. C’est un sujet des plus complexes, qui cristallise toutes « les passions tristes »25. Certaines croyances, d’une époque à l’autre, sont plus militantes et revendicatives que d’autres. La croyance passe avant tout le reste et détermine sa manière d’être et de penser, considère que, ceux qui n’ont pas la même adhésion sont à jeter aux orties. En toute hypothèse, le manager doit être très attentif à cette spécificité, quant à la composition et au management de son équipe.
- l’identité de genre, comme nous l’avons noté précédemment l’égalité homme /femme est inscrite dans la loi, un peu partout dans le monde. Dans la pratique, il y a encore
24 L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondés sur l’Age. Selon le glossaire du site Stop Discrimination publié par L’UE
25 Expression employée par Baruch Spinoza, (philosophe néerlandais, appartenant au courant des modernes rationalistes) pour désigner : la peur, la colère, la haine le mensonge ou la violence, le fanatisme
quelques résistances au niveau salarial, ainsi qu’au niveau des postes à haute valeur ajoutée. La discrimination salariale selon les métiers est assez grande.
- l’orientation sexuelle : (y compris les personnes transidentitaires ) a été consacrée par la loi. Il y a véritablement une évolution lente, mais notable dans le monde occidental essentiellement. Les couples de mêmes sexes ne sont plus ostracisés, obligés qu’ils l’étaient autrefois, de vivre dans la clandestinité. Ils osent enfin de nos jours, faire valoir publiquement leur identité particulière assumée et revendiquée. Par contraste, certains pays africains, ainsi que ceux de la péninsule arabique, sont rétifs à ces évolutions sociétales, criminalisant à souhait et lourdement cette forme de liberté sexuelle. En dépit de cette récusation très forte, il y existe néanmoins une expression très limitée, de cette liberté d’orientation sexuelle.
De plus, dans la suite des différenciations, l’on note aussi les 4 tempéraments26 qui conviennent en milieu de travail.
Le modèle de Jung27, axé sur l’introspection, et dont l’analyse ne sera pas faite ici, seulement esquissé brièvement, est une approche par les 8 types de personnalité, à partir des 4 fonctions psychologiques de base (penser, sentir, pressentir, percevoir) et des 2 types de caractères fondamentaux (introverti et extraverti).
L’approche par les 4 tempéraments est une tentative de traduction des différents comportements, en modèle incarné dans une entreprise.
Cette étude a été réalisée par un groupe d’universitaires français et canadien, avec comme enjeu d’aider le manager opérationnel, dont la vocation cardinale est de diriger les travaux des autres.
Les autres ne fonctionnent pas tous comme nous. Comment voient-ils le monde ? Par conséquent, connaître leurs attentes est indispensable pour guider leur travail.
26 Étude réalisée par Yves Chaumette, conduite de projet, enseignant université Paris I
27 Cauvin Pierre & Cailloux Géneviève « Les types de personnalité, ESF éditeur, 2009, 9è Ed
Chaud informel
Intuition feeling
Sensation perception
Promouvant (innovateur)
Facilitant (stabilisateur)
Tonique
Accommodant
Assurant (organisateur)
Analysant (réalisateur)
Intuition thought
Sensation judgement
Froid formel
Tonique – Accommodant
- Les toniques-affirmant : lancent les sujets, donnent le ton, posent les questions, initient le dialogue, font avancer les choses. Ils ont l’air dynamique, énergique, sûr d’eux, parlent d’une voix forte, prennent de la place, soutiennent leurs idées.
- Les réceptifs-accommodants : écoutent, observent, laissent parler, prennent du recul, réfléchissent avant de parler, essaient de concilier.
Ils ont l’air doux, discret, calme, posé, consensuel.
Formel-Informel
- Le type informel ou chaud, met l’accent sur la relation.
Jovial, détendu, à l’aise, chaleureux, diffus Parait brouillon, bavard, envahissant
- Le type formel ou froid, met l’accent sur la tâche ou objet de négociation Froid, clair, précis, concentré, méthodique
Parait indifférent et distant
- Chaque type se perçoit par : l’attitude, le regard, la voix, c’est-à-dire le comportement.
Le comportement exprime des sentiments, en fonction des priorités ou de valeurs qui recouvrent un besoin.
Les 4 besoins sont :
- Reconnaissance (promouvant, tonique chaud)
- Estime (facilitant, accommodant chaud)
- Sécurité (analysant, accommodant froid)
- Réalisation (assurant, tonique froid)
Chaud informel
Intuition feeling
Sensation perception
Promouvant (reconnaissance)
Facilitant (estime)
Tonique
ou Affirmant
Réceptif
ou Accommodant
Assurant (réalisation de buts)
Analysant (sécurité)
Intuition thought
Sensation judgement
Froid formel
Les 4 styles sont
Traits positifs
Traits négatifs
Traits positifs Traits négatifs
L’assurant | |
Traits positifs | Traits négatifs |
S’oriente vers l’action | L’éléphant dans un magasin de porcelaine |
Résultats immédiats | Arrogant, centré sur soi |
Goût du défi | Désorganisé et éparpillé |
Apprécie l’ambigu et l’inconnu | |
Décisions rapides | |
Prend la direction | |
Leader naturel | |
Le promouvant | |
Traits positifs | Traits négatifs |
Parle aux gens | Tout en paroles, aucune action |
Crée la motivation | Motivations basées sur les flashes |
Enthousiaste stimulant | Pas le sens du temps |
Voit les personnes de manière optimiste | Centré sur soi |
Participe aux groupes | |
Le facilitant | |
Traits positifs | Traits négatifs |
Travaille avec et aide les autres, bonne écoute | Inconsistant, peut avoir du mal à fixer les limites |
Fiable et prévisible | Mal à l’aise avec le changement et l’incertitude |
Crée une ambiance harmonieuse | S’occupe des affaires d’autrui pour maintenir la stabilité |
Développe les compétences spécialisées | |
L’analysant | |
Traits positifs | Traits négatifs |
Pense logiquement | Peut se paralyser |
Habile à décomposer | Peut paraître brutal ou effacé |
Travaille avec le sens du détail | N’a pas l’esprit d’équipe |
Analyse la performance de manière critique | Sentimental |
Autonome et peu demandeur | Évite les conflits |
Comment s’adresser aux Profils Chauds ?
Coûts dus à la non-qualité
Coûts de la détection
Coûts de la prévention
Implication de tous pour prévenir et redresser les conflits
Entretiens individuels et de groupe, formation, coaching
- Avec un Promouvant (Innovateur)
- Technique de l’écho
- Le laisser parler, le faire s’exprimer
- Valoriser son idée
- Avec un Facilitant (Stabilisateur)
- Garder le regard
- Entretenir la relation
- Exprimer le ressenti, le laisser s’exprimer
- Avec un Promouvant (Innovateur)
Comment s’adresser aux Profils Froids ?
- Avec un Analysant (Réalisateur)
- Donner de la clarté, avec méthode et logique
- Parler concret avec des chiffres et des preuves
- Lui laisser le temps
- Avec un Assurant (Organisateur)
- Proposer des solutions
- Approche rationnelle vers des résultats
- Dossier « béton », arguments décisifs
- Avec un Analysant (Réalisateur)
- Le guide d’évaluation des coûts, la norme NF : X50-126
Ce guide d’évaluation, permet de localiser les coûts relatifs à l’absence de qualité, or la conflictualité est une traduction de la non-qualité. Elle a donc un coût : le coût des dysfonctionnements tant interne, qu’externe, le coût de l’identification, et le coût de la prévention et des actions correctives.
Le but est de maîtriser les dépenses relatives aux coûts de réduction et/ou d’élimination de la conflictualité.
Coûts des tensions en externe
Coûts des tensions en interne
Frais liés à la restauration de l’image de marque
Coûts permettant de maintenir
un climat sain: séminaire
d’imprégnation,
Conflits culturels
________________________
20 Meier O. Management interculturel, 5e édition, Dunod 2013. ↑
21 Désiré Loth, Le management interculturel, L’harmattan 2006. ↑
22 L’acte unique européen signé par 12 Etats les 17 et 28 février 1986, respectivement à Luxembourg et à la Haye, et est entré en vigueur le 1er juillet 1987. ↑
24 L’âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondés sur l’Age. Selon le glossaire du site Stop Discrimination publié par L’UE. ↑
25 Expression employée par Baruch Spinoza, (philosophe néerlandais, appartenant au courant des modernes rationalistes) pour désigner : la peur, la colère, la haine le mensonge ou la violence, le fanatisme. ↑
26 Étude réalisée par Yves Chaumette, conduite de projet, enseignant université Paris I. ↑
27 Cauvin Pierre & Cailloux Géneviève « Les types de personnalité, ESF éditeur, 2009, 9è Ed. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les défis interculturels dans la gestion des référentiels QSE?
Les défis interculturels incluent des visions divergentes, des difficultés de communication et des comportements inappropriés, qui peuvent être traités par le management du risque global selon la NF ISO 31000.
Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle impacté l’empathie en milieu professionnel?
La pandémie COVID-19 a accéléré l’individualisme et la diminution de l’empathie, rendant plus difficile le contact humain et la gestion des conflits culturels.
Quelles valeurs de base doivent respecter les managers interculturels?
Les managers interculturels doivent respecter trois valeurs de base : l’écoute attentive, le respect de l’autre et l’ouverture à la différence pour créer une réelle cohésion d’équipe.