L’analyse des amnisties internationales révèle des enjeux cruciaux pour la justice des droits de l’homme. En confrontant les amnisties aux prescriptions pénales, cette étude met en lumière des implications juridiques essentielles pour les victimes et les auteurs présumés, redéfinissant ainsi notre compréhension des mécanismes de clémence.
E- REVUE DE LITTERATURE
Elaborer la problématique des amnisties et des prescriptions pénales en droit international des droits de l’homme nécessite de faire un état des lieux. En effet, ces questions ont suscité la réaction de plusieurs chercheurs. Ainsi, afin de cerner les contours du thème abordé dans ce travail, nous avons consulté certains auteurs dont les points de vue nous ont été d’un grand apport, parlant des amnisties d’une part, et des prescriptions pénales en droit international des droits de l’homme de l’autre.
Entre la seconde guerre mondiale et 2008, il a été enregistré environ 420 processus d’amnistie dans le monde, selon Mallinder L. Toutefois, cette question fait toujours débat entre les défenseurs des droits de l’homme, les spécialistes de résolution des conflits, de la justice transitionnelle. Le fondement du débat résulte du fait de la finalité des amnisties pour les crimes internationaux et de leur impact.
Partant, il est important de souligner que de nombreux auteurs se sont penché sur la reconnaissance par le droit international des droits de l’homme des biens faits, de la bonne pratique des amnisties (objet de notre analyse), au vu de ses conséquences. C’est le cas de Yasmin NAQVI18 qui justifie l’amnistie et pense qu’il est bien vrai que les auteurs des crimes ne doivent pas restés impunis. Cependant, il n’en demeure pas moins que certains qu’il qualifie
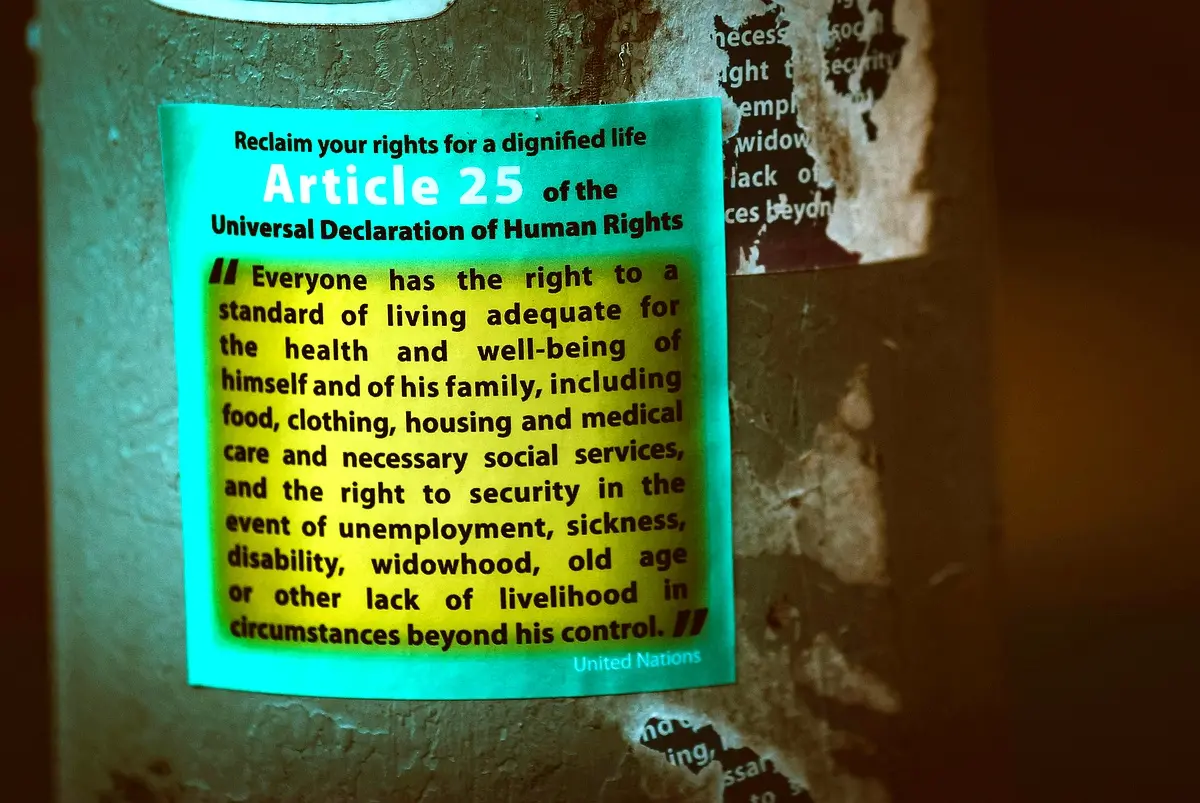
18 Amnistie des crimes de guerre : définir les limites de la reconnaissance internationale, Revue internationale de la Croix-Rouge, 30-09-2003.
de « moins responsables » pourraient bénéficier de l’amnistie. En effet il estime que l’amnistie trouve tout son sens lorsque celle-ci vise à faciliter l’instauration d’une paix durable, stimule le processus de réconciliation et évite de nouvelles violences. La particularité de cet article par rapport à notre travail est qu’il montre de manière concrète l’importance pour le droit international, d’accepter la pratique des amnisties. Ainsi, cet article nous permettra de bien comprendre les biens faits qui résultent de la mise en place des amnisties après un conflit occasionnant des crimes.
Au-delà de cet article, il est important de se référer à l’ouvrage de William BOLE : intitulé « pardon en politique internationale : un autre chemin vers la paix »19. Dans cet ouvrage, l’auteur propose à travers un exemple concret qui est celui de l’Afrique du Sud, une conception du pardon qui permette d’en faire un puissant instrument au service de la résolution des conflits et de la paix.
L’apport de cet ouvrage dans notre thématique est l’appréhension des impacts que peuvent apporter l’amnistie sur la société, au sortir d’une crise, notamment les sociétés africaines qui font l’objet de notre étude. Cependant, plusieurs auteurs dénoncent le fait que l’amnistie soit un instrument de recherche de paix reconnu par le droit international car comme le pense Warren BUFORD et Hugo VAN DER MERWE, « si nous ne parvenons pas à affronter ce qui est arrivé, c’est un peu comme si nous affirmions que ces gens-là
20 ne comptent pas ».
A travers cette pensée, ces auteurs nous font comprendre qu’aborder la question de l’amnistie et le droit international revient également à réparer les injustices causés lors des conflits. Or, la pratique d’amnistie ne prend pas en considération les droits des victimes et permet l’impunité. Cette posture contradictoire est bénéfique dans notre thématique dans la mesure où la pensée des auteurs met un accent sur la réparation au plan internationale, et donc une reconnaissance des droits des victimes, mais aussi la responsabilité
pénale internationale de chaque individu.
En ce qui concerne les prescriptions pénales, elles sont vues par certains auteurs comme une mesure de justice sociale. Ainsi comme le pense M. B. Bouloc, dans le manuel de
M. Stefani, Levasseur et Bouloc « du point de vu de la justice pure, la prescription de l’action publique se justifie parfaitement »21. La prescription est pour ces auteurs une mesure sociale introduite pour les intérêts de la société. Cette pensée est importante pour notre thématique car,
19 W. BOLE, « pardon en politique internationale : un autre chemin vers la paix », Paris : Nouveaux Horizons, 2007.
20 W. BUFORD et H. VAN DER MERWE, « Les réparations en Afrique australe », Cahiers d’études africaines 2004/1 (n° 173-174), p. 263-322.
21 Les auteurs citent : Garraud, Vidal et Magnol, Donnedieu de Vabres, Bouzat et Pinatel, Stefani, Levasseur et Bouloc, Pradel, Varinard, et notent qu’elle est approuvée par Mme Rassat.
elle nous permet de mieux comprendre l’acceptation de la prescription pénale au niveau national, avant de se projeter au niveau international ou il est proscrit par des conventions internationales.
Au regard de ce qui précède, il sied de dire que les pensées des différents auteurs vont nous guider dans la rédaction de ce travail. Elles nous permettront de montrer que l’amnistie est une mesure acceptée par le droit internationale des droits de l’homme, avec un certain nombre de conditions. Aussi, nous comprenons à travers ces auteurs, l’importance des amnisties au vue de l’impact qu’elles ont dans des sociétés sorties de crises. Enfin, les prescriptions pénales, quoi qu’étant des mesures prohibé par le droit international, trouvent leur place en droit interne vue leur intérêt.
Toutefois, il sied de reconnaitre que nos recherches se démarquent des précédents travaux dans la mesure où elles nous ont permis de faire une synthèse de conséquences relatives à l’application des amnisties et des prescriptions pénales sur le continent africain.
F- PROBLEMATIQUE
Une problématique est une perspective théorique que l’on décide d’adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Les amnisties et les prescriptions pénales qui sont deux mesures interdites d’application par certains textes internationaux du fait que ce sont des mesures d’impunité qui violent les droits des victimes et, par la même occasion violent les principes du droit international pénal mais aussi du droit international humanitaire, mais aussi le droit international pénal à travers le principe de responsabilité des individus en cas d’infraction.
Toutefois, il est important d’affirmer que les amnisties et les prescriptions pénales n’ont pas seulement un côté négatif car ils ont aussi une influence positive dans la mesure où ce sont deux institutions qui favorisent la mise en place d’une paix durable, d’une réconciliation nationale. Ainsi, nous pouvons nous poser la question de savoir : la pratique des amnisties et de prescriptions pénales met-elle en péril les droits des victimes ?
Quel est l’impact des amnisties et des prescriptions pénales sur l’ensemble de la societé?
G- HYPOTHESE
Relativement à la problématique sus évoquée, nous émettons l’hypothèse selon laquelle l’application des amnisties et des prescriptions pénales est à l’encontre des règles mises en place par le droit international puisque, violant les droits des victimes et le principe de la responsabilité des individus.
CADRE METHODOLOGIQUE
Etant donné que tout travail scientifique désireux d’être d’une bonne facture ne peut réussir que grâce à l’utilisation d’une ou des méthodes bien déterminées. La méthode demeure ainsi une procédure inhérente à toute démarche scientifique.
A- La méthode juridique
Selon Jean-Louis BERGEL, elle consiste à analyser les textes juridiques et de dégager leur interprétation22. Pour Charles EISMENMANN, cette méthode a deux composantes : la dogmatique qui consiste à analyser les textes et les conditions de leur édiction,23et la casuistique. Cette approche a facilité la compréhension des principaux textes étudiés tels que la Charte des Nations Unies, les deux pactes relatifs aux droits de l’homme et leurs protocoles, les Conventions sur l’imprescriptibilité des crimes, la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention interaméricaine des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme, et les décisions des différentes juridictions internationales ou régionales.
En plus de la dogmatique, il y a l’interprétation casuistique24 qui a permis de confronter les différentes lois d’amnisties des pays africains ayant connu des conflits.
B- La méthode sociologique
Cette approche consistera à appréhender les faits qui doivent être considérés, au-delà des textes, comme des indices permettant de voir le degré et comment les institutions de clémence impactent le droit international des droits de l’homme dans le contexte. Cette méthode nous permet aussi de vérifier la position du droit international des droits de l’homme vis-à-vis de l’amnistie et de la prescription pénale concernant les crimes les plus graves.
C- Les techniques de recherche
L’analyse documentaire a consisté à la recherche et analyse des différents travaux réalisés sur les questions d’amnistie et de prescription pénale. A cet effet, nous ne nous somme pas simplement limité aux conventions qui parlent de ces questions, mais nous nous sommes étendues sur tous les autres travaux disponible à notre portée, tel est le cas des décisions des juridictions pénales internationales et régionales, qui nous ont permis de mieux aborder ce
22 Cf. BERGEL, Jean-Louis, « Méthodes du droit : Théorie générale du droit », 2ème édition, Paris : Dalloz, 1989, p.7.
23 Cf., EISENMANN Charles, « Cours de droit administratif », cité par NACH MBACK Charles, Démocratisation et décentralisation, « genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne
», Paris, Karthala – PDM, 2003, p.45
24 Ibid.
thème, de mieux comprendre la problématique liée à l’amnistie et à la prescription pénale en droit international des droits de l’homme. Cette recherche documentaire s’est principalement fait dans les bibliothèques et sur internet, notamment dans les sites de la CPI, de l’ONU et de plusieurs autres institutions.
D- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
Les comportements criminels sont dans toutes sociétés condamné mais aussi séparés selon la gravité des faits. C’est ainsi qu’en droit international des Droits de l’Homme, il est important de distinguer les violations simples des droits de l’homme des violations graves touchant la sensibilité de la société internationale. Dans la perspective de développer une culture de paix et de justice, il importe d’analyser les fondements et l’impact juridique des amnisties et des prescriptions pénales (Première partie), avant de montrer les mécanismes de protection des droits des victimes après la mise en œuvre des amnisties et des prescriptions pénales (Deuxième partie).
________________________
18 Amnistie des crimes de guerre : définir les limites de la reconnaissance internationale, Revue internationale de la Croix-Rouge, 30-09-2003. ↑
19 W. BOLE, « pardon en politique internationale : un autre chemin vers la paix », Paris : Nouveaux Horizons, 2007. ↑
20 W. BUFORD et H. VAN DER MERWE, « Les réparations en Afrique australe », Cahiers d’études africaines 2004/1 (n° 173-174), p. 263-322. ↑
21 Les auteurs citent : Garraud, Vidal et Magnol, Donnedieu de Vabres, Bouzat et Pinatel, Stefani, Levasseur et Bouloc, Pradel, Varinard, et notent qu’elle est approuvée par Mme Rassat. ↑
22 Cf. BERGEL, Jean-Louis, « Méthodes du droit : Théorie générale du droit », 2ème édition, Paris : Dalloz, 1989, p.7. ↑
23 Cf., EISENMANN Charles, « Cours de droit administratif », cité par NACH MBACK Charles, Démocratisation et décentralisation, « genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne», Paris, Karthala – PDM, 2003, p.45 ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les conditions de reconnaissance des amnisties en droit international des droits de l’homme?
Le droit international des droits de l’homme reconnaît les amnisties sous certaines conditions, notamment lorsqu’elles visent à faciliter l’instauration d’une paix durable et à stimuler le processus de réconciliation.
Pourquoi les prescriptions pénales sont-elles rejetées par le droit international?
Le droit international des droits de l’homme rejette les prescriptions pénales pour promouvoir l’imprescriptibilité des crimes, afin de garantir que les auteurs de violations des droits humains ne restent pas impunis.
Quels impacts les amnisties ont-elles sur les victimes des violations des droits humains?
La pratique d’amnistie ne prend pas en considération les droits des victimes et peut permettre l’impunité, ce qui soulève des préoccupations sur la réparation des injustices causées lors des conflits.